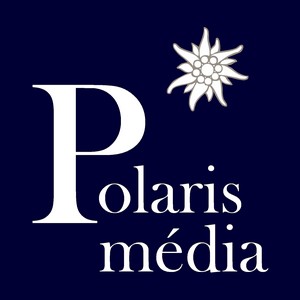Dans les années 1980, sous l’influence empoisonnée de socialistes, il devint à la mode de vanter les bienfaits du métissage culturel. Les Français devaient avoir tout lieu de se réjouir que leur pays soit « enrichi » par des langues, des cultures, des traditions, des religions, des coutumes venues d’ailleurs. Et une majorité de millions d’abrutis, la cervelle rendue perméable à cette propagande par une espèce de sida mental, a commencé à adhérer à cette idée du métissage bienfaisant. Ce discours, fort bien reçu dans une certaine « élite », ne pouvait qu’engendrer des craintes et des crispations chez tous ceux encore dotés d’un cerveau normalement constitué. Pour les contemporains du moment, ce discours semblait dévaloriser à la fois le modèle national et l’attachement qu’on lui portait ; il paraissait surtout annoncer sa remise en cause radicale. La France ne serait plus la France. Nous en avons aujourd’hui la certitude.
Plutôt que de dédaigner, voire de mépriser ce qu’avait été jusque-là le conservatisme de tous les Français, il eût été plus sage d’en comprendre les raisons et de ne pas réduire cet attachement à un refus de l’étranger. La France était, nous sommes aujourd’hui obligés de rédiger à la troisième personne de l’imparfait, d’abord peuplée de Français qui trouvaient leur identité dans un certain « art de vivre ». Était-ce condamnable ? Et pourquoi ? Les gens qui éprouvaient ces craintes à l’époque tout comme ceux qui les éprouvent aujourd’hui savaient aussi bien que les « intellectuels » goûter les charmes des cultures différentes, mais il ne faut pas tout confondre : faire un repas chinois ou marocain, recevoir des étrangers de passage, écouter de la musique africaine ou bien aller passer des vacances au Portugal, ce sont des plaisirs ; avoir le sentiment, et aujourd’hui la certitude, de n’être plus chez soi, c’est un effroyable malaise.
C’est à partir d’une base culturelle bien identifiée, d’un « chez-soi » clairement individualisé et assuré, que l’on goûte les plaisirs de l’accueil ou de l’échange. On aura beau vouloir faire croire aux Français qu’ils sont tous descendants d’étrangers, en remontant au besoin pour cela aux Francs saliens, une partie non négligeable d’entre eux reste attachée à des traditions nationales, à une mémoire historique, à un certain art d’être et de vivre.
En outre, ce plaisir du métissage culturel apprécié par certains ne peut être prisé que dans des conditions favorables, dont la toute première est le libre choix. On a entendu par exemple Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon déplorer l’excès de blancs en France ou le fait de ne pas respirer s’ils sont entourés uniquement de blancs. La chose élémentaire qu’il faut rappeler à ces gens, c’est que s’ils apprécient le bain culturel africain, il faut qu’ils mettent leurs actes en correspondance avec leur pensée, et que c’est à eux d’aller vivre en Afrique au lieu de vouloir l’imposer à tous ici au prétexte que ce bain leur est plaisant à eux. C’est une chose de fréquenter des amis de nationalité et de races différentes, c’en est une autre de se retrouver, sans l’avoir voulu, entouré de voisins étrangers ; c’est une chose d’entretenir un commerce d’amitié et d’échange quand on occupe une place confortable et reconnue dans la société, c’en est une autre d’être mêlé à un prolétariat cosmopolite. Bref, l’étranger n’est pas du tout perçu de la même façon selon que l’on se trouve en bas ou en haut de l’échelle sociale, selon que l’on campe les allées du pouvoir et que l’on déjeune au Georges V avec l’ambassadeur du Qatar ou que l’on est confronté à la vie rendue impossible dans un quartier par un gang afro-maghrébin se livrant au trafic de stupéfiants, et rien n’est si choquant que de voir les « gens d’en haut » se donner en modèle pour dénoncer le « racisme » des « gens d’en bas ». D’un côté, une bourgeoisie de droite, grande ou petite, condamne sans appel et à juste titre les jeunes délinquants au nom de sa propre honnêteté ; de l’autre, une bourgeoisie de gauche, grande ou petite, fonde sur ses bons sentiments pour de lointains immigrés une réprobation horrifiée de la « xénophobie » qui se manifeste au contact des communautés étrangères. Le privilège du privilège, c’est toujours de donner de leçons de morale à ceux qui n’en bénéficient pas. Facile de se déclarer antiraciste quand on est médecin ou ingénieur dans des quartiers préservés et sans contacts avec les immigrés, mais il faut vivre la condition ouvrière, partager les mêmes cages d’escalier pour comprendre. Ce qui est très vite baptisé racisme est surtout le fruit de la peur de perdre son emploi, sa sécurité, sa culture, son identité sociale. Plus on est démuni, plus on est vulnérable. Oui, il faut être socialement « fort » pour trouver confortable le contact de l’étranger. Ces quartiers populaires, les Français blancs les ont largement désertés depuis, ils ont été poussés à ce que l’école de sociologie de Chicago a nommé le « White flight » (voir notre article La loi naturelle contre le melting-pot).
Le populisme est-il xénophobe ? Pourquoi donc les mal, ou les moins bien lotis, prendraient-ils les migrants en masse comme boucs émissaires de tous leurs malheurs ? Parce qu’ils croient à la théorie des races supérieures ? Allons donc ! Non. Dès 1983, Gilles Verbunt, auteur entre autres de La société interculturelle, donnait cette réponse correspondant à la situation de l’époque dans un numéro spécial de Projet (« Pour une politique de l’intégration ») : « Les situations incriminées peuvent s’analyser avec la notion de concurrence. Si des tensions existent et si des conflits éclatent, c’est à cause de l’insuffisance de biens sociaux disponibles. Attribuer un appartement en HLM à une famille immigrée, c’est en priver une famille française ; faire du bruit à des heures inhabituelles, c’est occuper l’espace sonore au détriment des voisins ; l’institutrice qui soutient généreusement les enfants en difficulté prive de son attention les enfants plus avantagés ; le délégué syndical qui s’occupe trop des immigrés est mal vu par les camarades français ; le bureau d’aide sociale qui n’a plus rien à distribuer se voit reprocher de trop bien traiter « les Arabes »… »
Quand vous êtes bien installé dans la société, cette notion de « concurrence » s’atténue et, lorsqu’elle joue, elle ne vous oppose pas à des salariés sénégalais, à des migrants du Soudan mais à des Français bien intégrés comme vous-même. Si, d’aventure, un étranger ou un naturalisé devient médecin, ingénieur ou professeur, il n’aura aucune peine à se faire admettre tant dans son milieu professionnel que dans son milieu social. Car la tolérance est liée davantage aux conditions sociales qu’à la différence culturelle. Dans les milieux favorisés, les individus sont suffisamment assurés et les étrangers suffisamment filtrés, c’est-à-dire rares et intégrés, pour que l’on ne ressente nulle crainte à les accueillir. Mais plus on descend dans l’échelle sociale, plus on se trouve dépendant et, par là même, concurrent. La condition de chacun est de moins en moins individuelle et de plus en plus collective, et l’on se heurte à la masse de la population étrangère qui postule aux mêmes emplois, aux mêmes logements, aux mêmes prestations sociales, qui partagent avec vous l’espace urbain et les services collectifs. Lorsqu’une période de crise réduit l’offre et accentue la demande, que la dissonance culturelle est majeure entre groupes de population, rien ne peut plus empêcher les tensions : les nationaux ne peuvent qu’être tentés de desserrer la contrainte en écartant les étrangers, ou en s’écartant d’eux.
Personne n’a envie d’être situé au plus bas de la société. C’est pourquoi les différents groupes entrent dans une sorte de compétition à l’envers, où chacun s’efforce d’abandonner au voisin la lanterne rouge. Toute société tend à conférer cette dernière place à une minorité étrangère. Ce jeu social, universellement pratiqué, incite les nationaux du bas de l’échelle à bien marquer leurs distances par rapport à ces intouchables, de crainte d’être confondus avec eux dans le Lumpenproletariat. Dans le paradis multiculturel, la concurrence se poursuit ensuite entre les diverses nationalités et ethnies qui se livrent d’implacables batailles pour s’élever les unes au-dessus des autres. Les sociologues savent à quel point la ségrégation et le mépris s’installent facilement entre différentes communautés de diverses nationalités d’origine.
La fin de l’expansion économique dans les années 1970, qui se traduisait par des difficultés accrues pour les Français les plus pauvres ou les moins bien protégés, a été aussi celle de l’installation des immigrés en France et du regroupement familial. Non pas de leur arrivée en tant que travailleurs, mais de leur installation en tant qu’habitants, avec la spécificité qu’il ne s’agissait plus de frères de civilisation, Italiens, Polonais, Espagnols, Portugais, mais d’éléments porteurs de l’islam. Et la vague d’immigration à dominante africaine s’est effectuée dans les plus mauvaises conditions. Au départ, dans les années 1960, il n’était question que de main-d’œuvre. L’industrie française allait chercher de l’autre côté de la Méditerranée, sur ses terres de précédente présence coloniale, les soutiers qu’elle ne trouvait pas sur place après les saignées opérées par les deux guerres mondiales. Dans le climat de plein-emploi et de croissance économique, un tel expédient passait inaperçu. La France créait de discrets « camps de travail » dans les communes à proximité des lieux d’emploi qui ne posaient aucun problème de cohabitation, d’autant que ces étrangers n’étaient là que temporairement et que, le contrat de travail terminé, ils s’en retourneraient chez eux. Ils ne venaient pas vivre, mais travailler en France, et chacun s’accommodait de cette situation.
C’est dans les années 1970-1980 que cette immigration s’est révélée être « de peuplement ». Les ouvriers ont été rejoints par leurs familles à la demande du grand patronat, l’exemple de Francis Bouygues plaidant ce regroupement est connu, ils sont passés des foyers Sonacotra aux HLM avec femmes et enfants, et l’idée d’un retour au pays s’est peu à peu estompée. Les Français se sont retrouvés à l’époque avec une population supplémentaire et définitive de 2 millions d’étrangers différents par la race, la religion et la culture. Ce choc socio-culturel n’a pas été ressenti par la France établie, celle de la bourgeoisie ou de la classe moyenne. Il est resté tout entier des couches les plus faibles et les plus pauvres de la société, les plus nombreuses. L’immigration a répondu à deux aspirations minoritaires : celle des patrons en recherche de salariés dociles pouvant être sous-payés afin de casser le niveau des salaires des Français, et celle des utopies maçonniques universalistes sous l’empire desquelles vit la France. Depuis, la proportion d’extra-européens n’a cessé de croitre sans s’intégrer, au point de faire voler en éclats l’homogénéité du corps social et menacer aujourd’hui l’identité historique de la France. Toutes les annonces alarmantes des esprits clairvoyants sur les dangers de la société multiculturelle, se sont réalisées. Il faut sans cesse rappeler les mots de Guillaume Faye : « Le « vivre-ensemble » bienveillant n’est possible qu’entre des populations apparentées, biologiquement et culturellement. Tout le reste n’est que fumisterie. »
S’il n’est pas facile d’intégrer des individus, il ne l’est pas davantage d’intégrer une religion. Or, c’est bien le nouveau problème qui s’est trouvé posé à la France avec l’arrivée massive de musulmans depuis le rapprochement familial mis en place par les funestes Giscard et Chirac. Depuis, la plupart de ces immigrés n’entendent pas s’assimiler (le Système a même renoncé à exiger cela d’eux) mais vivre « en musulmans en France ».
Il est vrai que l’État français n’est plus catholique, mais il reste « de tradition catholique ». Sa laïcité s’exerce dans un cadre façonné par des siècles d’histoire pendant lesquels la France fut la fille aînée de l’Église, et c’est dans cette structure que les différentes religions étaient supposées s’exercer. Dans les conditions traditionnelles de l’intégration, les étrangers arrivant en France n’imaginaient pas de revendiquer pour leur religion la parité avec le catholicisme. Ni les juifs, ni les orthodoxes, ni les bouddhistes n’espéraient une reconnaissance officielle de leurs rites. Ils se débrouillaient pour pratiquer leur foi dans une société qui l’ignorait. Mais l’une d’entre elles n’était pas disposée à se plier à ce fonctionnement. Pour de multiples raisons, les musulmans entendent que leur religion ait, en quelque sorte, « pignon sur rue » dans nos villes. On l’a vu avec l’accélération des constructions des mosquées, mais un sondage IFOP-Le Monde datant de novembre 1989 révélait que déjà l’attente allait bien au-delà. A l’époque, les musulmans vivant en France étaient 79 % à vouloir que l’on édifie des mosquées lorsque les croyants le demandent et 51 % à penser que le minaret doit être aussi visible que le clocher, 73 % à estimer que leurs principales fêtes religieuses devraient être chômées, 87 % à désirer que les cantines scolaires tiennent compte de leurs interdits alimentaires, 57 % à demander un enseignement confessionnel privé islamique et 47 % à juger qu’il devrait avoir le même statut que l’enseignement catholique. Si l’on ajoute que 72 % d’entre eux sont favorables à une représentation nationale, il s’agit bien déjà à l’époque d’une aspiration à former une communauté à dominante religieuse au sein de la société française. Mais ce même sondage révèle que les Français avaient de l’islam une image qui ne va guère dans ce sens. 71 % l’associaient au fanatisme, 60 % à la violence, et 66 % y voyaient un « retour en arrière » ! Depuis lors, nous avons connu la révolution islamique, le terrorisme, l’apparition de courants fondamentalistes, et les Français sont à bon droit dans la crispation face à une trop forte présence de l’islam.
L’intégration est tout sauf un processus simple et allant de soi. Le rejet de l’autre est une attitude naturelle. D’une façon générale, l’homme préfère vivre dans un environnement culturel assez stable et uniforme, il aime que ses prochains soient ses semblables et partagent ses valeurs, ses croyances, ses mœurs et son comportement. Dans ces conditions, le simple accueil des étrangers, c’est-à-dire non pas d’une famille isolée, mais d’une véritable communauté, est déjà ressenti comme une perturbation, une gêne, une source d’inquiétude. C’est à cette loi naturelle, à ce réflexe instinctif, que se heurte la volonté utopique des francs-maçons au pouvoir d’une société multiraciale, multiculturelle, multireligieuse, c’est vouloir faire rentrer une pièce carrée dans un trou rond dans un jeu de formes pour bébé. Avec la création de difficultés qui n’existeraient pas sans ce volontarisme acharné à associer ce qui n’est pas associable.