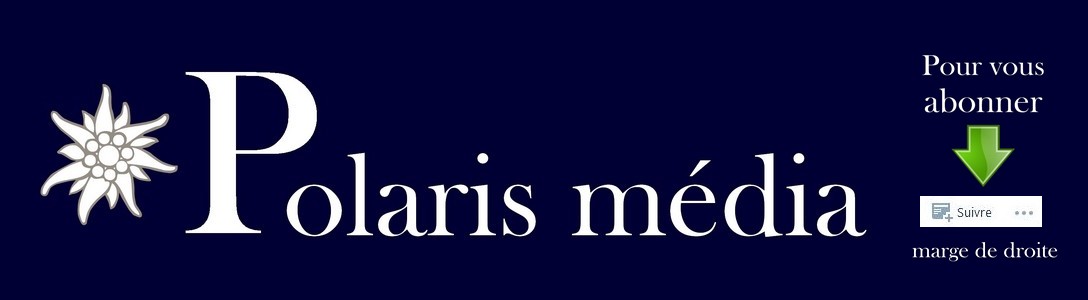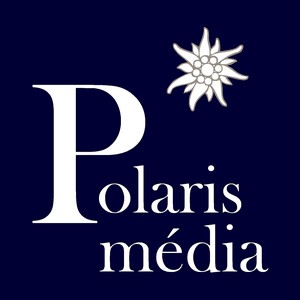La civilisation orthodoxe, née il y a mille ans environ, est présente à des degrés divers en Russie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Géorgie, République Tchèque, Pologne, Albanie. La civilisation orthodoxe est très proche de celle de l’Occident. Si proche que les historiens sont partagés sur son identité : cette héritière de l’Empire byzantin (lui-même issu de l’Empire romain d’Orient) est-elle occidentale ou pas ? Ceux qui la considèrent comme partie intégrante de l’Occident font valoir qu’elle est judéo-chrétienne, et même très proche du catholicisme.
Le monde orthodoxe, traditionnellement qualifié d’oriental, est né d’un contentieux théologique, celui du « Grand Schisme » de 1054, alors monté en épingle pour des raisons politiques. Les chrétiens orientaux refusaient, et refusent toujours :
– le filioque (qui veut dire « le fils aussi » en latin), c’est-à-dire l’idée selon laquelle le Saint-Esprit procède à la fois de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ : il ne procède, disent-ils, que du Père.
– le purgatoire, l’immaculée conception de Marie.
– la suprématie du pape (considéré seulement comme un patriarche parmi d’autres) et du même coup ils refusent son infaillibilité en matière de dogme.
Querelles, chicailleries de juifs synthétiques qui ne concernent en rien le monde païen polythéiste et sur lesquelles nous portons un regard amusé.
La structure pyramidale et centralisée du catholicisme est étrangère à la mentalité des orthodoxes, organisés en Églises autocéphales (dirigées par un primat), correspondant aux pays dans lesquelles elles se trouvent. Ou bien en patriarcats (Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem). En dehors de cela, les chrétiens orientaux acceptaient (et acceptent toujours) tous les autres crédos catholiques, définis principalement par les conciles de Nicée (325 ap. JC) et de Constantinople (381). C’est dire que les différences métaphysiques entre catholiques et orthodoxes ne sont pas abyssales. C’est pourquoi la liturgie byzantine a laissé des traces en Occident, dans la Méditerranée européenne notamment. Nombreuses sont les paroisses corses, siciliennes et sardes qui pratiquent le culte orthodoxe. En Italie du Sud, des évêques célèbrent encore la messe selon les deux rites, le latin et le byzantin. Moscou l’orthodoxe s’est toujours sentie proche du catholicisme, jusqu’à se surnommer « la Troisième Rome ». La deuxième ayant été Constantinople, tout à la fois fastueuse capitale de l’Empire byzantin (c’est-à-dire l’Empire romain d’Orient, qui survécut à la chute de celui d’Occident), et de la chrétienté d’Orient. En 1453, Constantinople fut conquise par les Ottomans, qui la rebaptisèrent Istanbul et en firent la capitale de leur empire.
Nombreux furent les Occidentaux qui influencèrent la Sainte Russie. A cheval sur les XVIe et XVIIe siècles, le tsar Pierre le Grand, un colosse de deux mètres de haut qui avait été se rendre compte sur place, incognito, du modernisme de l’Europe occidentale, prit celle-ci pour exemple avec toute la fougue démesurée de son tempérament. Ayant observé, au cours de son périple européen, les chantiers navals hollandais, qui étaient les plus en pointe, il fit venir des architectes navals bataves, les meilleurs à l’époque, pour donner à la Russie une flotte moderne. Il réorganisa l’administration, développa les manufactures. Il engagea la Russie dans des travaux publics pharaoniques. Au bout du Golfe de Finlande, il fit assécher un marais situé dans l’embouchure de la Neva par dérivation des eaux du fleuve. Et il confia à l’architecte français François Leblond le soin de tracer le plan général de la ville de Saint-Pétersbourg. Beaucoup d’autres architectes, français et surtout italiens, prêteront main forte pour faire sortir de terre cette ville immense, surnommée « la Venise du Nord » avec ses canaux, ses cinq cents ponts et ses innombrables palais de style classique et baroque. Pierre le Grand voyait cette cité comme une fenêtre ouverte sur l’Occident. De 1725 à 1918, Saint-Pétersbourg fut la capitale de la Russie. Hormis le règne de Pierre le Grand, le plus remarquable de l’histoire de la Russie fut celui de l’impératrice Catherine II la Grande, de 1762 à 1796. Admiratrice de ce formidable prédécesseur, elle lui fit ériger, par le sculpteur français Falconet, une statue équestre à Saint-Pétersbourg. Les influences occidentales se manifestèrent à nouveau, notamment en 1907-1912, par la politique économique réformiste du ministre Stolypine. Ensuite, malencontreusement cette fois-ci, par la révolution de 1917, faite au nom de l’idéologie marxiste, forgée en Occident. Enfin, dans les années 1980, la perestroïka donna le signal d’une libéralisation relative, de l’économie et de la société russe.
Ainsi, l’Occident a beaucoup influencé la Russie. Mais ça n’a pas été à sens unique. Les ballets russes, ceux de Diaghilev, ont marqué la chorégraphie occidentale. Rares sont les écrivains occidentaux qui n’ont pas été influencés par les romans de Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine…
A maints égards, l’Occident et la Russie sont très proches. Il n’empêche : une école de pensée dont la figure de proue est l’historien allemand Oswald Spengler (1880-1936), place le monde orthodoxe en dehors de l’Occident. Cette école, prisée des Anglo-Saxons, parmi lesquels Samuel Huntington, insiste sur le fait que les Orthodoxes sont beaucoup moins influencés que les Occidentaux par les Gréco-Latins, leur rationalisme et leur droit positif. Effectivement, les Slaves semblent moins nombreux que les Occidentaux à priser la froide géométrie du cartésianisme. La fameuse âme slave est réputée plus tournée vers la contemplation élégiaque, l’élan poétique et mystique, un certain fatalisme, qui font tout le charme de la littérature russe. Les univers mentaux d’un rationalisme français voltairien obsédé de vérifications et de preuves ou d’un presbytérien américain intoxiqué de travail, diffèrent sensiblement de celui d’un orthodoxe russe. En retour, ce dernier voir en l’Occidental un être perclus d’égoïsme, un cœur desséché par le calcul économique, qui gagnerait à se revivifier par la compassion et le don de soi. Il y a une « conscience slave » et une générosité de l’âme slave bafouées par les dirigeants occidentaux malades de l’esprit de lucre. Cette Russie panslaviste c’est celle du refus de ce qu’elle nomme de façon tout à fait clairvoyante les « Judéo-Américains » et les « Judéo-Occidentaux », considérés à juste titre comme lourdement matérialistes, bassement mercantiles, et souvent athées.
Les panslavistes considèrent que la Russie doit suivre sa propre voie de développement, qui n’est pas celle de l’Occident. Le courant panslaviste a refait surface à la faveur de l’effondrement du système soviétique. L’écrivain Alexandre Soljenitsyne, patriarche rescapé du goulag, a été très critique à l’égard de l’évolution de son pays, où les richesses étaient tombées aux mains des oligarques qui avaient fait main basse sur l’ancienne économie d’État, et les mafias, dans la période entre Eltsine et l’arrivée de Poutine au pouvoir. Soljenitsyne estimait que l’Occident avait gratifié la Russie de ce qu’il a de moins bien, et que celle-ci devait faire retour à ses valeurs morales et politiques traditionnelles. L’Église orthodoxe russe s’inscrit dans cette vision des choses. Grande est sa méfiance vis-à-vis de l’Occident, que nombre de ses popes n’hésitent pas à stigmatiser, forts de la renaissance spectaculaire de l’orthodoxie : les coupoles dorées des cathédrales étincellent au soleil, les travaux de restauration ont été grand train. En tête des processions religieuses, qui se multiplient, cheminent côte à côte le pope et le maire de la ville. Le renouveau orthodoxe russe favorise le courant panslaviste.
L’histoire russe est parcourue par l’antagonisme entre slavophiles et occidentalistes, qui accoucha au XIXe siècle de deux mouvements littéraires. Certains des occidentalistes se référaient à Pierre le Grand et à son volontarisme prométhéen. D’autres à la philosophie allemande, celle d’un Hegel, d’un Feuerbach, ce qui les conduisit vers des positions philosophiques matérialistes, athées et libérales. D’autres encore se tournèrent vers le socialisme utopique de Saint-Simon, de Fourier.
Les envahisseurs mongols, qui déferlèrent au XIIIe siècle, annexèrent le sud et l’est de la Russie, et refluèrent deux siècles plus tard, non sans avoir laissé une empreinte dans les esprits. Leur influence culturelle alla à rebours de celle exercée antérieurement par les Varègues. Ce nom, qui signifie marchands, désigne les Vikings ayant pénétré en Russie en descendant sur leurs knorrs le long des grands fleuves, au IXe siècle, faisant le commerce entre la Scandinavie et la mer Noire. Vers l’an 860, ils fondèrent la principauté de Novgorod. D’autres Varègues se fixèrent à Kiev, qui devint en 882 la capitale de l’État russe naissant. Le mot Russe, d’origine autochtone, désignait les scandinaves de la Baltique. La Russie fut portée sur les fonts baptismaux par ces marchands armés, qui furent aussi de remarquables administrateurs et d’habiles constructeurs d’États. En effet, ces bienveillants Varègues ont exercé une action protectrice et unificatrice sur les populations locales. Ils laissèrent ces dernières libres de gérer leurs affaires à leur guise. Au bout de quelque temps, la confiance mutuelle se développant, les Varègues permirent aux Slaves d’accéder à l’assemblée des chefs scandinaves, tandis que se multipliaient les unions matrimoniales. Ce processus, voisin de celui que connurent les îles britanniques, aboutit à la création d’un véritable État. Vladimir Ier, devenu souverain unique de la Russie kiévienne (après incorporation de la principauté de Novgorod), étendit son territoire de la Baltique à la mer Noire. Il accéléra la fusion entre Slaves et Varègues, et instaura une assistance sociale organisée. Ce royaume de Kiev aux allures décidément si occidentales, qui fut le premier État russe, connut son apogée au XIe siècle.
Les différences entre les civilisations occidentale et orthodoxe justifient qu’on les distingue l’une de l’autre. Toutefois, elles sont unies par un lien de parenté extrêmement étroit, qui scelle leur communauté de destin. Pour le meilleur comme pour le pire. Ces deux proches cousines doivent marcher d’un seul pas. Si la volonté manque clairement d’aller dans ce sens, c’est du côté occidental, comme le montre l’attitude en France d’un Emmanuel Macron enragé dans un soutien au pion ukrainien de son maître anglo-américain, et donc dans une attitude anti-russe désastreuse pour les intérêts français et la population française au quotidien.
Ceux qui ne s’y trompent pas, ce sont les activistes islamistes : eux n’y vont pas par quatre chemins, ils considèrent évidemment les Orthodoxes, au même titre que les adeptes des autres religions, comme des « impies », des « infidèles », des « croisés », qu’il faut combattre sans pitié. Jusqu’à ce qu’ils acceptent de se convertir à l’islam (pour rappel, voir les déclarations de Ruhollah Khomeini et Alija Izetbegovic en fin de notre article Islam ou Islamisme ?)

Le type du « Russe blanc », établi à partir du IXe siècle par le contact entre Slaves et leurs voisins Varègues de la Baltique.