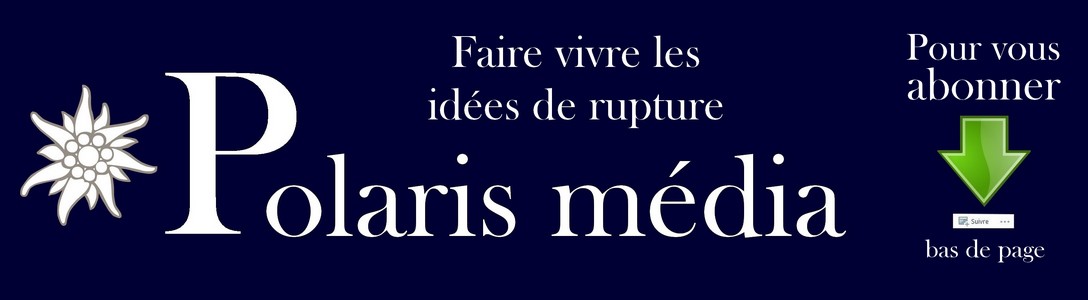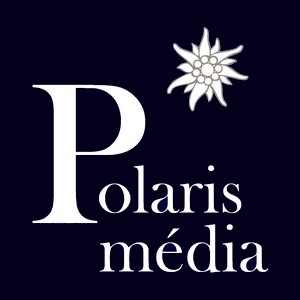Emmanuel Rechberg et Wandrille de Guerpel se sont attaqués dans cette enquête aux conséquences financières et sociétales de cette vache sacré idéologique du régime. En partant du principe que le progressisme n’est pas une évolution normale et naturelle de la politique mais bien un choix initialement philosophique devenu choix politique, une succession de choix politiques à partir d’une vision de la place de l’homme dans la société et de la société dans l’histoire. La succession de ces choix politiques donne une société, donne des combats qui se jouent aujourd’hui, le tout à grand renfort de financement. Mais quel est le coût de ce progressisme ?
La notion de progressisme, de manière générale, repose sur l’idée de gauche qu’il existe un « sens de l’histoire » et que ce sens est inéluctable, se déroulant à sens unique et ne pouvant être empêché. Or ce sens n’est pas inéluctable, pas naturel. Cela soulève donc la question politique qui se cache derrière ladite notion. A contrario évidemment, le sens de l’histoire pour le progressisme suit le « Progrès » comme son nom l’indique, et il se trouve que le XXe siècle a été assez décevant pour certaines parties du progressisme. Sur le plan politique il a déçu. Pour les progressistes le communisme était l’espoir. Grosse désillusion.
Mais il reste l’idée de suive un progrès « moral » qui, lui, serait naturel, au fil de l’histoire l’homme serait de plus en plus moral, chose illustrée par le rapport au passé. Jusqu’à un temps encore proche de nous le passé éclairait, il mettait en garde le présent, on se servait du passé pour comprendre qui l’on était, connaître les erreurs commises et les bontés, comment les éviter ou les reproduire. Aujourd’hui, nous avons le rapport exactement contraire. Dans la phase avancée du progressisme, le présent est considéré être la norme, et on se sert de lui pour juger le passé. Nous étions les héritiers, nous sommes devenus les juges, de ceux qui nous ont précédé. C’est l’exemple type de la « supériorité morale » présumée qui accompagne certains esprits progressistes.
Plus profondément, sur l’homme et la société, le progressisme assimile initialement la liberté à la « délisaison », l’homme n’est plus lié à rien. Pour la gauche chaque homme est en soi un commencement, un sujet autonome qui ne doit rien à des racines, à une hérédité, une culture, ou une histoire. Tout juste lui reconnaît-on un conditionnement social dont il lui appartient de se libérer. « Libération » est paradoxalement le mot clé de la gauche (paradoxalement puisque le socialisme n’a fait qu’emprisonner les peuples). Position diamétralement contraire à celle de la pensée de droite pour qui les hommes existent d’abord en tant que porteurs d’un héritage collectif spécifique. Ordre, héritage, racines, sont les mots clés de la pensée de droite, et particulièrement de la pensée identitaire bien sûr. Pour les progressistes, l’homme ne doit rien ni à la religion évidemment, ni à la culture qui l’entoure, ni même à la Nature, dont les écolos-gauchistes se prétendent être les défenseurs mais sont partisans de la gestation pour autrui, démarche éminemment contre-nature et immorale. Pour les progressistes, l’homme est délié de tout ce qui le précède ou s’impose à lui, il n’est plus que lui-même, il n’a plus d’autres besoins fondamentaux que ceux qu’il se définit pour lui-même. Les frontières, les limites, ce qui est donné, l’identité, la généalogie, qui étaient des constantes anthropologiques jamais remises en cause, sont désormais criminalisées philosophiquement. Si l’homme est une pâte modelable à l’infini (le rapport qu’entretient la pensée de gauche sur l’homme est celui de l’argile et du potier), interchangeable, seul maître de ce qu’il veut être, cela entraîne la disparition totale des communautés naturelles et de l’idée même de la société dans ce qu’elle a de commun. Ce à quoi se conjugue un élément très spécifique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale : une détestation absolue du modèle des communautés naturelles, modèle qu’il ne faut pas seulement détester, il faut le détruire, le Progrès est à ce prix. C’est là qu’apparaît la revendication permanente de tout ce qui est minoritaire, non par perçu comme une quantité, mais comme une « qualité ». Le seul fait d’appartenir à une « minorité qualitative » fait de vous quelqu’un qui peut tout revendiquer tant que cela affaiblit le modèle de référence qui lui est haïssable. Modèle de référence, en l’occurrence l’histoire, les sociétés naturelles, la France historique, le besoin d’identité et d’affiliation.
Développement préalable pour comprendre ce qui est financé derrière par l’idée progressiste. Une fois le triomphe acquis de cet individualisme très libéralisé, il ne reste que des individus pouvant revendiquer au nom de leur minorité, et se ré-attachent à des valeurs qui ne sont plus un commun mais clairement un fanatisme, chacun définissant le sien, l’orientation sexuelle par exemple. Ce qui est jugé important par les progressistes est imposé dans le débat public par leurs médias, et doit devenir la nouvelle norme devant être acceptée par tous, à laquelle tous doivent se soumettre. L’aboutissement du progressisme est qu’il ne s’agit plus de choix individuels permis par la Liberté, mais d’imposition tyrannique à tous de ce que l’on a défini pour soi.
Voilà ce qu’est devenu le progressisme. Beaucoup de Français s’y opposent, mais il continue à être financé par le biais de l’argent public. Les auteurs de l’ouvrage chiffrent le subventionnement du progressisme à 7,8 milliards d’euros chaque année, en distinguant trois grandes familles d’activisme partisanes de cette idéologie et bénéficiaires de ce subventionnement :
– D’abord ce qu’ils appellent les groupes de pression, c’est-à-dire une partie des associations et des ONG. Ainsi les villes de plus de 30 000 habitants en France leur allouent 1,2 milliard d’euros par an. L’État quant à lui verse annuellement à ces associations et ONG au moins 340 millions d’euros de manière directe ou indirecte.
– Ensuite les corps d’État qui ont dévié de leur mission initiale pour promouvoir cette idéologie progressiste et ses évolutions. Les syndicats, dont le rôle en principe est d’intervenir dans les conflits du travail entre employé et employeur, qui ont 180 millions de subvention publique et 1,8 milliard d’aides indirectes, manne avec laquelle ils pèsent par un activisme politique, pèsent dans le débat voire deviennent une force de blocage. France Télévision, 2,5 milliards de dotation annuelle. La presse écrite et ses aides, le Cinéma, toutes les « commissions » dont on parle régulièrement, commission national consultative des droits de l’homme, haut conseil à l’égalité, délégation interministérielle contre le racisme l’antisémitisme et la haine anti LGBT… Les corps d’État imaginent que contrôler les droits humains revient à accompagner toute revendication minoritaire.
– Enfin tous les organes de réflexion de la machinerie de destruction de valeurs par les idées progressistes. Ainsi par exemple de l’évolution de la législation sur la légitime défense, impactant gravement le travail policier et judiciaire.