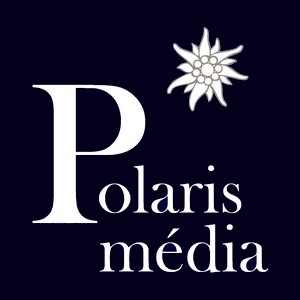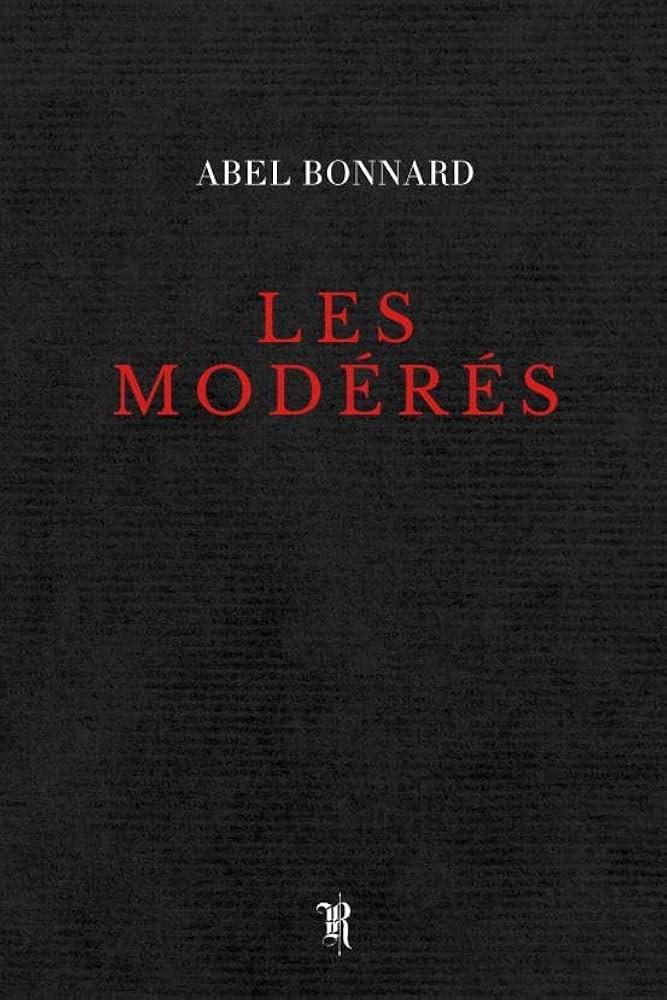
Abel Bonnard fut ministre de l’Éducation nationale, et germanophile. Publié en 1936, Les Modérés s’en prend, comme le titre l’indique, à tous ces Français qui n’ont pas le courage de lutter pour préserver leur pays des dangers qui le menacent. La situation actuelle de la France, sa disparition programmée dans le mondialisme multiracial, et l’aveuglement persistant d’une partie des « Gaulois » condamnant le patriotisme identitaire, malades d’ethnomasochisme, égarés dans l’indifférence ou dans les seuls combats gauchistes, montrent que près d’un siècle plus tard l’ouvrage n’a rien perdu de sa pertinence et surtout de son actualité. On comprend que l’auteur ait été diabolisé par les tenants du Système. Nous en présentons quelques morceaux choisis :
Les politiciens français, qui sont les plus arriérés de tous les hommes, recourent, pour se tirer d’affaire, aux antiques subterfuges qui leur ont si souvent servi.
Sans doute le régime établi en France représente, plus qu’aucun de ceux que l’on a pu voir en Europe dans le même temps, un système clos, où un parti très étroitement lié, c’est-à-dire l’ensemble de la classe politique, exploite la nation entière à son seul profit.
Si singulier que cela paraisse, s’intéresser à la politique, si l’on veut le faire utilement, c’est d’abord, pour chacun de nous, revenir à soi pour s’examiner ; c’est fixer en soi le principe des changements qu’on veut porter dans les choses ; c’est se rendre le citoyen d’un État qui n’existe pas encore ; ce n’est pas simplement quitter une opinion pour une autre, c’est avoir déjà les qualités que l’on veut que la France acquière. Il faut reconnaître que peu de gens prennent les choses de cette façon.
Les Français les moins anesthésiés se trouvent aujourd’hui à la veille d’un grand effort et ils voudraient être au lendemain. La plupart croient rompre avec le régime dont ils se plaignent par quelques criailleries : ils se trompent fort. Tout repoussé qu’il est par le cœur, tout condamné qu’il est par l’esprit, le régime actuel n’en reste pas moins implanté dans les choses, non seulement parce que ceux qui en profitent évoqueront tous les démons plutôt que de renoncer à leurs avantages, mais parce que beaucoup de ceux qui le critiquent sympathisent encore avec lui par toute une partie de leur nature.
Il est fort bien de parler sans complaisance des politiciens, si la connaissance de ce qu’ils sont marque le point d’où l’on part vers ce qu’il faut être ; mais de les vilipender, sans qu’il en soit rien de plus, cela n’empêche pas de partager la responsabilité dont on voudrait les accabler.
La France ne se sera rendue vraiment apte à se donner une meilleure organisation que lorsqu’elle regardera le régime dont elle se plaint comme l’expression obscène des défauts qu’elle a accepté de garder sourdement en elle. C’est par la critique d’un régime qu’elle ne peut pas conserver sans courir à sa perte, que la France doit connaître en elle les défauts avec lesquels elle devrait rompre.
Ce qui caractérise les modérés, c’est leur faiblesse ; c’est par là qu’ils se révèlent les représentants authentiques d’une multitude de Français.
Un des traits caractéristiques de notre histoire récente et contemporaine est l’importance que la parole y a prise, mais cela ne sert qu’à y introduire un nouvel élément d’illusion et de fraude.
L’éloquence des assemblées nous ment sur le drame où elle est mêlée. Elle compte beaucoup moins, en vérité, pour ce qu’elle exprime que pour ce qu’elle cache ; elle étale l’empathie sur l’inavouable et quand un discours ne sert pas à nous prouver que l’homme qui le prononce n’a rien pensé, il sert à nous cacher les arrière-pensées qu’il a eues.
La faiblesse des modérés devient fascinante quand on considère tous les événements qui en sont sortis.
C’est une grande question pour un homme d’honneur qui, dans un emploi important, n’a que la passion de son devoir, de savoir jusqu’à quel point il doit servir un gouvernement qu’il réprouve ; car, s’il est bien vrai qu’en quittant la place, il laisse le champ libre aux destructeurs au lieu de limiter en quelque chose le mal qu’ils font, d’autre part, en demeurant soumis à leurs ordres, il leur cède chaque jour plus qu’il ne voudrait et finit par se dégrader sans avoir rien empêché. Mais la plupart des fonctionnaires placés dans ce cas veulent avant tout ne pas voir les choses aussi nettement : ils ne s’imposent l’obligation d’obéir toujours que parce que ce devoir est pour eux le plus facile. Avides de recevoir leur récompense, de quelque main que ce soit, ils font ces carrières moins viriles que scolaires qui caractérisent toute une espèce de Français et où un homme qui monte en grade ressemble à un enfant qui reçoit des prix.
Si, depuis le milieu du XIXe siècle, la bourgeoisie a résisté plus ou moins sourdement à la restauration de la royauté, c’est qu’elle craignait en cette dernière une possibilité d’organisation sociale, au lieu que le libéralisme ne lui a été si cher que parce qu’en lui assurant la possession de ses avantages sans y mettre de condition, il laissait épars, dans un état d’impuissance et de nullité, tous ceux, employés ou ouvriers, qu’elle redoutait de voir réunis. Ce qui plait à une telle classe, ce qui lui convient, ce qui lui sourit, ce n’est pas une monarchie avec des principes, c’est une anarchie avec des gendarmes.
Il est arrivé à la France le plus triste malheur dont une grande nation puisse être frappée : en l’excitant à se méconnaître, on a fait d’elle un pays interrompu, un peuple acharné contre soi.
Réduits par les maîtres du régime au rôle de figurants, les modérés ne souhaitent justement que celui-là. Ils n’ambitionnent pas d’agir, mais de parader. Ils ne désirent pas l’autorité, où un homme marque sa puissance, mais l’importance, qui peut très bien n’être qu’une dilatation de la nullité.
On ne saurait prendre conscience assez vivement de l’anomalie singulière qui caractérise la République française. La politique n’y est pas une vraie bataille, parce qu’il n’y a d’armée que d’un côté, l’armée constituée par l’oligarchie vivant de ce régime, et que les vaincus, les Français, ne se battent pas, ou si peu. Les préjugés consubstantiels au régime règnent si insolemment dans la vie publique que quiconque a l’audace de les braver par une affirmation qui leur soit contraire, est instantanément diabolisé. Et glorifiés par ceux qui en vivent, ces préjugés sont respectés par ceux-là mêmes qui en meurent.
Entre gens vivant de ce régime, il n’y a pas d’opposition. Ceux qui prétendent en constituer une ont l’esprit si intimidé par leurs adversaires qu’ils n’oseraient pas offenser par une seule vérité le système de mensonge où ils sont enfermés. Ils saluent les mêmes idoles que les gens de gauche, ils leur rendent le même culte, avec la seule humiliation de n’être, dans cette pompe, que d’éternels enfants de chœur. Le système est si bien clos, si parfaitement ajusté, il a si bien exclu tous les sentiments qui pourraient lui nuire que la France est le seul pays où l’amour de la patrie et l’amour de l’ordre ne peuvent éclater que par des émeutes.
Alors, on inventa ces beaux arguments, comme quoi il ne faut pas irriter les violents en leur disputant ce qu’ils demandent, rien n’étant, au contraire si adroit ni si bien joué que de les apaiser malgré eux en leur cédant tout ; dès lors il fut établi que le moindre signe d’existence pour les honnêtes gens est déjà, de leur part, une provocation, tandis que les excès des violents n’en sont jamais une.
Au plus fort de la Terreur, les lettres reçues de France finissaient toujours par dire : à présent, on est tranquille, ce qui signifiait que les bourreaux reprenaient haleine. Dans chaque crise, le troupeau se borne à en souhaiter la fin. Dès lors que des modérés ont paru en France, ils ont fixé d’avance la charte de leurs défaites parce que dans toutes les conceptions où ils ont cru se montrer des politiques experts, ils ont prouvé seulement qu’ils étaient des hommes amoindris.
La politique reste toujours au fond, une lutte acharnée entre des forces inconciliables et des conceptions qui s’excluent, un combat très simple, une lutte entre les hommes de discipline et les hommes de destruction, aussi élémentaire que celle qui, dans les cosmogonies, oppose les dieux aux géants.
La vie politique détermine le destin des peuples. Ce qui fait qu’elle ne pourra jamais être négligée, c’est que le sort de tout ce qui la dépasse se décide en elle. De ces intrigues, de ces menées, de ces turpitudes qui se protègent de notre examen par le dégoût même qu’elles nous inspirent, sortira l’événement qui ira frapper des familles heureuses.
Tout finit dans un amollissement horrible, tout manque et tout ment dans ce cauchemar, et pour retrouver quoi que ce soit de grand ou seulement de vrai, de noble ou seulement d’honnête, de splendide ou seulement de solide, il va falloir en sortir.
Pour juger combien ce régime est rejeté du présent, quoi qu’il y dure encore, il suffit de considérer le type où il s’est incarné, celui du démagogue bourgeois. Il s’obstine à répéter ses tirades dans un drame où elles détonnent, avec un effet bouffon et sinistre.
Ce qui frappe d’abord, ce qui prime tout, dans la France d’aujourd’hui, ce n’est pas l’imminence, la grosseur, la diversité des périls, c’est l’incertitude, l’effarement et l’égarement des Français qui devraient leur répondre.