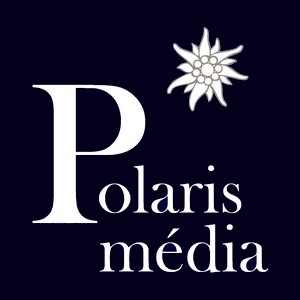Il y a en France une folie de consommation du médicament. Depuis le début de ce siècle, les Français sont les premiers consommateurs d’antibiotiques, les premiers consommateurs de régulateurs de l’humeur, de l’anxiété, de la dépression. Une société qui entrave le bonheur de ses membres au point que 30% d’entre eux ont besoin de ces béquilles, n’est résolument pas saine. La France qui a été très longtemps, paraît-il, la fille aînée de l’Église est devenue la fille aînée de la Pharmacie. Ce qui n’est pas le cas dans le reste de l’Europe.
A l’origine de cette situation, plusieurs facteurs, dont :
– une culture générale qui est influencée par la culture méditerranéenne du Sud, c’est-à-dire que l’on imagine toujours que l’intervention d’un produit peut guérir du fait de vivre, ce qui est quelque chose que l’on ne connaît pas trop dans les pays Nordiques où les rigueurs du climat incitent culturellement chacun à prendre sa propre vie en charge, et la vie des autres dans la vie collective unifiante, ce qui n’est plus trop le cas en France.
– le fait que les laboratoires pharmaceutiques ont toujours su, lorsque des molécules arrivent en fin de vie de brevet, reconvertir l’usage de la chose.
A titre d’exemple s’agissant de ce second facteur, est apparu depuis quelques années, pour les femmes, un mal nommé Syndrome dysphorique, c’est-à-dire des troubles de l’humeur ou du comportement dans la période prémenstruelle. Dans la prise en charge de ce « nouveau mal », il avait décrété il y a une vingtaine d’années qu’il y avait à peu près 8 % des femmes qui étaient atteintes de ce syndrome. Aujourd’hui c’est 50 % ! ce qui commence tout de même à faire beaucoup. Lorsque la moitié d’une population est atteinte d’une pathologie, on est en droit de se demander s’il s’agit d’une maladie ou s’il n’y a pas quelque chose qui relève de la maladie mentale du côté des prescripteurs. Et que prescrit-on aux femmes ? Très exactement du Prozac, aux mêmes doses que l’on pratiquait autrefois dans les dépressions, avant que « l’anxiété » devenue une « déprime » ne devienne une « bipolarité ». A ce moment-là il a fallu reconvertir le Prozac, et pour quatre fois le prix du Prozac classique on a vendu un produit contre le Syndrome dysphorique. On vend de l’espérance, c’est un marché exactement comme le Loto.
Les représentations que se fait la population du corps humain ont changé. Le corps, qui était jusqu’à relativement récemment l’instrument par lequel tout un chacun pouvait vivre et exister, est devenu l’objet de ce qui ressemble à une « mystique ». Depuis l’élaboration de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé en 1946, la santé est définie comme un « état de complet bien-être, physique, mental, social » et ne consiste pas seulement en une absence de pathologie ou d’infirmité. Si la santé c’est un état de complet bien-être, alors le travail des professionnels de Santé devient un travail infini puisqu’il y a toujours un problème dans l’un des trois domaines, physique, mental, social, donc les gens sur un point ou sur un autre sont dans un état de « maladie ». Cette universalisation de la notion même de santé à propos du corps est quelque chose qui tend à se généraliser, au moins dans les pays d’Europe du Sud, et donne un pouvoir infini aux laboratoires pharmaceutiques. Avant, les médicaments soignaient une maladie, aujourd’hui on invente des maladies pour vendre des médicaments.
Nous citions le cas du Prozac et du syndrome dysphorique. On pourrait multiplier les exemples. Sur les maladies hypertensives : il y a 80 % des plus de soixante ans qui sont soignés pour une hypertension. Or, qu’est une hypertension ? C’est une augmentation de la pression dans les circuits artériels. Pourquoi la pression augmente-t-elle dans les circuits artériels ? Tout simplement parce qu’une membrane qui s’appelle la membrane limitante externe élastique perd de son élasticité, autrement dit la résistance du réseau augmente si vous voulez ravitailler vos muscles. Ce n’est pas une maladie, c’est un état naturel qui est dû à l’âge, qui fait pourtant l’objet d’une médication. Si tout ennui qui fait qu’à soixante-dix ans on n’a plus dix-huit ans devient une « maladie », alors on peut tout inventer. Aujourd’hui, selon le DSM-5 (le manuel de prescription des sociétés de psychiatrie américaines), les analyses cliniques sont telles qu’environ 60 % de la population américaine est considérée malade du point de vue comportemental. Cela instaure évidemment un marché colossal pour l’industrie pharmaceutique. Si l’on s’occupe de pathogénie, on s’occupe d’essayer de comprendre pourquoi quelqu’un qui se sent plutôt bien, avec une régulation de l’humeur, de l’appétit, du sommeil, de la concentration, de la tonicité, de la mobilité, se met subitement à dysfonctionner. Il faut déterminer quelle en est la cause. Or, si l’on détermine qu’il y a maladie non pas à partir de la cause mais à partir des symptômes, à ce moment-là tout devient maladie. Tout dépend des critères choisis. Et les critères établissant qu’il y a maladie sont idiots, celui de l’hypertension, mais aussi du cholestérol. Tout le monde est supposé selon la norme en vigueur avoir un cholestérol, quel que soit l’âge, équivalent à celui que l’on a à vingt-cinq ans. Or, depuis que les associations médicales américaines ont fait leurs dernières révisions à propos des taux de cholestérol non maladifs, il se trouve que 36 millions d’Américains sont « malades » d’une hypercholestérolémie. Par ignorance, les publics se font mener en bateau, et Big Pharma se régale.
Le biologiste René Dubos, quasiment inconnu en France, est le metteur au point de huit des dix premiers antibiotiques. C’est lui qui a inventé l’antibiothérapie, et non Flemming comme on l’a dit après que ce dernier ait reçu le Nobel en 1945. Dubos était diplômé de l’Institut d’Agronomie, passionné par les champignons. Il a changé de nationalité, et est parti avancer ses recherches à l’Institut Rockefeller aux États-Unis à la demande d’Alexis Carrel. En étudiant les champignons et leur rôle dans les équilibres germinaux, c’est lui qui a remarqué le premier que les vertus des champignons pouvaient s’exercer comme antigerminaux. Mais il a prévenu du fait que l’abus d’antibiotiques conduirait à l’apparition d’antibiorésistants. C’est exactement ce qui s’est passé. Mais en disant cela il n’allait évidemment pas dans le sens des labos lancés dans la production d’antibiotiques. Cette résistance à l’effet des antibiotiques, on la voit désormais chaque année avec ce que l’on appelle les maladies nosocomiales. Il y a en France chaque années 12.000 morts reconnus par maladies nosocomiales, et ces maladies sont le fait de germes qui ont construit leur antibiorésistance. Or, plus on met d’antibiotiques sur le marché thérapeutique, plus on fabrique d’antibiorésistance. Et quels sont les premier services concernés ? Ceux de chirurgie, notamment ceux qui s’occupent de tissus dans lesquels la densité de vascularisation est minimale (donc la densité d’antigermes naturels), ce que l’on appelle le système immunitaire minimal, c’est-à-dire toute la chirurgie osseuse. C’est là qu’on a le plus de ces infections tellement terribles que l’on ne peut pas tirer ces patients d’affaire, ils ne sortent que les pieds devant. Une étude assez terrible montre que la consommation française était cinq fois celle de la Grande-Bretagne et sept fois celle de l’Allemagne, et les conséquences prédites dès les années 1930 par René Dubos étaient mesurables, les staphylocoques dorés hospitaliers par exemple résistaient à la pénicilline dans 52 % des cas en France contre 9 % en Allemagne et 1 % au Danemark. Différence de chiffres énorme, qui montre que l’on a fait en France à proprement parler de l’élevage de germes antibiorésistants. Cette différence de résistance aux médicaments vis-à-vis de certaines maladies a été artificiellement fabriquée en France au nom du « salut pour tous » et au nom de la définition de la Santé adoptée par l’OMS de 1946.
Et du côté du public enfin, qui est aussi responsable de ce qui lui arrive, il y a le problème de cette idéologie salutiste que nous évoquions comme l’un des deux facteurs dans l’introduction de notre propos, public qui espère se débarrasser du désagrément qu’apporte le fait de vivre, adoucir le rapport au réel, en prenant des médicaments et des drogues, alors que l’on ne se débarrasse pas du fait de vivre, on l’assume.