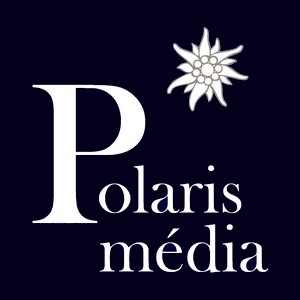Nombreux sont les auteurs du XXe siècle et de l’époque contemporaine que votre scribe considère comme des maîtres, d’Ortega y Gasset à Alain de Benoist et Guillaume Faye, en passant par Gottfried Benn, Konrad Lorenz, Marcello Veneziani, Giano Accame, Roger Scruton, Franco Cardini, Jorge Luis Borges, Ezra Pound, Thomas S. Eliot, Simone Weil, Sainte Edith Stein, C.S. Lewis, Julius Evola et René Guénon. Cette liste est incomplète et regroupe des personnalités très différentes, unies par leur malaise face à la modernité. L’intellectuel dont je me sens le plus proche, mon maître préféré, reste néanmoins le Colombien Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), figure solitaire, hautement cultivée et imprégnée de culture européenne, probablement le dernier grand réactionnaire. Non pas au sens d’une nostalgie stérile d’un passé idéalisé – qui n’a pratiquement jamais existé – mais comme une révolte, une rébellion intérieure contre les maux, les folies et les absurdités de l’époque, au nom d’un idéal moral et spirituel supérieur. Fils de la haute bourgeoisie créole de Bogotá, catholique, il était l’ami de deux grands compatriotes, le romancier Alvaro Mutis, créateur du personnage de Maqroll le gaviero, et Gabriel García Márquez, auteur de Cent ans de solitude. Ce dernier a dit un jour que s’il n’avait pas été communiste, il aurait pensé exactement comme Dàvila, Colacho pour ses amis.
Entouré d’une bibliothèque immense, il était un observateur extraordinaire des événements et des personnages, à qui il consacrait des écrits très courts et incisifs, les « scholies », qui étaient autrefois de brèves notes écrites par des érudits en marge des textes classiques, accompagnées de commentaires, d’exégèses et de clarifications du texte principal. Les scolii de Dàvila sont des aphorismes brillants et pénétrants, des prouesses de clarté et de concision, des exemples d’art dans la ciselure des mots, rassemblés par Mutis dans plusieurs volumes intitulés En marge d’un texte implicite (« Escolios a un Texto Implícito »). Pour Dàvila, ce texte est le démêlage de la modernité et de la postmodernité, le spectacle fâcheux de la décadence vue à travers un regard sceptique. Désillusionné par l’humanité mais fermement ancré dans sa foi en Dieu chrétien, il demeure néanmoins impopulaire auprès du catholicisme traditionnel, peut-être parce qu’il se prétendait païen croyant au Christ.
Implicite mais très claire est l’anthropologie politique antimoderne de son horizon idéal. Les scholies de Dàvila sont écrites dans un espagnol très élégant, un plaisir pour l’âme pour ceux qui connaissent la langue de Cervantès ; elles représentent, par la variété des thèmes, la force pénétrante des jugements et une concision prodigieuse, un véritable bréviaire antimoderne d’un grand charme. Chaque ligne révèle une culture vaste, polymorphe et multilingue. Vers la fin de sa vie, Colacho commença à étudier le danois afin de lire Kierkegaard dans la langue originale, tandis qu’il était toujours fasciné par Dante, dont il était un profond connaisseur, qu’il étudiait et méditait dans notre langue. Gómez Dávila jouit aujourd’hui d’un prestige et d’une influence grandissants. Dès ses débuts, il nous invite à la réflexion et à la découverte. Ses scholies sont des commentaires sur d’innombrables thèmes et de nombreux penseurs, écrivains, artistes et poètes, rarement cités explicitement, mais plutôt évoqués comme des invitations au lecteur.
Son texte implicite ne s’adresse pas à tous ; il s’agit d’une proposition de réflexion, implicite elle aussi, destinée à ceux qui partagent une certaine vision du monde. C’est pourquoi cet article, plutôt qu’un hommage à Colacho, se veut une synthèse de la pensée de l’auteur, à travers le parcours explicite et insistant de sa pensée, centré sur le voyage intérieur autour de l’idée d’aristocratie. Non pas de sang, mais d’esprit et d’intellect. Il l’admet lui-même à contrecœur, voire avec pudeur : « Aucune espèce politique ne me séduit autant que ces aristocrates libéraux dont le sens aigu de la liberté ne découle pas d’obscures aspirations démocratiques, mais d’une conscience inaltérable de la dignité individuelle et d’une notion lucide des devoirs d’une classe dirigeante. Tocqueville en est le plus noble représentant. Les distances entre nations, classes sociales, cultures et races sont insignifiantes : l’abîme se creuse entre l’esprit plébéien et l’esprit patricien. Le polémiste catholique Léon Bloy affirmait qu’une fois identifié le mot le plus répété d’une œuvre littéraire, on possède la clé pour en découvrir la raison d’être. »
Le champ sémantique de prédilection de Gómez Dávila est l’aristocratie. Il applique l’adjectif « noble » – sans se soucier de la répétition – à tout ce qui a de la valeur, et « plébéien » à tout ce qui doit être rejeté. Il utilise le contraste entre honneur et déshonneur pour formuler des jugements figés et raisonner sur Dieu : « Toute fin autre que Dieu nous déshonore. » Il y a aussi une raison biographique à cela, liée à son statut social, ainsi qu’à un héritage hispanique ancien. « La tenue habillée est le premier pas vers la civilisation » ; ou encore « nul n’a besoin de se vanter de sa condition modeste. Elle est généralement évidente. » Mais il ne s’agit pas de l’arrogance des castes ni de la suffisance des riches : « Depuis plus d’un siècle, il n’y a plus de classe supérieure. Seulement une partie plus prétentieuse de la classe moyenne. » Il ne s’agit pas d’un embellissement littéraire ni d’un vestige de classiscisme, mais d’une approche profonde, globale et implicitement systématique. Comme son amour indéfectible pour le Moyen Âge, ce qui est curieux pour un Colombien, dont le pays a sauté le Moyen Âge et est entré dans l’histoire occidentale après la conquête espagnole, en pleine Renaissance.
C’est la preuve que Gómez Dávila défend un Moyen Âge de l’esprit : « Comparé à une église romane, tout le reste, sans exception, est plus ou moins plébéien. » Il adopte une position claire sur l’histoire : « Trois types d’éthiques s’affrontent dans l’histoire : l’éthique démocratique de l’utilité sociale, l’éthique libérale de la bienveillance individuelle et l’éthique aristocratique de la qualité personnelle. » Il en va de même pour la littérature. « À Homère, poète de l’aristocratie ionienne, et à Dante, poète de l’ordre médiéval, il faut ajouter Shakespeare, poète du féodalisme (selon Morley). La réaction n’est pas mauvaise, pour les poètes. » Et pour la religion : « L’éternité est l’état cristallin de nos émotions nobles, fugaces et brèves. »
Il ne s’agit pas d’une question de bizarreries stylistiques ou sémantiques. La noblesse d’esprit est l’idée qui articule toute sa vision. « Le véritable aristocrate est celui qui possède une vie intérieure, quels que soient son origine, son rang ou sa fortune. » Cette idée permet de comprendre cette scholie : « L’aristocrate suprême n’est pas le seigneur féodal dans son château, mais le moine contemplatif dans sa cellule. » Le moine est rejoint par le lecteur conscient : « La généalogie importante est celle des ancêtres intellectuels que nous adoptons en nous efforçant d’être adoptés. » La conception de l’aristocratie de Davila transcende les catégories sociologiques traditionnelles pour se situer dans le domaine de l’esprit et, par conséquent, par nécessité : « Rares sont ceux qui naissent nobles, mais encore moins nombreux sont ceux qui meurent nobles. »
Penseur perspicace, il ne se satisfait pas des dimensions plus éthérées de l’idée. Ses racines étaient celles d’un juriste et d’un philosophe du droit. Lorsqu’on saisit le sens de sa pensée, on comprend l’exigence de l’obligation intime du privilège qui devient devoir. Noblesse oblige, c’est-à-dire qu’elle contraint à un comportement élevé. « Noble est celui qui est capable de ne pas faire tout ce qu’il pourrait. » Son rejet du positivisme et de l’étatisme est clair : « La loi est l’embryon de la terreur. » Sa conclusion est : « Là où le législateur n’est pas considéré comme omnipotent, l’héritage médiéval persiste », avertissant que « la loi devient facilement une simple arme politique là où elle n’est pas coutumière. » Gómez Dávila perçoit la modernité comme un processus de dégénérescence qui a dépouillé l’homme de sa noblesse intrinsèque en échange de miroirs et de bibelots. « Les doctrines politiques modernes cachent des idéologies complaisantes. La dernière idée politique fut le Saint-Empire romain germanique. » Malgré son pessimisme apparent, il montre la voie de la régénération à travers l’aristocratie authentique d’une vie intérieure incorruptible. L’ensemble de ses scholies nous offre un traité de chevalerie pour le XXIe siècle. Pour Dávila, l’intelligence est spontanément aristocratique, car elle est la faculté de distinguer les différences et d’établir des rangs.
Dans sa conception de l’homme, il oppose un sarcasme flagrant envers la prétendue rationalité, trait commun de notre espèce, à la ferme revendication, assumée en toute conscience et volonté, d’appartenir à une aristocratie particulière, celle de l’intelligence. Il va jusqu’à dire que cette aristocratie n’est rien de moins qu’une patrie. Ci-dessous, nous citons sans commentaires – qui seraient de piètres scholies, de mauvaises imitations des originaux – quelques aphorismes de Davila, parmi ceux que nous avons soulignés et annotés lors de multiples lectures.
Roberto Pecchioli