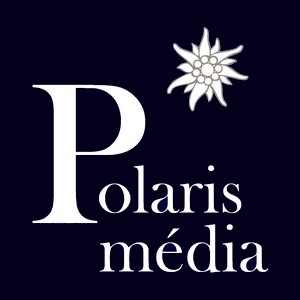Il est bon que nous prenions notre part de diffusion sur ce qui s’est passé en 1793, non par défense du catholicisme et des curés (nos lecteurs savent que ce n’est pas notre tasse de thé), mais afin que la vérité circule par le plus de canaux possibles sur les fondements de la vertueuse République maçonnique sous l’empire de laquelle nous vivons toujours, avec la clique de fripouilles pétrie du « glorieux roman » de la Révolution, couvrant tout l’éventail d’idées, de l’extrême-gauche à Reconquête, qui ne jurent que par la République, ses « grands hommes », sa pompe et sa symbolique, du buste de Marianne africaine de Fabius à la branche d’acacia du logo de Zemmour. Ce faisant, nous n’aurons aucune originalité, les faits sont connus, depuis les travaux de Reynald Sécher. Mais près de quarante ans après le bicentenaire de 1789 qui fut l’occasion de découvrir avec précision les forfaits des troupes commandées par le Comité de Salut Public, la gauche sur cette page d’histoire est toujours dans la négation et l’ordure.
Au cours du printemps-été 1793, le gouvernement central révolutionnaire ne se fait plus obéir que dans une trentaine de départements au plus. La révolution déçoit, pire, elle fait peur. Si la révolte n’a pas été générale contre ces « libérateurs », c’est probablement du fait d’un manque de plan d’ensemble chez les révoltés, et par l’activité débordante et énergique de l’extrême minorité au pouvoir. Les bolcheviques en Russie s’imposeront dans les mêmes conditions. La Révolution française ne s’est imposée que par la guerre civile et la Terreur, la pratique de la délation (loi du 3 juin 1790) ayant divisé la population en deux parties opposées, prêtes à en venir aux mains selon les constatations d’inspecteurs dépêchés dans les départements hostiles pour essayer de comprendre la situation et les oppositions à la doctrine révolutionnaire. Comme dans toutes les guerres civiles, surviendront des abus et des excès regrettables, commencés particulièrement par la soldatesque au service de la Révolution, la garde nationale revêtue de « l’uniforme sacré de la liberté ». Ils entraîneront fatalement des réactions d’hostilité parmi le peuple et une surenchère qui aboutira à un climat de terreur générale.

François Athanase Charette de la Contrie, leader parmi d’autres de l’opposition royaliste à la République, porté au cinéma en 2023
La décision d’anéantir le territoire de la Vendée et d’exterminer sa population pour l’exemple, a été prise par la Convention, les « représentants du peuple souverain », par les décrets du 1er août et 1er octobre 1793. Dans toute l’Histoire du monde, c’est là le seul cas de génocide voté par une assemblée contre une partie de sa population. L’Histoire est pavée de massacres d’innocents, mais la Vendée semble être le premier cas de planification de génocide et de destruction méthodique, minutieuse et généralisée avec le déplacement et les méthodes des « colonnes infernales ». En Vendée, la République au essayé et usé du gazage, de camps, de fours crématoires. Toutes choses que le Système n’attribue qu’aux affreux nazis, et se garde bien d’occulter s’agissant de la Révolution française. La Vendée a été un laboratoire grandeur nature, d’ailleurs conçu comme tel. On y inventa le génocide directement issu des élucubrations des Lumières. Elle fut le premier territoire à servir de champ d’expérimentation à la théorie de la purification ethnique, du remplacement d’une population récalcitrante, donc réactionnaire, par une autre, mieux rééduquée, donc « progressiste ». C’est ce que Gracchus Babeuf, père du communisme moderne et contemporain des événements, appelle « le système de dépopulation », « le populicide vendéen ». Des départements extérieurs à la Vendée, comme l’Eure, prendront des mesures similaires. Un représentant du peuple (selon la terminologie de l’époque qui fleure bon le communisme chinois du XXè siècle !) écrira ceci : « les laisser échapper serait partager le crime de leur existence ». Comme le disait également Carrier, « c’est par principe d’humanité que je purge la terre de ces monstres ».
La Comtesse de la Bouëre, témoin des événements sous la Terreur fait cette description de la vie quotidienne des populations, que le pouvoir révolutionnaire affuble du nom de « brigands », réduites à tenter de sauver leur peau hors de leurs maisons détruites :
« Une fois les colonnes infernales dans le pays, il fallait de toute nécessité se cacher dans les bois, dans les genêts ou dans les ajoncs. On incendiait en même temps bourgs, villages, châteaux sans épargner les plus misérables masures. Une fumée noire et épaisse s’élevait dans l’air, qui devenait rouge et embrasé à mesure que la destruction s’étendait. Cette fumée formait avec les nuages comme une barrière qui interceptait la vue du ciel. Il semblait que la terre en était séparée par le crime. Dès le matin, avant le jour, on était sur pied. La prière faite en commun, la soupe mangée, chacun se dirigeait selon son inspiration. Les hommes allaient se camper sur quelques lieux élevés, afin de surveiller, à travers les arbres, l’ennemi pour le fuir, ou pour essayer, après son départ, d’arrêter les ravages de l’incendie. Les femmes se jetaient dans les fourrés, pour se tapir sur le son détrempé de pluie et de neige. Là, blotti sur la terre, on ne voyait pas à quatre pas devant soi, mais on entendait tout. Le son des tambours retentissait de tous côtés. Quand ce bruit sinistre s’éloignait à droite, il recommençait à gauche. Puis, ce sont les coups de fusil des Bleus poursuivant les fuyards, les cris : Arrête, arrête, avec des blasphèmes épouvantables. Alors les mères serraient plus fortement leurs enfants dans leurs bras. Chose étonnante, ces petits êtres comprenaient la terreur qu’exprimaient les étreintes maternelles : car il n’y a pas d’exemple que leurs cris aient trahi la retraite des infortunés qui se cachaient. Quand l’incendie était dans les maisons, on entendait pétiller les flammes, les poutres s’abîmer dans le feu, les murs éclater et s’écrouler. On attendait la fin du jour pour sortir de ces retraites des loups et des renards. C’était la voix du chat-huant qui donnait le signal. Le cri lugubre de cet oiseau était pour nous plus agréable que le chant du rossignol. Il nous annonçait le départ des bourreaux ».
Le 23 décembre 1793, Westermann, l’un des principaux bourreaux avec Turreau et Carrier, écrit à Paris : « Il n’y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l’enterrer dans les marais et dans les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m’avez donnés, j’ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré des femmes, qui, au moins pour celles-là, n’enfanteront plus de brigands. Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher. J’ai tout exterminé ». Le caractère totalitaire et génocidaire du régime républicain est pleinement révélé par cette missive. Et la mention des enfants écrasés sous les pieds des chevaux n’est pas une figure de style. La France des héritiers des Lumières a génocidé une partie de son peuple, mais elle tait le sujet et se pose toujours en donneuse de leçons. Cela dit, il ne suffit pas d’utiliser divers qualificatifs et synonymes pour évoquer des atrocités. Pour en prendre la mesure, pour savoir ce que furent ces « honorables » républicains dont la cocarde tricolore et le faisceau licteur ornent toujours les attributs du régime, quelques exemples tirés des archives départementales de Vendée méritent d’être cités, il faut les lire, tous.
La guillotine, surnommée le « moulin à silence » ou le « rasoir national », fonctionne sans trêve. Comme elle est trop lente, on a recours à des moyens plus radicaux et plus efficaces comme l’explique un citoyen au représentant du peuple Minier : « Mon ami, je t’annonce avec plaisir que les brigands sont bien détruits. Le nombre qu’on en amène ici depuis huit jours est incalculable. Il en arrive à tout moment. Comme en les fusillant c’est trop long et qu’on use de la poudre et des balles, on a pris le parti d’en mettre un certain nombre dans de grands bateaux, et de les conduire au milieu de la rivière, à une demi-lieue de la ville et là on coule le bateau à fond. Cette opération se fait journellement. »
Une méthode qui sera ensuite reprise par les bolcheviques. La procédure est simple : on entasse la cargaison humaine dans une vieille galiote aménagée de sortes de sabords ; une fois au large, on les fait voler en éclats à coups de hache : l’eau gicle de toutes parts et en quelques instants tous les prisonniers sont noyés. Ceux qui en réchappent sont immédiatement sabrés (d’où le terme de sabrades) par les bourreaux qui de leurs barques légères assistent au spectacle.
« D’abord les noyades se faisaient de nuit, mais le comité révolutionnaire ne tarda pas à se familiariser avec le crime : il n’en devint que plus cruel et dès ce moment, les noyades se firent en plein jour…D’abord les individus étaient noyés avec leurs vêtements ; mais ensuite le comité, conduit par la cupidité autant que par le raffinement de la cruauté, dépouillait de leurs vêtements ceux qu’il voulait immoler aux différentes passions qui l’animaient. Il faut aussi vous parler du « mariage républicain » qui consistait à attacher, tout nus, sous les aisselles, un homme à une jeune femme, et à les précipiter ainsi dans les eaux. »
La femme Pichot, vingt-cinquième témoin, demeurant à la Sècherie de Nantes, c’est-à-dire juste en face de l’endroit où l’on noie, déclare qu’elle a vu des charpentiers faire des trous à une gabare : le lendemain elle apprend qu’on avait noyé « grand nombre de femmes dont plusieurs portaient des enfants sur leurs bras ».
Carrier se vante devant l’inspecteur de l’armée, Martin Naudelle, « d’y avoir fait passe deux mille huit cents brigands » dans ce qu’il appelle la déportation verticale dans la baignoire nationale, le grand verre des calotins ou le baptême patriotique. En fait, ce sont 4.800 personnes recensées, que la Loire, ce « torrent révolutionnaire », engloutit au cours du seul automne 1793.
Les passions sont tellement surexcitées pendant cette année 1793 qu’on songe à recourir aux armes chimiques. Un pharmacien d’Angers, Proust, invente une boule contenant d’après lui « un levain propre à rendre mortel l’air de toute une contrée ». On pourrait l’employer pour détruire la Vendée par infection, mais des essais tentés sur des moutons ne donnent pas satisfaction. Carrier propose alors le poison sous forme d’arsenic dans les puits. Les idées fusent, certaines semblent même avoir trouvé un commencement d’exécution, témoin cette lettre de Savin à Charette du 25 mai 1793 : « Nous fûmes vraiment étonnés de la quantité d’arsenic que l’on trouva à Palluau, au commencement de la guerre. On nous a même constamment assuré qu’un étranger, qu’ils avaient avec eux et qui fut tué à cette affaire, était chargé d’assurer le projet d’empoisonnement.
Pour arriver à leurs fins, les républicains décident alors d’avoir recours aux « colonnes infernales », à la flottille dont l’action est presque inconnue, et aux commissaires civils. Lors du vote du décret du 1er août 1793 ordonnant entre autres « l’envoi de matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis et les genêts (art. VII), Turreau s’exclame : « La Vendée doit être un cimetière national ». Et elle le deviendra. Les représentants Choudieu et Bellegarde mentionnent, dès le 15 octobre, dans une lettre à la Convention que l’armée de la république était partout précédée de la terreur : « le fer, le feu sont les seules armes dont nous fassions usage ». Le projet de destruction totale ne fut en fait appliqué qu’avec la proposition du plan de Turreau, nouveau général en chef de l’armée de l’Ouest. Dès son arrivée, il écrit au Comité de Salut Public à deux reprises pour arrêter le plan qu’il compte suivre. Le 17 janvier 1794, après avoir écrit de sa main, en tête de son papier la devise : « Liberté, Fraternité, Égalité, ou la Mort », Turreau envoie les instructions suivantes à ses lieutenants : « Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main, ou convaincus de les avoir prises, seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les femmes, les filles et enfants (…). Les personnes seulement suspectes ne seront pas épargnées. Tous les villages, bourgs, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. » Ce n’est que le 8 février 1794 que le Comité de Salut Public envoie à Turreau son accord par l’intermédiaire de Carnot : « Tu te plains, citoyen général, de n’avoir pas reçu du Comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures mais, éloigné du théâtre d’opération, il attend les résultats pour se prononcer : extermine les brigands jusqu’au dernier, voilà ton devoir… »
Le 31 janvier 1794 : « Amey, écrit l’officier de police Gannet dans un rapport, fait allumer les fours et lorsqu’ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations ; il nous a répondu que c’est ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D’abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes, et nous n’avons trop rien dit ; mais aujourd’hui les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et Turreau qu’ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femmes des royalistes manquant, ils s’adressent aux épouses des vrais patriotes. Déjà, à notre connaissance, vingt-trois ont subi cet horrible supplice et elles n’étaient coupables que d’adorer la nation. Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont menacé du même sort ». Dans son courrier adressé les 17 et 26 janvier 1794, Dupuy, capitaine du bataillon de la Liberté, décrit entre autres : « …des militaires républicains porter des enfants à la mamelle au bout de la baïonnette ou de la pique qui avait percé du même coup la mère et l’enfant ». Le chirurgien Thomas écrit : « J’ai vu brûler vifs des femmes et des hommes. J’ai vu cent cinquante soldats maltraiter et violer des femmes, des filles de quatorze et quinze ans, les massacrer ensuite et jeter de baïonnette en baïonnette de tendres enfants restés à côté de leurs mères étendues sur le carreau… ».
Le 27 janvier 1794, Grinon commandant de la seconde colonne infernale, pénètre dans le village de La Flocellière et ordonne un égorgement général de la population. Il n’hésite pas à tuer même les républicains : « Je sais qu’il y des patriotes dans ce pays, note-t-il, c’est égal, nous devons tout sacrifier. » Un patriote et sa servante sont ainsi coupés en morceaux. Cela se reproduira ailleurs.
Le 17 mars 1794 à La Chapelle Bassemer, le nommé Peigné et l’Abbé Robin décrivent : « Ici, par un raffinement de barbarie, peut-être sans exemple, des femmes enceintes étaient étendues et écrasées sous des pressoirs. » (…) « Une jeune fille de La Chapelle fut prise par des bourreaux, qui après l’avoir violée la suspendirent à un chêne, les pieds en haut. Chaque jambe était attachée séparément à une branche de l’arbre et écartée le plus loin possible l’une de l’autre. C’est dans cette position qu’ils lui fendirent le corps avec leur sabre jusqu’à la tête et la séparèrent en deux. » Il y eut encore beaucoup d’autres atrocités ce 17 mars que Peigné appelle la journée du « grand massacre ». Dans d’autres cas, des femmes sont jetées par les fenêtres sur des baïonnettes pointées dans leur direction. Il raconte encore : « A la Pironnière, et en plusieurs autres lieux, des enfants, au berceau, furent transpercés et portés palpitants au bout des baïonnettes » (…). À Angers, on tanne la peau des victimes, afin de faire des culottes de cheval pour les officiers supérieurs. Un témoin, le berger Robin raconte que les cadavres « étaient écorchés à mi-corps parce qu’on coupait la peau au-dessous de la ceinture, puis le long de chacune des cuisses jusqu’à la cheville des pieds de manière qu’après son enlèvement le pantalon se trouvait en partie formé ; il ne restait plus qu’à tanner et à coudre. » Ces hommes ne faisaient que suivre Saint-Just qui, dans un rapport en date du 14 août 1793, à la Commission des Moyens extraordinaires déclare : « On tanne à Meudon la peau humaine. La peau qui provient d’hommes est d’une consistance et d’une bonté supérieure à celle des chamois. Celle des sujets féminins est plus souple, mais elle présente moins de solidité… ». À Clisson encore, des soldats du général Crouzat brûlent 150 femmes pour en extraire de la graisse. Un soldat raconte : « Nous faisions des trous de terre pour placer des chaudières afin de recevoir ce qui tombait ; nous avions mis des barres de fer dessus et placé les femmes dessus, (…) puis au-dessus encore était le feu (…). Deux de mes camarades étaient avec moi pour cette affaire. J’en envoyai 10 barils à Nantes. C’était comme de la graisse de momie : elle servait pour les hôpitaux ».
Dans les prisons de Nantes, en raison de la déplorable tenue des lieux et du mauvais régime alimentaire, une épidémie de typhus s’y déclare : c’est une véritable hécatombe. Un rapport des commissaires Allard, Louis, Chapetel et Robin la mentionne, il est intitulé « Travaux pour les inhumations et enfouissements des animaux crevés ».