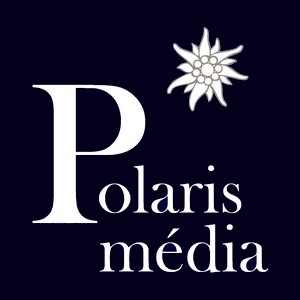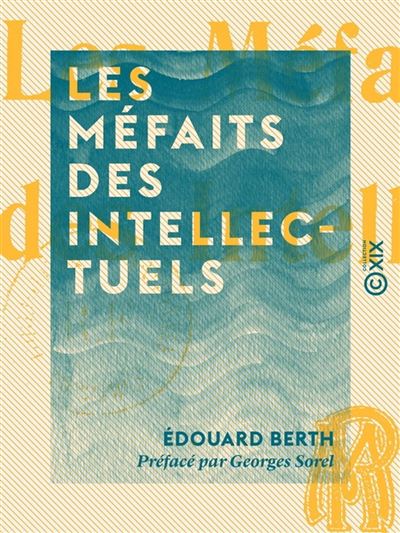
Être un intellectuel n’est évidemment pas en soi une tare. Polaris média est une expression intellectuelle et érudite, et ses lecteurs sont des personnes douées d’intelligence. Ce qui est à juste titre moqué et dénoncé par le terme, c’est l’intellectualisme « progressiste » de la gauche. François Mitterrand, fraîchement élu président de la République en 1981, et invité par Margaret Thatcher au Royaume-Uni, demanda à y rencontrer des intellectuels. Les services du 10 Downing Street répondirent avec une savoureuse ironie qu’ils pouvaient trouver des écrivains, des historiens, des philosophes des chercheurs, mais pas d’intellectuels. L’intellectuel est une spécialité « made in France ». Le terme lui-même est hérité des remous de l’affaire Dreyfus. En réalité, il n’y a pas de régimes plus corrompus et totalitaires que ceux où les « Intellectuels » à la française détiennent une place trop considérable.
D’autres auteurs ont noté ce travers systématique des « intellectuels » à embrasser systématiquement les mauvaises causes, dont Daniel dans son essai Les Intellos ou la dérive d’une caste – de Dreyfus à Sarajevo (Éditions L’Âge d’Homme, 1995), dont nous ferons sans doute une présentation. De l’essai de Berth publié en 1914, nous mettons en exergue les pertinents extraits suivants sur divers sujets, ayant emporté notre intérêt :
Prolongement d’un instinct primitif universel, la guerre est, encore à l’heure actuelle, la seule école d’énergie qui soit accessible à tous sans exception.
L’aristocratie véritable n’est nullement constituée par des qualités purement intellectuelles ; elle est guerrière et héroïque, elle est traditionnelle, elle est historique ; elle s’appuie sur des réalités charnelles, le sang, l’hérédité physique, la race : rien de plus « anti-intellectuel » qu’un aristocrate digne de ce nom ; et ce qui, historiquement, perd les aristocrates, c’est précisément lorsque le noble, quittant la Terre pour la Ville et la Cour, et passant du régime de la guerre à celui du spectacle, devient un « intellectuel », un bel-esprit, comme au XVIIIe siècle ; il se mue alors en un « démocrate » qui, perdant le sens des réalités traditionnelles, se trouve à la merci de toutes le billevesées et nuées idéologiques des sociétés en décadence.
L’idée sociale ne peut guère revêtir que deux formes : elle est militaire ou ouvrière ; elle ne peut être bourgeoise. La Cité antique fut une Cité héroïque, dont toutes les institutions gravitaient autour de la Guerre, source et principe de toute vertu. C’est plus récemment autour des Institutions du Travail, comme ciment, que s’est réédifiée la Cité moderne ; ce sont les exigences du Travail qui ont perpétué au cœur des hommes cet héroïsme dont l’antiquité nous a offert les premiers exemplaires admirables.
Quels sont les caractères de l’État démocratique moderne ? C’est un État abstrait, centralisé, pacifiste en ce sens qu’il s’arroge et agrège aux fonctions qui étaient initialement propres à l’État, fonctions toutes relatives à sa nature guerrière (armée, diplomatie, justice), des fonctions étrangères et parasitaires, des fonctions économiques et administratives, dont il s’acquitte d’ailleurs fort mal et qu’il devrait laisser à l’autonomie de la société civile ; cet ogre jacobin aux mains d’une oligarchie dont la démocratie n’est qu’un masque, est un État, qui, de guerrier, est devenu pacifiste, politique, économique, par une subversion anormale de sa véritable nature. Pacifiste, sauf contre son propre peuple s’il prend à ce dernier d’oser contester la voie où l’on veut le mener. La démocratie bourgeoise a toujours fourni d’excellentes brutes pour écraser la plèbe. C’est contre l’hypertrophie de cet État, de cet énorme Parasite, que le premier syndicalisme avait engagé la lutte. Ce temps est révolu en réalité ; depuis 1945 le syndicalisme a trouvé intérêt à devenir systémique ; son utopie internationaliste le fait adhérer pleinement à la société « melting-pot » chère aux intérêts du patronat apatride et, dans le ballet de la social-démocratie, il gère le troupeau en connivence, dans une entente douce, avec les structures de l’État.
Qu’arrive-t-il lorsque l’État s’attarde dans les services qu’il a lui-même créés et cède à la tentation de l’accaparement ? Il devient une vaste compagnie anonyme qui, au lieu de servir les citoyens et les communes, les dépossède et les pressure. Bientôt, la corruption, la malversation, le relâchement entrent dans ce système ; tout occupé à se soutenir, d’augmenter ses prérogatives, de multiplier ses services et de grossir son budget, le pouvoir perd de vue son véritable rôle, tombe dans l’autocratie et l’immobilisme ; le corps social souffre, et la nation, à rebours de sa loi historique, commence à déchoir.
On n’a pas assez remarqué combien la nouvelle mentalité laïque, pacifiste et démocratique, impliquait de niaiserie psychologique, d’ingénuité désarmante, de candeur insondable. Aujourd’hui, on est frappé de la vulgarité générale des esprits, de leur niaiserie, de la facilité avec laquelle ils admettent des raisonnements de la plus grossière qualité logique et des idées de la plus grossière qualité psychologique. Ce qui est au premier plan, c’est une France abêtie.
L’éducation classique laissait inévitablement comme un appétit insatiable de grandeur héroïque. Les yeux qui ont aperçu et contemplé la lumière antique ; l’âme qui a été soulevée par le souffle large, fort et libre de la Cité antique ; l’esprit qui a reçu les leçons d’art, de philosophie et de Droit d’Athènes et de Rome – ces yeux, cette âme, cet esprit ne peuvent plus s’habituer à la médiocrité et cherchent infatigablement la grandeur historique. Voilà pourquoi, précisément, la Démocratie, qui n’aime que le médiocre, a voué aux études classiques cette haine basse qui est la haine de l’envie et de la médiocrité impuissante.
Dans le régime actuel les grandes écoles n’ont été établies que pour former une pépinière « d’aristocrates de la production », et l’école primaire, gratuite et obligatoire instituée que pour donner au peuple cette instruction rudimentaire, à base idéologique, qui fera de l’ouvrier ou du paysan, du « sans-dents », un robot téléguidable capable seulement de bien voter pour les seigneurs intellectuels de la démocratie unitaire, centralisé et bourgeoise.
Ce qui caractérise essentiellement l’anarchisme individualiste traditionnel, c’est la négation farouche de l’État, de toute autorité sociale, de tout gouvernement, c’est l’opposition violente et irréductible qui fait de l’individu et de l’État deux forces à tout jamais antagonistes. Mais quelle est l’origine psychologique et sociologique de cette négation de l’État par l’anarchisme individualiste traditionnel ? On a souvent observé que les anarchistes individualistes se recrutaient surtout dans les pays qui se sont caractérisés au point de vue économique par la prédominance de la petite propriété agricole, et au point de vue politique par le développement de l’étatisme. Or, précisément, ce qui caractérise l’anarchisme individualiste traditionnel, c’est : 1° un amour extrême de la liberté, mais de la liberté conçue comme une sorte d’indépendance naturelle, présociale, et pour qui toute communion sociale est attentatoire et fâcheusement limitative – et cet amour de la liberté, ainsi conçue, est tout naturel chez des êtres habitués, comme les petits paysans, à vivre isolés sur leur lopin de terre, sans relations, ou presque, avec le monde social extérieur, se suffisant à eux-mêmes et craignant toute irruption de l’étranger, en qui facilement ils aperçoivent un ennemi. C’est : 2° un antiétatisme farouche, pour qui tout État est l’ennemi-né de l’individu et de la liberté. Mais si, précisément, l’étatisme s’est développé dans les pays à petite propriété agricole, s’il a été le complément nécessaire de cet extrême atomisme social que constitue cette poussière d’individus juxtaposés dans des villages eux-mêmes simplement juxtaposés les uns aux autres dans tout le pays, l’antiétatisme anarchiste s’explique tout naturellement, il est la réaction naturelle de cet isolé, de ce sauvage, qu’est le paysan parcellaire, contre cet organisme de l’État avec qui il voudrait n’avoir jamais affaire et qui vient lui prendre son temps (hier avec la conscription, aujourd’hui avec les contraintes administratives) et son argent pour des services généraux et une civilisation auxquels il reste étranger.
Si nous passons maintenant de la petite propriété paysanne à la grande fabrique capitaliste, nous sommes transportés dans un monde tout différent. Ici, nous ne trouvons plus des isolés, farouchement retirés dans la solitude de leur travail parcellaire et pour qui la vie sociale se réduit, ou presque, à la famille, au voisinage, au village ; ici, nous trouvons de vastes agglomérations d’hommes, une vie collective, presque une vie en commun ; l’individu disparaît dans la collectivité, et le travail est une coopération vaste, où chaque effort individuel se subordonne à l’effort total et à un plan d’ensemble nettement déterminé. Et si, sur cette base économique, il se développe une philosophie de la vie, ce ne sera plus, évidemment, ce ne pourra plus être l’individualisme farouche de l’anarchiste, mais, au contraire et tout naturellement, son antidote, sa contradiction même, à savoir le communisme le plus complet.
Ce qui caractérise essentiellement la fabrique capitaliste, c’est que le plan de division du travail, ce plan auquel les salariés sont soumis, apparaît comme la propriété du capital et est revendiqué par lui comme telle. Le capitalisme a groupé dans ses grands centres d’activité de véritables armées de travail qu’il a soumises à une discipline autocratique et pour ainsi dire militaire. Et d’où sont venus ces salariés ainsi groupés ? Initialement, à partir de la Révolution industrielle, c’étaient souvent de petits paysans parcellaires dépossédés, expropriés, arrachés violemment au sol, habitués par conséquent au travail solitaire, et qu’il a fallu plier au travail collectif, ce qui n’a pu se faire sans une rude discipline autocratique. Le capitalisme a été obligé de vaincre l’esprit d’insubordination, l’anarchisme individualiste de ces masses nouvellement ouvrières habituées jusque-là au travail et indépendant de la terre. Le capitalisme a été un « éducateur » brutal.
Ce qui caractérise la fabrique capitaliste, c’est donc cette discipline extérieure, autocratique, militaire, que le capitalisme impose au salarié. L’« atelier capitaliste » est une coopération, mais une coopération toute mécanique, une coopération où la volonté des coopérateurs n’est pour rien, une coopération dont l’idée directrice est extérieure aux coopérateurs eux-mêmes, soumis à un plan qui est l’expression de la volonté du Maître. Il n’y a donc pas véritable association. Il y a « fusion mécanique » des volontés, il y a juxtaposition des unités individuelles transplantées, historiquement, de la petite propriété agricole dans l’atelier capitaliste ; la fabrique capitaliste constitue comme un corps dont l’âme lui serait extérieure, une sorte d’automate, par conséquent, dont la volonté capitaliste fait toute l’unité.
Et que faudrait-il pour que la fabrique perdît son caractère capitaliste et prît un caractère socialiste ? Il faudrait précisément que cette volonté extérieure du capital fût, en quelque sorte, résorbée par le corps des travailleurs ; il faudrait que cette âme de l’atelier, qui jusqu’ici a été la volonté du maître, descendit dans ce corps et l’animât ; il faudrait que cette fusion mécanique d’individus juxtaposés brutalement du dehors devînt un véritable organisme, et que cette discipline extérieure, autocratique et militaire, à laquelle le capital a dû soumettre de force les salariés, se transformât en une discipline intérieure, libre et consentie. Et c’est à cette transformation que, justement, devrait travailler le syndicalisme au lieu de se soumettre au fonctionnement systémique.
Mais les « marxistes orthodoxes » ne l’entendent pas ainsi. Et comment entendent-ils l’émancipation salariale ? D’un mot : ils veulent, au fond, la simple transplantation mécanique des salariés de l’atelier capitaliste dans l’atelier étatique. C’est l’idée purement marxiste orthodoxe de Louis Blanc, Secrétaire du gouvernement provisoire, qui sera réalisée à Paris en mars 1848 (pour une durée de trois mois avant fiasco) par la création des Ateliers nationaux.
L’individu anarchiste reste un homme pour qui la société signifie forcément une limitation de l’indépendance personnelle. Au contraire, l’individu du « marxisme orthodoxe », c’est plutôt l’homme du troupeau, noyé dans de grands systèmes collectifs, immergé dans de larges courants communistes ; la personnalité, l’individualité semblent avoir disparu ; des idées de caserne, de couvent, viennent naturellement à l’esprit : combien de fois n’a-t-on pas reproché au collectivisme d’être l’encasernement universel ! On comprend donc l’horreur des anarchistes pour le collectivisme ; mais qu’on y prenne garde, l’opposition n’est que formelle : car le collectiviste, cette homme de troupeau soi-disant, ne rêve au fond qu’une chose : échapper à la société pour recouvrer sa liberté, pour reconquérir son indépendance ; ce collectiviste est, lui aussi, un anarchiste individualiste, et s’il se sert de la société et de l’État, c’est pour créer des conditions sociales de vie telles qu’il puisse retourner à l’état de nature.
L’individu ne « prête son être » à la société via le monde du travail que quelques heures quotidiennes : qu’importe que la société le mécanise pendant ce laps de temps, si, une fois sorti de l’atelier, du bureau, il recouvre l’enivrement de sa liberté abstraite ? Il ne demande qu’une chose à la société : le bien-être, c’est-à-dire de quoi pouvoir se procurer des loisirs riches de jouissances personnelles. Au fond, il troque sa liberté contre du bien-être ; à l’atelier, au bureau, pour quelques heures, il n’est plus qu’une chose ; qu’on fasse de lui ce que bon semblera, que l’arbitraire administratif se déploie à sa guise : le bureaucrate, le fonctionnaire – et dans ces conceptions l’ouvrier n’est plus qu’un fonctionnaire – se console des humiliations que lui a fait subir la hiérarchie administrative en rêvant à sa liberté prochaine ; il plie l’échine pendant quelques heures, pensant bien la redresser bientôt, en toute liberté, dans la fierté de sa solitude ! Et toute dignité sociale s’évanouit, le sentiment du droit disparaît, le mécanisme administratif broie les caractères et fait des hommes dont la timidité et l’effacement pratiques n’ont d’égal que la hardiesse abstraite et spéculative.
L’État moderne est une œuvre d’uniformisation qui avait été ébauchée par l’administration royale et à laquelle la Révolution et l’Empire vinrent mettre la dernière main. Mais ici, l’État uniformisé, une fois constitué, veut tout régenter, il ne souffre plus à côté de lui aucune vie indépendante, regarde avec une inquiétude jalouse toute association privée, en un mot, veut tout absorber en lui, débarrassé qu’il est de la diversité de la féodalité. La centralisation étatique devient énorme, écrasante ; l’abstraction sociale prend des proportions formidables ; il n’y a plus d’autre vie collective que la vie étatique ; l’État-monstre dévore tout, groupes et individus, et se transforme en un instrument de croissante servitude collective.
Qu’est-ce que l’économie échangiste, par rapport à l’économie dite naturelle ? Dans l’économie naturelle, chaque producteur reste enfermé dans son horizon familial, produisant, non pour un marché, mais pour sa propre consommation ; il est dans l’autosuffisance, l’autarcie ; c’est le particularisme dans le domaine de la production. Mais dès que l’échange se développe, dès qu’un marché d’abord régional, puis national, puis international, se constitue, où les producteurs, sortant de leur isolement, viennent échanger leurs produits et pour lequel ils produisent, tout change : à la production particulariste, concrète, pour ainsi dire, sensible et « artistique », succède une production sociale, abstraite, scientifique, par grandes masses ; la société présente l’aspect d’une énorme accumulation de marchandises, et les marchands, c’est-à-dire les innombrables variétés de ce que l’on a appelé les intermédiaires, dominent les producteurs ; ce sont les marchands, possesseurs d’or, qui ont promu le capitalisme, fondé les manufactures et donné le branle à ce développement formidable des forces productives, auquel l’humanité assiste depuis le XVIe siècle.
Avant la montée en puissance des États-Unis, l’Angleterre est, incontestablement, le pays « marchand » par excellence, une sorte de grande Carthage moderne, la terre classique du « libre-échange » et des théories manchestériennes, en vertu desquelles le monde est conçu sous l’aspect commercial, comme un vaste marché, au contact duquel tout se dissout et où les hommes ne sont plus que des « porteurs de marchandises » ; et, en même temps, on peut dire que c’est le pays où le christianisme a pris sa forme la plus particulièrement bourgeoise, le protestantisme : le bourgeois anglais est préoccupé au même titre des intérêts de sa conscience et de sa caisse ; le « business man » et le Tartuffe protestant peuvent loger dans la même peau.
Le parlementarisme est une chose d’importation anglaise. L’Angleterre est la terre classique du parlementarisme, comme elle l’est du capitalisme marchand. On peut comparer le Parlement à un marché : les partis ne sont que des entrepreneurs qui font l’échange d’un certain stock de voix contre certains avantages ; et ce qui sort de ces combinaisons de mercantis, c’est ce qu’on appelle la Volonté générale, la Loi, divinité du monde marchand moderne.
La démocratie parlementaire, n’est-ce pas le droit divin – ou la puissance magique de l’État – passé du roi aux partis chargés de traduire la soi-disant souveraineté du peuple ? La loi, qui émane de nos parlements modernes, est entourée d’un respect plus superstitieux que ne l’ont jamais été les rois les plus absolus et l’on peut dire que le légalitarisme moderne est plus asservissant encore que l’ancien loyalisme.
L’employé, le petit boutiquier, le petit fonctionnaire, l’ouvrier à demi-embourgeoisé – cette clientèle née des partis démocratiques, cette plèbe des villes, des désirs modestes et de vie médiocre, à qui le socialisme d’État va comme un gant…
Personne ne niera, je suppose, que la France soit le pays le plus étatisé, le plus centralisé, le plus intellectualisé, le plus sécularisé et laïcisé de la terre ; aucun esprit normalement constitué non plus ne niera que ce soit ici que la décadence sociale moderne soit le plus avancée et où la volonté soit la plus malade. Certes, on ne voit pas qu’ailleurs dans le monde occidental les mœurs soient beaucoup plus solides. Il y a partout, dans tout notre monde moderne, bien des signes de dissolution morale et de détraquement. Nous avons seulement le privilège d’être plus avancés dans la voix de la décomposition, parce qu’une funeste majorité de Français ne se plaît que dans l’inversion des normes et la subversion des esprits.