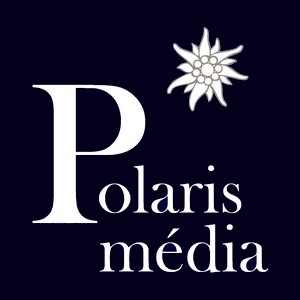« Tout ce qui est laid affaiblit et afflige l’homme. Il rappelle la décadence, le danger, l’impuissance ; il subit en réalité une perte d’énergie en sa présence. L’effet du laid peut être mesuré avec un dynamomètre. Chaque fois que l’homme se sent déprimé, il ressent la proximité de quelque chose de « laid ». Son sentiment de puissance, sa volonté de puissance, son courage, sa fierté – ils diminuent avec le laid, ils augmentent avec le beau. » – Friedrich Nietzsche.
L’appréciation de la beauté et de la laideur par l’être humain est un sujet énigmatique et passionnant. Pour quelle raison sont-ce tel trait, telle forme, tel détail, tel aspect, qui ont été installés comme agréables ou désagréables dans notre perception, et pas leurs contraires ? Umberto Eco a traité de ce sujet dans ses deux volumes Histoire de la Beauté et Histoire de la Laideur. En lien avec cet extraordinaire sujet, nous associons également la beauté au bien, et la laideur au mal. Tout comme la beauté est associée à la liberté. Elle lui est même consubstantielle selon Philippe Nemo dans Esthétique de la Liberté. La contrainte n’a jamais accouché que de choses laides.
Est-ce que nous associons la laideur au mal parce que dans l’histoire de l’humanité notre perception a été ainsi orientée par des critères arbitraires et inconscients, ou bien la laideur est-elle en vérité tout autant consubstantielle du mal, que la beauté est consubstantielle de la liberté ? Tous les laids ne sont pas de mauvaises personnes, et tous les beaux ne sont pas des modèles de bonté. Mais nous avons probablement tous eu l’occasion de constater un jour autour de nous que, parmi ce que produit le genre humain, de basses facultés intellectuelles vont souvent de pair avec un physique ingrat.
Quoi qu’il en soit, on peut en tout cas à minima noter de façon aussi surprenante qu’incontestable dans l’histoire, la reproduction de plusieurs épisodes de même nature, des événements parents par l’idéologie, et dans lesquels de fait l’on trouve pour point commun l’association au mal de la médiocrité, de la laideur et de la vulgarité. On peut citer pour l’exemple cinq de ces cas, en l’occurrence la Révolution française de 1789, la révolution bolchevique, la Guerre d’Espagne, la persécution des intellectuels sous la révolution culturelle maoïste, et son équivalent chez Pol Pot. Ce type de situations, d’époques troublées, sont à chaque fois l’occasion de voir les médiocres, la laideur, et la vulgarité, promues, se tailler des places et des postes, avec leurs cortèges d’horreurs. La rancune des disgraciés à l’égard du destin, trouvant un terrain d’expression vindicative par la méchanceté contre leurs contemporains, n’est pas chose nouvelle. Elle a certainement été observée de longue date dans la nature humaine. Le sujet est bien sûr présent dans la littérature et le cinéma. Dans Le Capitan, par exemple, André Hunebelle fait dire au nain alchimiste fabricant de poisons Lorenzo, interprété par Piéral : « la nature m’a joué un vilain tour, et je n’ai pas fini de le lui rendre ». Dans le catalogue des psychopathologies que constitue la galerie des « méchants » dans Batman, le personnage du Pingouin en est une autre éloquente illustration.
Selon Xavier Martin (La France abîmée), les puissants du jour sont souvent des médiocres. Fulgurante promotion des médiocres ? Ce n’est pas un mystère qu’en période d’éruption révolutionnaire, le cas est répandu, – citons Olympe de Gouges – de ces gens que l’on voit « profitant d’un temps de trouble pour être enfin quelque chose ». Elle visait en l’affaire, de façon précise, ce membre de la municipalité révolutionnaire parisienne qui prétendait censurer une de ses pièces de théâtre, « juge d’affaires contentieuses et d’affaires où il est question de procédés honnêtes ! La plaisante magistrature ! Mais à quel titre cet homme est-il aujourd’hui quelque chose ? » demandait-elle. A quel titre ? Au titre du désordre subversif ambiant. Car maintes personnes qui ont à se venger de la nature, ou de leurs échecs, sautent sur cette occasion d’exercer des pouvoirs qu’en l’occurrence recherchent peu les honnêtes gens. Camille Desmoulins lui-même, sous l’Ancien Régime ? : un avocat bègue et sans clientèle (Histoire et Dictionnaire de la Révolution française, p.965). Stanislas-Marie Maillard, dit Tape-Dur, l’un des maîtres d’œuvre des massacres de septembre 1792 ? : clerc d’huissier, il n’en est pas moins un raté, un ivrogne aux moyens d’existence aléatoires, souvent arrêté pour de menues escroqueries ou des querelles chez les marchands de vin. Mathieu Jouve Jourdan, dit Coupe-Têtes, boucher, tyran du Vaucluse ? : après une jeunesse de paresse et de brigandage, un instable chronique qui avait fait faillite en septembre 1789. Quelques autres noms ? : Fouquier-Tinville, assez médiocre chicaneau d’Ancien Régime, qui vient en stakhanoviste de la guillotine transcender sa nouvelle fonction d’infatigable accusateur du tribunal révolutionnaire. Dumas et Coffinhal ? : le premier assumait la présidence du même tribunal, avocat sans cause, « d’une figure peu avantageuse » (c’est son autoportrait cité dans Histoire et Dictionnaire de la Révolution française, p.778). En « jugeant » sans compter, en condamnant en masse et pour n’importe quoi, il aura « compensé ». On en fait également l’hypothèse pour le vice-président Coffinhal son collègue. Décrit aux yeux noirs couverts de sourcils, le teint jaune et atrabilaire portant l’effroi dans les âmes des accusés, il était antérieurement procureur au Châtelet, « mais son étude était peu accréditée et il vivait dans la gêne quand commença la Révolution » (cité dans Dictionnaire de Biographie française, colonne 127, et dans Histoire et Dictionnaire de la Révolution française, p.658). Entre cent noms, on songe encore au conventionnel André Dumont, relativement auquel il nous est indiqué que « la Révolution, qui semblait faire appel à tous les gens turbulents, nécessiteux et sans principes, trouva naturellement un partisan dans un procureur sans clients » (un de plus, cité dans Une Anglaise témoin de la Révolution, p.109, à la date du 6 janvier 1794). Marat, chez lequel il y a du savant raté, que la nature au demeurant a disgracié.
Sous la Révolution, l’encanaillement, le « débraillé », la vulgarité, sont une affaire qui marche, corrélative à ce penchant global à la médiocrité et à la saleté qui tiendrait à marquer selon certains échos plus ou moins convergents, les animateurs révolutionnaires en ébullition. Quant à Grégoire, il rappelle le temps où les extrémistes républicains « mirent presque la propreté et la décence au rang des crimes contre-révolutionnaires ». Il pourrait dire, tout simplement : la politesse. Certains ne s’en privent guère. « Le mépris de toute convenance, la grossièreté dans le langage et les manières, devinrent sous leurs auspices les caractères du patriotisme. La politesse, l’urbanité, les égards furent proscrits comme des restes d’esclavage ». Saint-Just tient que « la grossièreté est une sorte de résistance à l’oppression ». On ne peut au passage que remarquer la parenté, la similitude entre tout ceci et le physique, l’attitude, des figures de La France Insoumise mélenchoniste dans et hors l’hémicycle de l’Assemblée nationale. L’effet d’altération, sur la nation française, de cette ambiance débilitante du « débraillé » qui s’imposait par la terreur ne saurait guère prête à doute. Mme de Staël observe que « la vulgarité du langage, des manières, des opinions » ne peut que « faire rétrograder » pour « plusieurs années », sous dives rapports, ce qu’elle appelle « le goût et la raison ». En quoi ladite vulgarité est tout à fait en synergie, si l’on peut dire, avec l’atmosphère de médiocrité, dont force est d’observer qu’elle se distingue peu. Quinze jours après la décapitation de Marie-Antoinette, le mot Monsieur fut proscrit, et les révolutionnaires interdirent le vouvoiement (assimilant dans une bêtise crasse, politesse et marqueur de catégorie sociale, comme si la politesse était du monde aristocratique et qu’il était anormal que tout un chacun soit poli avec son voisinage, sacrifiant ainsi la politesse au profit du comportement familier sur l’autel de l’égalitarisme idéologique. La « prime » conjoncturelle à la médiocrité ? De façon globale, les contemporains les plus avisés l’ont enregistrée. Mme de Staël encore : « Voyez les hommes cruels ; ils sont, pour la plupart, dépourvus de facultés. Le hasard même a frappé leur figure de quelques désavantages repoussants ; ils se vengent sur l’ordre social, de ce que la nature leur a refusé ». La laideur insigne des agitateurs révolutionnaires est souvent notée – y compris quelquefois par eux-mêmes – dans un contexte où l’apparence physique et la fibre morale sont censées être assorties de façon strictement « nécessaire » (sur ce thème voir l’étude de T.Gorilovics, La Révolution et ses monstres). La laideur de Marat fit proverbe. Selon Edouard Drumont, son nom véritable était Mara. Sa famille avait été chassée d’Espagne, s’était réfugiée en Sardaigne, puis en Suisse et, ne pouvant pas s’avouer ouvertement juive, s’était fait protestante. On trouve pire, paraît-il. Gilbert Romme à son procès, père notamment du calendrier révolutionnaire, et l’un des martyrs de prairial an III, dont Voronokine, un miniaturiste, a consigné en 1788 un visage très ingrat. Naturellement plus laid que Marat, ses traits inspiraient l’aversion et le dégoût » (Aimé Jourdan dans le Moniteur n° 274, 4 messidor an III). Les disgraciés de la nature quant au physique et/ou au moral ont voulu se venger sur les mieux pourvus sous tous les rapports : cette « évidence » commodément explicative a logiquement pignon sur rue. « Les plus difformes de la bande, prétend Chateaubriand, obtenaient de préférence la parole. Les infirmités de l’âme et du corps ont joué un rôle dans nos troubles : l’amour-propre en souffrance a fait de grands révolutionnaires » (Mémoires d’Outre-Tombe, p. 120). […] « Dans l’immensité de leur fureur », note Daunou également peu après Thermidor, les barbares jacobins, s’ils « ont promené leur glaive homicide » sur toutes les catégories de citoyens, « l’ont dirigé de préférence sur les talents distingués, sur les caractères énergiques ». « Malheur à celui qu’un talent, qu’une réputation quelconque mettait en évidence », viendra confirmer Fabre d’Olivet. Toujours et partout, la Révolution a utilisé les brutes et la canaille en hommes de main, en exécuteurs des basses œuvres. Les têtes pensantes, les idéologues, ne se salissent jamais les mains personnellement.
Reprenons un instant les termes de Fabre d’Olivet : « Malheur à celui qu’un talent, qu’une réputation quelconque mettait en évidence ». Pas de différences, égalitarisme intégral et nivellement. Mais nivellement jacobin, par le bas, reproduit à partir des délires de Rousseau qui, dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (seconde partie (page 52 de la collection classiques Garnier : Œuvres politiques) déclarait :« Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit, ou le plus éloquent, devint le plus considéré ; et ce fut là le premier pas vers l’inégalité et vers le vice ». En associant l’inégalité et le vice, il associait de facto aux vices les hommes véritablement supérieurs par telle ou telle de leurs aptitudes. Pour supprimer le vice, il faut donc selon cette « logique » éliminer l’inégalité, donc la conscience que l’on a de la supériorité de certains hommes, donc cette supériorité elle-même, c’est-à-dire ces hommes supérieurs eux-mêmes. Porte ouverte à la chasse et à l’extermination.
Ces délires de Rousseau, c’est le lit de Procuste : dans la Grèce classique, les aèdes contaient qu’un odieux personnage du nom de Procuste (ou Damaste) attirait les voyageurs dans sa demeure où se trouvaient un grand lit et un petit lit. Il obligeait les petits visiteurs à se coucher dans le grand lit, et les grands à se coucher dans le petit lit. Puis il les étirait, ou leur coupait les membres, afin de les mettre à la dimension de leur couche. Nul n’en réchappait jamais. L’ayant vaincu, Thésée le fit mourir en le soumettant au même supplice. Pour saisir l’importance de ce mythe, il convient de se rappeler que toute philosophie politique se développe selon une logique interne inexorable. Les dirigeants de la révolution de 1789, invoquant la philosophie des « Lumières », se sont fixé un double but : détruire l’homme ancien, qu’ils considéraient défiguré par la tyrannie royale et la superstition religieuse, puis créer un Homme nouveau : l’Homme social. « Il faut en quelque sorte recréer le peuple qu’on veut rendre à la liberté » (Billaud-Varennes). « Nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière » (Carrier). Ce dernier propos a le mérite de la clarté, Carrier aurait au besoin commis partout les atrocités qu’il infligea aux Vendéens. Mais quel Homme nouveau avaient-ils en vue ? En définitive un être à la mesure de leur discours, purement abstrait et irréel, dépourvu d’âme et de personnalité. Non pas un individu vivant sa destinée propre, mais un citoyen relevant de l’État comme la fourmi de la fourmilière. Un être semblable à ces peintures contemporaines, où le visage est tout juste évoqué par une tache blanche. La Révolution française a été la matrice des totalitarismes du vingtième siècle, lesquels ont tous vanté le concept d’Homme nouveau, l’idée de la construction d’une humanité nouvelle. Sous la révolution bolchevique, on a vu exécuter des gens simplement parce qu’ils n’avaient pas les mains calleuses. Au Cambodge, Pol Pot a cherché à éliminer les citadins et les intellectuels dans le but de créer une humanité nouvelle à partir des ruraux, ces « bons sauvages » de Rousseau. En dépit de ce drame humain, l’actualité du mythe de Procuste semble encore méconnue. Sa mise en garde contre la logique interne de tout système qui cherche à créer un homme nouveau reste incomprise. Lit de Procuste pris pour devise par Gracchus Babeuf et les penseurs de 1789 dans leur idée de « recréer » le peuple, en éliminant les adultes n’ayant pas les dimensions idéales du dit lit, notamment les plus cultivés, les plus sages, les plus savants.
Foucroy, avec l’autorité du savant reconnu, ne se privera pas d’évoquer bientôt « cette désastreuse époque où l’esprit, les talents, les lumières, la philosophie, le savoir, étaient devenus des titres de proscription et des droits à l’échafaud », où « toutes les lumières étaient repoussées, les hommes de lettres, les savants désignés comme coupables, ou marqués comme suspects et voués au supplice ; où la grossièreté de langage, la rudesse des manières, si contrastantes avec l’aménité française, l’ignorance même des premières notions humaines, étaient vantées comme des vertus républicaines ; où, pour échapper à la proscription, les hommes qui s’étaient déjà distingués par la culture de leur esprit, mettaient tout leur soin à cacher leurs connaissances ». « Vertus, richesses, talents, industrie (esprit de travail), rappelle-t-on en effet au Conseil des Cinq-Cents, étaient des titres certains de proscription ». L’observation semble générale. Le Bordelais Jean-Baptiste Brochon écrit : « Le sans-culottisme » où l’on était plongé, c’était l’anéantissement de toute délicatesse, de toutes les convenances, le triomphe et la supériorité absolue de la grossièreté sur l’éducation, du fripon sur l’homme honnête, de l’audace la plus cynique sur une vertueuse modestie. En un mot, la France était devenue le vaste cimetière de toutes les qualités de l’esprit, du cœur et de la raison ». Et Portalis récapitule ce qui effectivement, au cœur de la tourmente, ne pouvait pardonner : « La fortune, l’éducation, les qualités aimables, les manières douces, un tour heureux de physionomie, les grâces du corps, la culture de l’esprit, tous les dons de la nature étaient autant de causes infaillibles de proscription ». Louis-Sébastien Mercier s’autorisera cette conclusion : « Nous pensions autrefois qu’il fallait de grands talents pour troubler les Etats ; et que les grands scélérats même étaient doués d’une sorte d’esprit supérieur ; notre révolution nous a prouvé que cette opinion n’était pas toujours vraie. Nous avons vu paraître sur la scène des hommes absolument nuls, qu’on ne connaissait pas la veille, qui sortaient en effet du néant où même de la tombe du mépris ». De façon notable aura émergé, pour édicter « des lois impures », « tout ce qu’il y avait de plus vil et de plus méprisable en fait de style et de raisonnement ». Et Benjamin Constant d’écrire : « Des talents médiocres, unis à des âmes subalternes, se constituent, au nom de la puissance, surveillants de la pensée ».
On se souvient du mot de Coffinhal, encore, avant l’exécution de Lavoisier guillotiné : « La République n’a pas besoin de savants ni de chimistes ». Coffinhal, achétype de la bêtise promue.
Ces vérités historiques sur le lien entre périodes de malheur, disgrâce, laideur, et médiocrité, rappellent enfin un cas précis de la Guerre d’Espagne, où là aussi les porteurs de la révolution bolchevique usèrent de tout ce que le pays pouvait compter de canaille dans les centres de torture républicains. Dans le désordre ambiant, ce sont ces bandes improvisées qui font la pluie et le beau temps à Barcelone. A leur tête, des agitateurs confirmés, dont Manuel Escorza del Val, un être « à l’âme aussi estropiée que le corps », selon les termes de son camarade le ministre Garcia Oliver Surnommé El jorobado (le bossu), Escorza del Val est une espèce de gnome difforme qui se déplace avec des béquilles, juché sur d’énormes talons compensés. Dirigeant de la Fédération anarchiste ibérique, il est à la tête du contre-espionnage de Barcelone où son zèle sanglant lui vaudra les félicitations de Garcia Oliver.