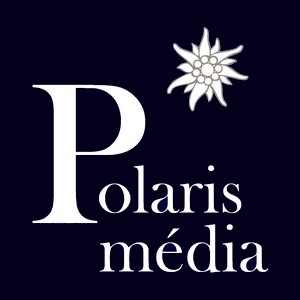Le Païen reconnaît la trifonctionnalité de la société européenne (guerriers, prêtres, travailleurs) et la nécessité d’une élite guerrière, d’une aristocratie pour protéger la communauté. Cela n’en fait pas pour autant un partisan de la monarchie sur notre continent, cette dernière étant adossée à l’Église chrétienne. Ce n’est donc pas par parti pris et militantisme monarchiste que je me suis intéressé à la Révolution française, mais pour répondre à mon insatiable soif de connaissances. L’ayant fait, et dans le souci constant de mettre à disposition d’autrui des connaissances disponibles, ce qui est le maître-mot et la vocation de Polaris média, j’ai souhaité présenter une synthèse de mes nombreuses lectures sur la Révolution de 1789. Car la Vérité n’est pas le manichéisme puéril de la « tyrannie royale » et de la « bonne république », la chose est connue mais il n’est pas inutile de la rappeler. Depuis 1789, de nombreux et éminents auteurs français et étrangers ont tout dit sur la vérité du sujet, sans percer le mur du mensonge en France puisque c’est toujours la version manipulée qui s’impose triomphalement à l’opinion (les outils des vainqueurs, école et médias, n’y sont pas pour rien évidemment). Car l’histoire officielle est toujours écrite par les vainqueurs. Par le fait, la victoire les met en position d’imposer leur discours. Et il n’est jamais conforme à la réalité, toujours à leur avantage et en défaveur du perdant. On sait cela par les vérifications qui émergent ultérieurement. La Vérité est la fille du temps, le mensonge du jour finit invariablement, un peu plus tôt, un peu plus tard, par apparaître pour ce qu’il était. Depuis Sun Tzu, la propagande, la désinformation, le discrédit de l’adversaire, les fabrications, ont toujours fait partie de la perfidie du combat politique. La chose avait aussi été bien perçue et exprimée par Varron (116-27 Av. J.C), « Il est besoin que le peuple ignore beaucoup de choses vraies, et en croie beaucoup de fausses ». Exprimée par Érasme, « L’homme est bâti de manière que les fictions font beaucoup plus d’impression sur lui que la vérité ». La propagande fait appel au niveau le plus primaire de la conscience, celui de l’imagination passive. Pour ne citer que quelques cas parmi les innombrables possibles, qu’il s’agisse de la Guerre des Gaules racontée par Jules César, de la Guerre de Sécession, des bolcheviques et du Tsar Nicolas II, de l’histoire coloniale française en Algérie et de la guerre qui y mit fin, du conflit des Balkans des années 1990, aucun sujet n’échappe à la manipulation orientée des vainqueurs. Absolument aucun sujet, pas même le IIIe Reich. Quand on sait cela, quand on sait que la vérité n’est pas dans le discours officiel, on est naturellement porté à en déduire qu’elle se trouve donc dans le discours de l’autre camp, jusqu’à preuve du contraire.
La bibliographie est surabondante sur le sujet. Mais hormis parmi le public des militants nationalistes, identitaires et des royalistes, qui consent l’effort de la lire ? Quels Français connaissent les détails de ces faits et comprennent vraiment la nature du régime sous lequel ils vivent ? Il est donc indispensable de faciliter à tous, notamment aux plus jeunes, l’accès à la vérité sur ce cataclysme et sa période. Mais il est des choses qu’on ne peut pas dire en vingt lignes. Avec ce sujet, vous vous embarquez sur l’équivalent de 62 pages A4 de lecture. Seuls les plus déterminés jouiront de ces éléments dans leur intégralité. Quant aux fainéants, leur ignorance leur va si bien…
Tout ce qui va suivre s’oppose au discours officiel, dont on vient de préciser la nature manipulatrice. A vous de juger.
Pour comprendre ce qui a amené à la Révolution, on ne peut dans le traitement du sujet faire l’économie de rappeler avant tout quelques aspects de ce qu’était la France de l’Ancien Régime, y compris avec sa part d’anomalies structurelles et d’injustices. Certains détails pourront être connus bien sûr de certains lecteurs, ils seront utiles aux autres.
La noblesse.
Jusqu’en 1789, la notion d’élite sociale n’était pas nécessairement liée à la possession d’argent. Noblesse ne voulait pas nécessairement dire richesse. La République a tout fait pour ancrer l’idée contraire, représentant la noblesse d’Ancien Régime à travers l’exubérante imagerie de Versailles qui n’était pas représentative de l’ensemble. L’immense majorité des nobles menait une vie rude et rustique, pas tellement différente de celle des paysans. Sur les 12.000 familles nobles existant en 1789, environ deux cent cinquante étaient représentées dans les sphères du pouvoir à Versailles ; l’énorme majorité des 11.750 autres vivait en province ; et le plus souvent, plus elles étaient antiques, donc prestigieuses, plus elles étaient pauvres. L’anoblissement tardif et « artificiel » procuré par des moyens financiers permettant d’acheter une charge (dans la noblesse de robe, les fonctions officielles administratives déléguées par le pouvoir royal, magistrature, fisc, etc.) était une chose ; tandis que le petit seigneur de noblesse immémoriale (la noblesse d’épée) était pour sa part issu d’une famille qui, depuis les temps les plus reculés, n’avait pas pour fonction, pas le droit, de travailler, en vertu de la répartition des rôles dans la société établie par la trifonctionnalité indo-européenne (ceux qui combattent, ceux qui prient, et les autres, bellatores, oratores, laboratores comme le formulera le latin). Il consacrait sa vie à la pratique des armes. Quelle est l’origine de ces fonctions tripartites ? Elles remontent à la nuit des temps, aux origines de l’humanité. Dès les sociétés les plus archaïques, les plus primitives, l’homme a eu deux peurs essentielles à résoudre : d’une part la peur de l’inconnu, de l’invisible, des forces occultes, du surnaturel, de tout ce que l’on ne comprend pas, l’angoisse de la question métaphysique de l’existence humaine ; et d’autre part la peur de l’invasion, de l’ennemi, de l’autre clan qui vient en agression et en convoitise. Ces deux peurs ont été constitutives de l’organisation des sociétés les plus élémentaires. Elles ont été les deux « problèmes prioritaires » à régler dans le début d’évolution et d’organisation sociale. D’où la trifonctionnalité indo-européenne. Ces deux peurs primaires expliquent l’émergence de la structure trifonctionnelle, avec en conséquence, les deux premières figures institutionnelles qui ont émergé, d’abord le prêtre puis le guerrier. Parce que celui qui est capable de « résoudre » la peur de l’inconnu par l’élaboration d’une « explication » mythologique, rassurante autant que faire se peut, devient « chef », ou tout du moins émerge du lot et prend un ascendant, devient une figure dans le corps social. La figure du prêtre émerge en premier du fait de l’angoisse de l’homme face à la mort, parce que cette figure résout le problème le plus essentiel qui est de pouvoir entrer en contact avec l’invisible ou le tenir à distance, le « maîtriser », apaiser la colère des forces surnaturelles. Le prêtre assure donc une sécurité émotionnelle, spirituelle à la communauté. Le guerrier, pour sa part, répond à la peur de l’invasion. Il procure donc une sécurité physique à la communauté constituée. Ces deux premières figures, clergé, et noblesse tirée chez le guerrier du fait d’accepter de risquer sa vie pour les autres, répondant à ces deux peurs essentielles, ceux qui ont été capables d’endosser ces deux dangers primaires, se sont naturellement élevés au-dessus des autres et ont logiquement pu obtenir un poste de commandement sur la troisième fonction (producteurs, ouvriers, marchands, tout ce qui n’était ni sacerdotal ni combattant). D’aucuns ont tendance à ne pas aimer le guerrier, parce qu’ils ressentent une infériorité coupable et envieuse du fait que les couilles aient manqué, à eux-mêmes ou à leurs ancêtres il y a très longtemps (eh oui, c’est déplaisant mais il faut admettre cette réalité), pour accepter de risquer et de perdre souvent sa peau en endossant ce rôle de protecteur de tous. Dépassement de soi-même, éventuellement jusqu’au sacrifice. Certains crachent volontiers sur le guerrier, le flic, jusqu’à ce que l’ennemi soit devant la porte. La fonction s’est naturellement transmise de père en fils, comme dans d’autres activités où l’on transmet un savoir-faire et l’outil de travail qui y est associé. Quoi de plus naturel et efficace que d’apprendre de son parent. Contrepartie de son investissement guerrier dans la protection de la communauté, ce petit seigneur de noblesse d’épée ne travaillait donc pas. Ce qui signifie par nécessité qu’il était vaguement entretenu par les autres, mais pas au point d’être riche. L’impôt aujourd’hui paie toujours le flic et le militaire, quoi de changé ? On reconnaissait à tous ces nobles un statut d’élite, qui à vrai dire ne leur apportait qu’une satisfaction de vanité, en échange de quoi il leur était interdit d’exercer une activité lucrative individuelle, car leur statut les obligeait à se tenir au service de la société. Par juste dédommagement, ne pouvant travailler eux-mêmes, ils étaient dispensés d’impôt. D’où provenaient alors leurs possibles possessions foncières ouvrant à exploitation agricole ? D’abord d’acquisitions faites à l’occasion de combats bien sûr, et de territoires confiés à leur protection par l’instauration de la féodalité rendue indispensable au moment des invasions du Xème siècle, parce que le pouvoir central n’était plus capable de protéger la population sur tout le territoire et qu’il lui fallait bien recourir localement à des personnes acceptant de s’en charger. Mais noblesse n’était donc pas synonyme à 100 % de richesse. Aujourd’hui, sous la République, seul l’argent, la possession des richesses, permet à un citoyen d’être « distingué » (et souvent de s’investir en politique). Quel est son mérite ? Il a de l’argent. On peut trouver davantage vertueux le principe ancien qui conduisait à distinguer les hommes en dehors des questions d’argent, en dehors du matérialisme qui nous ronge aujourd’hui. Il suffit de lire des inventaires de succession dans l’immense majorité des familles nobles d’avant 1789 pour se rendre compte qu’ils vivaient modestement, et parfois pauvrement. De génération en génération, on constate le même état de non-fortune. Parce qu’ils étaient d’ancienne noblesse d’épée, ils vivaient d’autant plus modestement, car depuis longtemps ils étaient écartés des circuits de l’argent. C’est la situation modeste de la plupart des nobles d’avant 1789. Les membres de la famille Richaud, à la convocation des états généraux de 1789, se présentent en costume paysan, rapière rouillée au côté, à Romans, comme en font état les archives. En compensation, répétons-le, ils ne payaient pas d’impôt. Mais libre à eux de rompre ce lien, et de vouloir s’enrichir par le commerce comme les bourgeois : mais alors ils « dérogeaient », ils quittaient l’état de noblesse. La plupart étaient trop attachés à cette vanité, et ils préféraient rester pauvres et servir pour seulement conserver cette fierté familiale. Reconnaissons que le défaut de la noblesse était de pouvoir susciter parfois chez son détenteur un sentiment de supériorité congénitale, qui en quelque sorte serait comparable à un racisme de classe. Mais l’institution nobiliaire, ce n’était rien d’autre que la méritocratie. Et le système était ouvert. Les anoblissements étaient nombreux, fondés sur le mérite d’un individu. Mais il ne faut pas croire non plus qu’un noble demeurait nécessairement au même rang que son père. S’il était médiocre, il baissait dans la société. Même si l’état de guerre ou la nécessité de se défendre n’étaient heureusement pas permanents, la justification de l’existence nobiliaire jusqu’en 1789 peut se résumer à ceci : mieux vaut avoir un guerrier dans un jardin, qu’un jardinier sur un champ de bataille.
Les privilèges.
Le dévoiement du vocabulaire et la propagande républicaine ont donné au mot une signification insupportable. Étymologiquement, un privilège est une loi privée, une disposition légale particulière attachée à une profession, destinée à faciliter l’exécution de ce travail au service de la collectivité. Rien à voir avec des cadeaux octroyés par copinage ou clientélisme. Un journaliste a des privilèges avec sa carte de presse, pour l’aider dans sa mission d’informer. Un médecin en intervention se gare n’importe où, caducée sur le pare-brise. Privilège, oui. Toute société a ses privilèges nécessaires. A ne pas confondre avec des avantages injustifiés, comme cela est passé dans l’opinion courante. On a fait retenir à l’opinion que la nuit du 4 août a aboli les privilèges, comme s’il ne s’agissait que de la dispense d’impôt de la noblesse (justifiée comme on l’a vu par l’ancestrale et totale disponibilité à verser son sang en lieu et place des autres). Les privilèges des nobles seulement ? Non, tous les privilèges, et ils étaient nombreux accumulés au fil des siècles : ceux de certaines villes, ceux de certains métiers, de certaines corporations, etc. Il faut donc distinguer privilèges et avantages injustifiés. Pour information, aujourd’hui, à revenu égal avec un salarié, un élu de la République peut payer deux fois moins d’impôts. Est-ce justifié, ou est-ce un avantage anormal et révoltant ?
L’impôt.
On payait sous l’Ancien Régime un impôt sur le sel, impopulaire comme tous les impôts, la fameuse « gabelle ». Mais elle n’avait pas cours partout. Certaines provinces en étaient dispensées, entre autres la Bretagne, la Flandre, l’Aunis, le Boulonnais. Il y avait les pays de grande gabelle et de petite gabelle, les pays rédimés, les pays de saline, et la côte normande était un pays de « quart-bouillon » c’est-à-dire qu’on y avait le droit de faire bouillir l’eau de mer pour faire son propre sel. A titre de comparaison, au milieu du XXème siècle, l’Angleterre libérale, si avancée, phare de la démocratie dans le monde, interdisait aux habitants des Indes de prendre du sel sur les côtes de l’Océan indien. Il y avait donc la gabelle. Et aujourd’hui, quand nous achetons un paquet de sel, il n’y a pas de taxe dessus ? ça s’appelle la TVA, et vous le savez bien elle ne s’applique pas qu’au seul sel, c’est une gabelle généralisée à tous les produits, et payée par tous les consommateurs, et à un taux beaucoup plus élevé que le taux de la gabelle. Merveilleux n’est-ce pas ? On ne sait que trop combien la France républicaine est un enfer fiscal. En réalité, nous payons aujourd’hui infiniment plus d’impôts que sous Louis XVI. Dans les périodes des plus lourdes taxes, l’impôt sous l’Ancien Régime allait jusqu’à atteindre 10 % du revenu national, mais globalement il s’est maintenu au niveau de 5 %. Aujourd’hui, en 2017, il est à 50 %. Mais nous sommes en république, donc c’est supposé normal, alors que l’impôt était considéré comme excessif sous l’Ancien Régime. On l’a vu, le petit noble à qui il était interdit de s’enrichir et à qui il était demandé de servir sous les armes ne payait pas d’impôt en juste compensation. Cela dit, il est vrai que le système n’était pas pleinement satisfaisant, la haute noblesse très minoritaire menait grand train sans payer d’impôt elle non plus, le clergé ne participait pas suffisamment à l’effort commun (encore qu’en contrepartie il soignait et enseignait gratuitement), la bourgeoisie elle-même avait parfois l’occasion d’échapper à l’impôt (quelle différence avec l’oligarchie des figures politiques actuelles dotée des meilleurs cabinets d’affaires, juristes et comptables, pour organiser leur insolvabilité et leur évasion fiscale ?). Bref, il fallait réformer, oui, y compris le système des Fermiers généraux. Pour des questions de principes idéologiques mais aussi parce que l’État ne percevait pas suffisamment d’impôts. La France d’Ancien Régime était « un État pauvre dans un pays riche », le pays n’était pas dénué de richesse, le plus riche du monde selon certains, mais l’État n’avait pas suffisamment de rentrées fiscales pour faire face aux besoins de fonctionnement d’un État moderne. Les derniers rois se sont heurtés aux blocages corporatistes, aux égoïsmes catégoriels (comme aujourd’hui). Il fallait donc obtenir un grand mouvement de consentement national pour réformer la fiscalité. C’est pourquoi Louis XVI convoqua les états généraux, très ancienne et grande consultation de terrain qui ne se limitait pas à l’action de quelques députés réputés « représentatifs », tournant des clés de vote nocturne par procuration dans un hémicycle désert, les états généraux étaient une démocratie royale bien plus directe et réelle ! Le « despotisme royal » était tel à l’époque que le roi n’avait pas le pouvoir d’augmenter les impôts, il fallait les états généraux. On connait la suite, mais j’y reviendrai en temps voulu dans la chronologie du récit.
Peuple souverain.
A l’époque où Versailles n’était pas un musée, le palais était accessible à tout le monde. Pas besoin de payer un ticket. Chacun entrait et sortait à sa guise, allait partout en toute liberté, y compris au plus près des appartements royaux. Environ dix mille personnes se promenaient chaque jour dans le palais véritable ville grouillante. C’était l’occasion d’y faire du commerce, certains venaient y vendre des boissons aux passants. On ne peut plus comprendre ces choses, tant elles nous paraissent incroyables. A Versailles sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, l’une des fonctions du roi était « d’être vu par son peuple ». Versailles n’était pas seulement le palais du roi, c’était le palais de la France, le palais des Français, de tous les Français. Ce monument illustrait la gloire de tout un peuple, et non pas seulement de son roi. Essayez aujourd’hui de rentrer dans la cour de l’Élysée, même en contexte normal hors attentat, et d’y monter une buvette !
L’absolutisme.
En tant que pouvoir unique, il n’a jamais existé dans la pensée monarchique, nonobstant ce qui peut se lire sur le sujet. On l’a vu ne serait-ce qu’avec l’impossibilité de décider de l’impôt. L’absolutisme est un néologisme inventé sous la Révolution à des fins polémiques. Mot destiné à distinguer la monarchie que la France a connu jusqu’à Louis XVI, de la monarchie constitutionnelle moderne qui subsiste aujourd’hui en Europe (monarque sans pouvoir incarnant simplement l’unité nationale, la stabilité des institutions). La propagande a chargé l’absolutisme de sens péjoratif, devenant le synonyme de despotisme, tyrannie, une monarchie où le roi a tous les pouvoirs, absolu sonnant comme total, donc totalitaire. Mais Louis XIV, modèle par excellence du « roi absolu », avait moins de pouvoir que le président de la Vè République. La subversion du vocabulaire et du sens des mots a toujours fait partie du génie malsain des architectes de la République. C’est toujours le cas en 2017 avec la véritable novlangue qui est imposée à la population. Il faut faire un effort d’imagination pour se restituer à l’esprit ce qu’était la France monarchique, parsemée de dérogations locales (ces « privilèges »), de parlements provinciaux, de puissances morales indépendantes, de contre-pouvoirs de toutes sortes. Le Parlement de Paris avait un pouvoir énorme, bien supérieur au rôle de chambre d’enregistrement que joue le parlement de notre république. Absolu signifie étymologiquement « libre de tout lien ». C’est-à-dire que le « roi absolu » (encore que jamais aucun roi ne se soit appelé ainsi), se veut idéalement libre des factions, libre des puissances d’argent, libre des pressions cléricales, libres des lobbies de toutes sortes. Voilà le véritable sens de ce mot dans la pensée monarchique. La monarchie « absolue », libre, c’est la forme que voulut prendre l’État au moment où il lutta contre les féodalités, les puissants régionaux, les factions qui avaient divisé et ravagé la France à l’occasion de la Guerre de Cent ans, puis des guerres de religion, puis de la Fronde. Dans cette lutte de pouvoir entre les féodalités et le roi au fil des siècles, ce dernier a joué le rapprochement tactique avec le peuple. Il en était résulté une antique alliance de la royauté et du tiers état contre les baronnies et les féodalités, qui perdura jusqu’en 1789.
Autre notion qui avec l’absolutisme a été dévoyée de son véritable sens, celle exprimée par la formule attribuée à François 1er, « Car tel est notre bon plaisir », supposée démontrer les caprices royaux, et l’obéissance à l’arbitraire. Étymologiquement, l’expression signifie « bonne décision ». Elle vient du verbe latin placere qui signifie décider, agréer. Le bon plaisir est donc une décision sage prise par le roi en son conseil.
Le droit divin.
On a parlé de cette doctrine comme si la Divinité avait, par une révélation spéciale, désigné telle ou telle famille pour gouverner un État, ou que l’État lui appartenait, comme un troupeau appartient à son maître. Rien à voir avec le réel. C’était avant tout un concept, un argument d’opposition et d’indépendance vis-à-vis du pouvoir des papes. Son premier sens, le plus politique, relève de la philosophie française de la royauté, pour faire pièce aux doctrines sacerdotalistes qui ont opposé du XIème au XIIIème siècle les papes au Saint-Empire Germanique. Durant cette période, les papes prétendaient avoir une autorité tant spirituelle que temporelle sur les rois. Les empereurs germaniques souffrirent beaucoup de cette ingérence (emblématiquement illustré par l’épisode de Canossa). La monarchie française et ses institutions fondamentales étaient mieux pensées pour qu’un roi de France ait jamais eu à subir les mêmes empiètements. Le « droit divin des rois » exprimé d’abord en France était un artifice doctrinal signifiant que le roi ne tient pas sa couronne du Pape, mais de la seule grâce de Dieu, auquel le pape est évidemment soumis. Ainsi, exit les tentatives de domination du pouvoir en France par les papes comme ce fut le cas en Allemagne. Ce principe d’indépendance du roi est admis depuis Clovis, et même un roi très pieux comme Saint Louis n’hésitera pas à le rappeler au pape et ne se laissera pas manœuvrer. C’était de la laïcité royale, ce qui n’a rien à voir avec le laïcisme républicain. La théorie française fit école dans toute l’Europe, après les turpitudes allemandes, pour écrire que le pouvoir politique n’est pas soumis à l’autorité du pape ni de l’Église.
Le deuxième sens de cette doctrine a été, dans un souci de stabilité, de créer une sorte de mystique du pouvoir dressant des barrières aux ambitions des aventuriers de toutes sortes. Toucher au roi, clef de voûte de l’État, c’était mettre en péril tout l’État, donc nuire à la société toute entière, et partant, déplaire à Dieu qui aime la paix et l’harmonie.
Un troisième sens est que le roi particulier qui a été porté sur le trône est à cette place uniquement parce que Dieu l’a bien voulu : il n’a aucun mérite lui-même. Mais il est tellement plus efficace et rentable pour des manipulateurs de servir à la population la version simpliste de la « famille tyrannique élue de Dieu » plutôt que de lui expliquer le concept d’indépendance de la couronne de France vis-à-vis de la papauté.
La religion d’État.
Sous l’influence de sa femme Clotilde acquise au christianisme, en geste de gratitude envers le « Ciel » pour avoir gagné la bataille de Tolbiac, et par intérêt politique, le roi Franc salien Clovis se fait chrétien à la noël 496. Comme Constantin avant lui à Byzance, il adopte cette importation sémite totalement étrangère à l’âme européenne et renie donc son identité, ses racines. L’imposition du christianisme aux populations d’Europe commence au travers de ces « élites » félonnes à la culture de leurs pères. Depuis, les principes politiques qui ont fondé la monarchie française se sont ancrés dans une vision de l’homme et du monde largement inspirée par la morale chrétienne. Toute société humaine a des repères religieux. L’association d’un régime politique et d’une religion a été une constante dans l’histoire des nations. Il n’y avait rien d’anormal à ce que ce soit le cas sur le territoire français, et la France royale n’a pas fait exception à la règle. Encore aujourd’hui, il est des pays très bien intégrés dans notre monde idéologique et qui ont une religion d’État sans que la « conscience républicaine » n’y trouve à redire, l’Angleterre et Israël pour ne prendre que deux exemples. Ce qui est vrai en revanche, c’est que certaines mauvaises habitudes ont pu exister sous l’ancienne monarchie. Sous la minorité de Louis XV, le premier conseiller du Régent s’appelait « l’abbé Dubois ». Ce n’était pas un vrai abbé, il n’était pas prêtre, mais ce qu’on a appelé un « abbé laïc », coutume absurde et ahurissante, qui prenait le vêtement de l’abbé et recueillait les bénéfices d’une abbaye, sans dire la messe, sans confesser, sans accomplir aucun des ministères d’un prêtre. On se demande comment le pouvoir royal a pu laisser faire ce genre de délire. Pire dans l’aberration, le « cardinal » Mazarin n’a jamais été prêtre, mais civil administratif au service de la papauté, avant de faire carrière militaire et diplomatique pour le Vatican, simplement tonsuré chanoine pour bénéficier des revenus attachés à cette fonction sans rentrer dans les ordres. On pouvait à cette époque, devenir cardinal, en porter les habits au service des papes, et ne pas même être prêtre. Délire intellectuellement malhonnête de ce temps. Cette confusion des genres a pu laisser croire en une confusion des pouvoirs spirituel et temporel, malgré le premier sens de la doctrine de « droit divin » que l’on vient d’expliquer et qui impose tout le contraire.
Économie, avant/après.
Avant 1789, l’industrie française se développait plus rapidement que celle de l’Angleterre. Les dégâts économiques de la Révolution et l’effondrement de la monnaie française furent si importants que les manufactures françaises ne retrouvèrent leur taux de production de 1789 que vers 1810, tandis que sur la même période l’industrie anglaise eut un taux de croissance de 23 %, puis de 39 % entre 1810 et 1820, au moment où la France se retrouvait ruinée. Le commerce français était prospère avant 1789. En 1815, à la fin de la période révolutionnaire et napoléonienne, 90 % des navires marchands dans le monde battaient pavillon britannique. En éliminant la première puissance du monde et le principal concurrent des Anglais, la Révolution française a été pour ces derniers une excellente opération. Le commerce français dut attendre 1825 pour retrouver son niveau de 1789. Au moment où Napoléon a besoin d’argent pour financer la tentative d’exportation révolutionnaire à toute l’Europe, il commet la folie de vendre en 1803 la Louisiane (à l’époque beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui) à l’Amérique balbutiante, pendant que l’Angleterre suit un mouvement inverse : elle se relève de sa défaite contre Louis XVI soutien des indépendantistes américains, et se lance à la conquête d’immenses espaces mondiaux et de débouchés commerciaux. D’une manière générale, la France passe du premier rang mondial à un rang secondaire, loin derrière l’Angleterre, pour ne plus jamais sortir de cette situation. Le royaume de France qui était le plus peuplé d’Europe (hormis la Russie) en 1789, n’est plus qu’un pays exsangue. Viendront ensuite 2,1 millions de morts français civils et militaires sur les champs de bataille napoléoniens. Pour comparaison, les fameuses « guerres de Louis XIV » tant décriées par le discours républicain, ont fait 120.000 morts sur l’ensemble des camps en conflit, mais je sais, ce genre de chiffres est toujours sujet à contestation et débat). La période révolutionnaire française et son héritage napoléonien, 1789-1815, constitue le premier suicide français, avant les deux suicides suivants que seront les guerres mondiales du XXème siècle, la Seconde étant le fruit du traité de Versailles qui clôturait la Première, à laquelle ont largement poussé les autorités républicaines françaises notamment dans l’affaire de l’attentat de Sarajevo (mais c’est un autre sujet). Après 1789, la France est le seul à ne pas voir sa population augmenter, incapable de participer à la course démographique qui accompagne l’expansion industrielle du monde, pour finir péniblement en 1900 aux deux tiers de la population de l’Allemagne, dont la superficie était équivalente. Les gens ignorent les dégâts économiques irrémédiables, on se garde bien de le leur dire, qui ont accompagné l’installation du régime républicain. En 1789, la France possède le meilleur réseau routier du monde. En 1815, revenant d’exil, des témoins surprennent Louis XVIII en train de pleurer en voyant l’état de délabrement des routes. Soit dit en passant, on voit aujourd’hui quelle erreur a été à l’époque le fait de nourrir ce serpent de l’indépendance américaine en pensant gêner l’Angleterre. Sans cette folie et sans la ruineuse Révolution française, le visage du monde actuel ne serait pas ce qu’il est. L’immense territoire de Louisiane (quasiment un tiers des États-Unis) serait resté français, l’autre tiers Ouest espagnol du continent nord-américain ne serait pas tombé dans les mains des Yankees à la faveur de la montée en puissance de ces derniers, l’indépendance américaine se serait limitée aux quelques territoires de la côte Est et de la « Nouvelle Angleterre », et nous n’aurions pas aujourd’hui ce titan impérialiste semant la merde, le malheur et la mort partout sur la planète et voulant imposer à tous son mode de vie frelaté sous sa gouvernance mondiale.
Au rang des conséquences économiques mais aussi militaires, il faut ajouter ceci. Edmund Burke, le 9 février 1790, s’exclame à la Chambre des communes : « Durant ce court espace de temps, les Français ont fait eux-mêmes pour nous ce que n’auraient pas fait vingt batailles. » Cette sentence lapidaire démontre avec quelle acuité l’abaissement de la France, corollaire de la Révolution, est très tôt perçu avec soulagement chez l’ennemi héréditaire anglais. Le déclassement, l’abaissement de la France dans le concert des nations, fruit stupide de la Révolution, constitue le premier suicide d’un pays qui ne retrouvera jamais ensuite sa position, malgré les apparences. Les deux conflits mondiaux du XXème siècle constitueront ses deux étapes suicidaires supplémentaires, avant de s’achever avec mai 68 et aujourd’hui l’inféodation aux États-Unis. Celle qui avait été la première et la plus prestigieuse nation n’est plus qu’un piteux caniche suiveur de l’ogre mondialiste nord-américain. Mais refermons ce fulgurant résumé historique des siècles à venir pour reprendre là où nous en étions. La Révolution est considérée outre-Manche comme le meilleur moyen d’abattre définitivement les prétentions maritimes de la monarchie française. Quelques années plus tôt, en 1778, le vieux ministre de Georges III, Pitt l’ancien, avouait : « L’Angleterre ne parviendra jamais à la suprématie des mers tant que la dynastie des Bourbons existera ». Le virus maçonnique, forgé sur l’île britannique et inoculé sur le continent fera le travail de sape favorable à une revanche que l’Angleterre attend depuis 1453 et la fin de la guerre de Cent Ans. Effectivement, après les déboires de la guerre de Sept ans (1756-1762), la monarchie française a entrepris un formidable effort de redressement maritime, la « Royale » devient à la veille de 1789 la plus grande marine d’Europe derrière l’anglaise. Cela en grande partie grâce à l’impulsion donnée par Louis XVI, souverain féru de géographie et d’explorations. Solidement alliée à la maison d’Autriche, à l’Espagne et à Naples par le pacte de famille, tandis que le Royaume-Uni est isolé depuis l’indépendance de l’Amérique, la France n’a plus à craindre pour ses frontières continentales. La monarchie française est l’arbitre de l’Europe. La France est durant cette décennie pré-révolutionnaire à la croisée des chemins. Elle est alors apte à devenir ce à quoi la géographie la prédestine naturellement, une grande puissance continentale à vocation océanique. L’année 1786 offre une extraordinaire occasion de moderniser l’outil économique et industriel français. En 1789, le commerce extérieur de la France, qui emprunte pour les quatre-cinquièmes la voie maritime, est supérieur à celui du Royaume-Uni. Mais un peu plus de vingt ans plus tard, décapitée par la Révolution, écrasée dans les batailles d’Aboukir et Trafalgar, l’orgueilleuse Royale ne sera plus. Napoléon, qui dans bien d’autres domaines bénéficiera de l’héritage de la France de Louis XVI, ne pourra jamais reconstituer une flotte digne de ce nom. Le ressort est brisé. En 1810, l’apogée de l’Empire n’est qu’un trompe-l’œil précaire qui masque l’incapacité aussi bien économique que militaire à entamer l’Albion maîtresse des mers. La politique de blocus continental de Napoléon contre le Royaume-Uni sera une mesure désespérée et inefficace pour pallier l’absence de marine. D’autant que l’industrie française n’est pas en mesure de fournir aux populations des pays occupés par la France impériale, et à meilleur prix que ceux des Anglais, des produits de qualité. Son commerce maritime ruiné, la France est contrainte de trouver refuge dans un protectionnisme stérile, frein à l’innovation et à son décollage économique. En 1815 s’achève entre la France et le Royaume-Uni une « seconde guerre de Cent Ans » qui a débuté en 1688 avec l’avènement de Guillaume d’Orange sur le trône d’Angleterre. La France a laissé échapper au profit du Royaume-Uni la possibilité de devenir la première puissance maritime, et donc industrielle et commerciale d’Europe. Cette catastrophe est la conséquence directe de la Révolution. Si l’armée a su s’adapter et voler de succès en succès, force est de constater que tel n’est pas le cas de la Marine. L’enthousiasme, la supériorité numérique ne peuvent sur mer se substituer à un corps d’élite formé de militaires qui sont en premier lieu des techniciens et des scientifiques. On ne manœuvre pas une escadre comme une colonne de fantassins. Le courage et le sens du sacrifice ne peuvent pallier que jusqu’à une certaine mesure la désorganisation et l’incompétence (les Officiers compétents issus de la noblesse qui n’ont pas succombé aux persécutions, ont dû fuir à l’étranger). La guerre sur mer exige un solide bagage technique, une accoutumance aux éléments, une attention constante au matériel, la discipline des équipages, un encadrement de valeur. En d’autres termes, tout ce qui faisait la force et la renommée de la Marine royale en 1789. Cet esprit de corps, cet élitisme insupportable heurtaient de front les principes égalitaires de 1789. La Révolution va s’acharner à détruire, niveler, araser par tous les moyens. Les marins détonaient par leur genre de vie, leurs habitudes, leur code de l’honneur. Ils formaient un univers bien à part en marge de la société. Les idées abstraites ne pouvaient que dérouter les gens de mer habitués à penser et agir en fonction de réalités bien concrètes. Car jusqu’à nouvel ordre les éléments déchaînés ne plient que rarement face à l’idéologie. Cet empirisme consubstantiel à ce corps d’excellence était intolérable pour des révolutionnaires qui entendaient à coup de rabot faire table rase du passé pour façonner leur « homme nouveau » et interchangeable. On reste éternellement stupéfait du crétinisme fantastique de ce régime et du degré de connerie auquel peut pousser l’idéologie. C’est le rapporteur de la loi qui va supprimer la noblesse du corps des officiers de marine, qui n’hésite pas à déclarer le 13 janvier 1791 que « les matelots du vaisseau de guerre n’ont pas besoin d’une pratique différente de celle du bateau de commerce ». De là la refonte du système de recrutement, intégrant directement les officiers de la marine marchande sans examen sérieux de leurs aptitudes scientifiques. Pour les constituants perdus dans les brumes de leurs rêves abstraits d’égalitarisme, qui a navigué suffisamment en mer a logiquement toutes les compétences requises pour commander un vaisseau de ligne. Faire la guerre navale, manœuvrer sous le feu ennemi ou trimbaler des sacs de café, commander un brick et quelques dizaines d’hommes ou un vaisseau de 80 canons véritable ville flottante de 900 hommes, mêmes compétences pour le pouvoir révolutionnaire républicain ! Comme on viendra rapidement à manquer d’officiers de marine marchande, c’est au tout venant, pilotes, personnels des arsenaux que l’on fera appel. Cet ensemble hétéroclite est incapable de combattre de façon coordonnée, certains ignorent totalement les codes des signaux indispensables au combat d’escadre. On aura recours à des artilleurs de terre faute de marins formés. C’est cette Marine désorganisée, découragée, désarticulée, en proie à la subversion, qui à partir de février 1793 devra faire face une nouvelle fois, et sans espoir de l’emporter, à une Royal Navy parfaitement opérationnelle. C’est Jean-Baptiste Coffinhal qui, envoyant Lavoisier à l’échafaud en 1794, répond à ce dernier « La République n’a pas besoin de savants ! ». C’est sous la IIIème République au maçonnisme triomphant, à la veille de la Première Guerre mondiale, l’« affaire des fiches » retardant l’avancement et compromettant la carrière des officiers catholiques, comme hier les nobles de la Marine, et leur remplacement par des incompétents (mais républicains!) qui conduiront à des désastres de commandement et à des massacres inutiles de troupes.
Notions de théorie politique.
La conception de la monarchie n’est pas un monolithe figé. Elle a connu des changements. Par exemple la couronne, au temps lointain des Mérovingiens et des Carolingiens, est considérée comme un domaine privé. C’est avec les Capétiens que la couronne passe dans le domaine public. La monarchie n’est dès lors plus « héréditaire », mais « successive », car le roi, qui est choisi (certes non au suffrage universel, mais par un nombre restreint de pairs du royaume, comme ce fut le cas d’Hugues Capet à Senlis en 987) n’est plus considéré que comme le dépositaire momentané de la couronne, bien national. Dans la monarchie féodale qui s’impose à la fin des Carolingiens, le roi n’est que le sommet d’une structure assurant l’unité et l’indivisibilité du royaume, mais où le gouvernement des hommes est assuré par les grands féodaux. Dans la hiérarchie féodale, un vassal doit avant tout obéissance à son suzerain (un chevalier bourguignon au duc de Bourgogne par exemple), pas à son roi, sauf en cas de félonie du suzerain. C’est dire comme l’autorité du roi est diluée par autant de contre-pouvoirs. Son autorité directe ne s’exerce que sur le domaine royal, assez réduit, autour de la capitale Paris, un fief donc parmi d’autres mais qui a la particularité d’héberger celui qui parmi les grands féodaux a été élu roi. De fait, sa puissance personnelle, ou sa richesse, étaient très inférieures à celle d’un duc d’Aquitaine ou de Bourgogne par exemple. Plus tardivement, oui, la royauté finira par déposséder les grands de leurs fiefs pour les réintégrer dans la souveraineté directe du roi. Mais avant ça les théories royales ne mettaient pas en cause l’édifice féodal que les circonstances avaient imposé, notamment par l’impuissance du pouvoir central à assurer la protection des personnes et des biens lors des invasions du Xè siècle comme déjà évoqué. La théorie de la souveraineté s’est resserrée autour de la personne du roi quand les divisions politiques ou religieuses menaçaient l’unité de la France. On est alors passé de la monarchie féodale à la monarchie administrative qui a duré jusqu’en 1789, avec des parlements régionaux. L’idée est apparue de renforcer le pouvoir de ces parlements, leur donner une puissance législative permanente, ce qui a constitué une forme de rétablissement de contre-pouvoirs provinciaux tels qu’ils avaient existé avec les grands féodaux. On connait la suite de ce mouvement, j’y reviendrai avec le comte de Maurepas.
Brève généalogie des Capet.
La France a connu trois dynasties (n’entrons pas dans le détail des nombreuses subdivisions), successivement Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens. Étant donné qu’il existe toujours aujourd’hui des descendants de la dynastie capétienne (par exemple le roi d’Espagne ou le Grand Duc de Luxembourg), elle est de loin la plus antique du monde, jamais une famille royale n’aura duré autant qu’elle, les autres dynasties ont été interrompues ou sont apparues plus tardivement dans l’histoire. On fait remonter la dynastie capétienne à Hugues Capet en 987 parce qu’il n’y a pas eu de rupture depuis, mais des membres de sa famille avaient déjà régné avant lui à trois reprises sous le nom de Robertiens (Eudes, Robert 1er, Raoul, de 888 à 936) au moment de la décadence de la dynastie carolingienne. Après avoir été élective, la monarchie va se stabiliser dans la succession familiale, nous allons voir pourquoi.
Les Lois Fondamentales.
La France d’avant 1789 a été construite sur cinq Lois Fondamentales, précisées par les précédents nés des difficultés pratiques rencontrées. Il n’est pas inutile de les connaître dans la compréhension générale du sujet car elles montrent que la monarchie française n’était pas une affaire d’arbitraire mais reposait sur une réflexion profonde et des règles strictes de droit, avec le souci de la stabilité.
Première Loi Fondamentale, la primogéniture masculine. On est dépositaire de la couronne, bien national, de mâle en mâle par ordre d’aînesse. Ce qui signifie que, le cas échéant, si un roi défunt ne laisse que des filles, c’est le plus proche cousin qui devient dépositaire de la couronne. Pourquoi ? Par idée d’accaparement familial égoïste ? Non. Et pourquoi cette masculinité ? Par machisme primaire ? Non. Rappelez-vous, les « difficultés pratiques rencontrées ». L’histoire de l’Europe est une histoire de famille, et de rivalités familiales. Philippe le Bel avait marié sa fille Isabelle au roi d’Angleterre. Elle eut un fils, Édouard devenu à son tour roi d’Angleterre, qui en tant que petit-fils aîné de Philippe le Bel contesta l’accession au trône français de son oncle cadet Philippe de Valois (qui lui ne descendait pas de Philippe le Bel mais de son frère cadet Charles). Par « esprit national » peut-on dire, le juriste Pierre Lescot, vers 1350, a exhumé et utilisé la « loi salique » pour éviter que la couronne de France ne se pose sur la tête du roi d’Angleterre. Cette antique loi des Francs saliens relevait du droit des personnes privées où les filles de ce clan étaient écartées de l’héritage des terres ancestrales. L’astuce de Lescot a donc consisté à habiller la Loi de primogéniture masculine de cette coutume salienne. En conséquence, exit Isabelle fille de Philippe le Bel, donc exit les prétentions de sa descendance anglaise. Ce sera comme chacun sait le motif de la Guerre de Cent ans entre les deux pays.
Deuxième Loi Fondamentale, la catholicité du roi.
Incontournable, elle procède d’un principe lié à l’acte fondateur de la monarchie française que tout le monde reconnaît comme tel dans le baptême de Clovis. Entre temps, l’émergence du protestantisme et les guerres de religions sont passées par là. Henri IV était protestant. Désigné par la loi de primogéniture masculine, il a dû accepter la deuxième Loi Fondamentale et abjura pour pouvoir accéder au trône. Il aurait pu choisir de ne pas le faire. Une régence d’intérim se serait mise en place jusqu’à l’apparition future d’un mâle désigné par la loi de primogéniture et qui soit catholique. On peut trouver ça dommage, absurde, peu importe, c’est la loi que s’est choisie la monarchie française.
Troisième Loi Fondamentale, l’indisponibilité de la couronne.
Personne ne peut porter la main sur elle. Passée dans le domaine public depuis les Capétiens comme on l’a vu, elle ne se pose pas d’une tête à l’autre en vertu d’un héritage, mais d’une succession. Répétons-le, la monarchie française n’est pas « héréditaire », ce n’est pas un bien privé que le roi pourrait transmettre à sa guise dans sa descendance car elle est « successive », c’est-à-dire que la coutume successorale ignore les caprices des hommes et suit l’ordre naturel de la loi de primogéniture masculine. Cette précaution a l’immense mérite de situer la couronne au-dessus du roi lui-même, et de rendre souverain « dans l’heureuse impuissance », selon la formule, de modifier la coutume selon sa fantaisie. Louis XIV voulut transgresser cette Loi devant la disparition de ses descendants (réduits en ligne directe à son seul arrière-petit fils le futur Louis XV). Il entendait que l’on reconnaisse ses enfants nés de la Marquise de Montespan. Ce fut niet, ces enfants ne pouvaient pas être saisis par la coutume puisque illégitimes, ils ne rentraient pas dans la première Loi Fondamentale de primogéniture masculine. Et l’indisponibilité de la couronne interdisait à Louis XIV d’en faire ses successeurs. La réalité est très éloignée de l’image de « pouvoir absolu » et de « je fais ce que je veux » qui a été donnée par la propagande républicaine. Et en comparaison de l’incessante succession des scandales dans lesquels baigne la classe politique actuelle, on voit que le pouvoir royal était beaucoup plus intègre et respectueux des lois. Autre conséquence intéressante de l’indisponibilité de la couronne, l’impossibilité pour un roi de roi de France d’abdiquer, précisément parce qu’il ne peut pas se défaire d’une couronne qui ne lui appartient pas. Tout au plus peut-il renoncer à régner et laisser l’exercice du pouvoir à d’autres.
Quatrième Loi Fondamentale, la « Continuité de la personne royale ».
C’est elle qui justifie l’adage : « Le Roi est mort, vive le roi ». Autrement dit, il n’y a jamais de vacance du trône. La coutume passe d’une tête à l’autre et, comme dit encore un autre adage : « Le mort saisit le vif ». Autre conséquence, quand un roi va mourir alors que celui qui sera saisi par la coutume est encore enfant, il organise à l’avance la régence à venir. Mais la Quatrième Loi lui interdit de s’immiscer post-mortem dans ce que sera le déroulement de la régence intérimaire, en voulant par exemple limiter les pouvoirs de celui qui sera désigné régent. En effet, puisque la personne royale est continue, le roi est de fait considéré toujours majeur : c’est une fiction juridique qui sert à conserver le caractère public, successoral et non héréditaire, le caractère indisponible de la couronne. La Loi de continuité renforce ainsi la Loi d’indisponibilité.
Cinquième Loi Fondamentale, dite « d’inaliénabilité du royaume ».
Lorsqu’au Traité de Madrid en 1526, Charles-Quint qui avait fait prisonnier François 1er, réclame la Bourgogne, le Parlement refuse d’entériner cette décision, parce que le roi n’est non seulement pas propriétaire de la couronne, mais en outre n’est pas propriétaire du royaume, en vertu de cette Cinquième Loi destinée à assurer l’intégrité du territoire national. Mais cette loi ne faisait pas de la France un carcan du type bloc de l’Est sous l’ex-URSS. La possibilité qu’un territoire se détache du royaume était quand même admise, par un consentement local ratifié par une consultation de la population concernée, auquel devait s’ajouter le consentement de la nation toute entière représentée par les états généraux.
Qu’est-ce qu’une dynastie ?
Le mot vient du grec « dynasteïa », la puissance. On donne à un principe supérieur, qui est de l’ordre de la pure philosophie politique, une puissance, c’est-à-dire une possibilité de produire des effets dans la réalité. Mais le principe sans incarnation humaine ne resterait qu’une idée sans effet. Il faut donc qu’il s’incarne dans ce qu’on appelle un « prince ». Le dynaste est donc un homme que la nature ne distingue pas des autres hommes ; c’est l’institution politique qui va en faire quelqu’un de différent, parce que les autres hommes le reconnaissent comme porteur du principe philosophique de puissance. Le dynaste porte donc en lui la puissance de ce principe, et à cet égard, il est une sorte de « roi inachevé ». Quel que soit son rang dans l’ordre de succession, fût-il au quarantième rang, si d’un seul coup les trente-neuf princes placés devant lui venaient à disparaître, la coutume successorale le saisirait immédiatement comme le Roi. C’est pourquoi on peut dire d’un dynaste qu’il est un « roi inachevé », un roi en puissance, un roi disponible. Lorsque la coutume saisit le dynaste, c’est comme une chaîne qui se tend d’un seul coup et marque son rattachement par maillons généalogiques successifs à un ancêtre Roi dont il descend en ligne directe masculine. Chacun des maillons a été porteur du principe philosophique de puissance. Chaque maillon de la chaîne a été un roi « inachevé », garant de la royauté quel qu’ait été son rang dans l’ordre dynastique. Cette chaîne dynastique procède aussi de la Quatrième Loi Fondamentale sur la continuité de la personne royale.
Avançons dans la chronologie
L’épisode de la Fronde des Grands.
Depuis le centralisme étatique qui avait commencé avec Philippe le Bel (1268-1314), la coexistence-opposition de pouvoir entre d’une part les baronnies, les puissants du royaume, et d’autre part le roi, avait fini par prendre un tournant favorable à ce dernier à partir d’Henri IV (1589-1610). Cette position dominante du roi sur les féodaux ira ensuite crescendo sous Louis XIII et son ministre Richelieu, pour culminer sous Louis XIV. On est encore loin du XVIIIème siècle, mais les conséquences de la Fronde vont compter dans les ressorts futurs de la Révolution. A la mort d’Henri IV, se met en place la Régence de Marie de Médicis en attendant que son enfant le futur Louis XIII soit en âge d’exercer le pouvoir. Durant cette parenthèse, et ensuite sur les premières années de gouvernance effective de Louis XIII (le temps qu’il reprenne les choses en main), c’est un peu l’anarchie, et les Grands du pays en profitent pour malmener le pouvoir royal et tenter de reprendre davantage d’autonomie. Cette révolte des Grands se fait dans le sillage des guerres de religion et de la menace politique protestante qui avaient secoué l’autorité royale depuis l’Édit de Nantes et la mort d’Henri IV. Les Grands ont profité des guerres de religion pour relever une nouvelle fois la tête. Richelieu va mater ce mouvement. L’épreuve de force s’achève par la défaite de la noblesse française.
Le système de cour.
Vaincue dans son bras de fer avec le pouvoir royal, la grande noblesse française se retrouve vouée ensuite à la domestication du système de cour par Louis XIV, le Roi-Soleil. En revanche, pour toute l’immense majorité de petits nobles de province dont la vie n’est pas très différente de celle des paysans, rien ne change. Mais le pouvoir royal ne veut plus de frondeurs. La haute aristocratie se retrouve castrée, neutralisée dans la vie de cour, réduite à l’état de caniches tenus sous contrôle forcé à Versailles. Mais les fêtes, le poudrage de perruque, la flagornerie du protocole et l’oisiveté d’une cage dorée sans responsabilités, ça finit par lasser. Plus tard, au siècle de la Révolution, pour pallier à son désœuvrement, certainement aigrie et revancharde d’avoir eu les ailes rognées, mais ayant conservé une puissance économique, elle prendra pour loisir mondain d’investir un domaine qui apparaitra en France peu après sa naissance en Grande-Bretagne, et qui se répandra comme une « mode philosophique » jusqu’au sommet de l’État, les idées de la franc-maçonnerie. Nous y venons.
Ce tableau dressé de certains aspects de la France d’Ancien Régime depuis sa fondation, nous pouvons avancer dans l’histoire de la période pré-révolutionnaire.
II – La période pré-révolutionnaire
Mais faisons d’abord un bref bond dans le passé. Dans le contexte difficile de la Guerre de Cent ans, en particulier de la défaite de Poitiers en 1356, à l’occasion de laquelle le roi de France avait été fait prisonnier par les Anglais, un parisien, Étienne Marcel (à qui la République a dédié une station de métro, ligne 4), d’une riche famille de drapiers, crut réussir à livrer la monarchie française à une forme de gouvernement qui anticipait sur les siècles démocratiques à venir. Le futur Charles V, fils du roi prisonnier, ayant ouvert des états généraux en octobre de cette même année, Étienne Marcel chercha à mettre la monarchie sous tutelle, utilisant la démagogie, instrumentalisant les bourgeois et les laboureurs contre les nobles. Avec quatre siècles d’avance, c’est un peu 1789 qui pointait son nez. Ce phénomène est vieux comme la société. On lit dans la Politique d’Aristote : « La plupart des tyrans sont sortis de la classe des démagogues ; ils ont gagné la confiance du peuple en calomniant les notables ». Étienne Marcel réussit par des émeutes à mettre le Dauphin en minorité dans l’opinion publique. Mais ne reculant devant rien pour faire aboutir son entreprise, il fit appel aux armées anglaises, et cette trahison nationale lui aliéna le peuple de Paris, qui se souleva cette fois-ci contre lui, et l’assassinat le 31 juillet 1358.
Les idées des Lumières que la République passe sous silence.
C’est quoi pour vous les Lumières ? Un grand mouvement de bonté et de progrès selon la version implantée dans toutes les têtes par l’École et le discours officiel ? Il faut simplement lire les éminents auteurs de ce temps et les archives (certains l’ont fait pour vous alors profitez-en), ils sont la référence de l’oligarchie républicaine, leurs écrits existent, les mots ont un sens, on les retrouve repris d’un auteur à l’autre, et leur contenu ne trompe pas sur la réalité. Au départ, sous l’émergence scientiste du dix-huitième siècle, plusieurs penseurs réformistes, Helvétius, d’Holbach, Condillac, La Mettrie, Cabanis entre autres, se sont convaincus que l’homme n’est que de la matière, qu’une mécanique de fibres et d’organes, strictement physique, dénuée d’âme (pour faire pièce bien sûr à l’Église), que sa pensée n’est que le fruit des sensations découlant de ce qui l’entoure, et mu par les habitudes (théories matérialiste, du mécanicisme, du sensationnisme). Et l’homme n’étant que du matériau, il était donc possible, il fallait désormais le « recréer », le remodeler, dans un rapport qui est celui de l’argile et du potier, c’est-à-dire l’adapter, le conditionner au nouveau mode de gouvernement hérité de la Révolution, en faire ce « citoyen», homme « social». Certains pourront voir dans ce projet totalitaire de la « branlette intellectuelle » de mégalomanes grisés par la nouveauté pour autosatisfaction de l’ego. Il est tout de même à des fins utilitaristes pour le nouveau gouvernant à venir). Le mouvement des Lumières est un mouvement scientiste qui se fait une idée éminemment utilitariste, mécaniciste, de l’homme. Une vision en fait déshumanisée, en complète contradiction avec la présentation qui en est faite. L’histoire du vocabulaire est passionnante de ce point de vue. Avec le développement scientifique et technique des XVII et XVIIIème siècles, les idéologues des Lumières ne cessent de parler « d’organes », entre autres, faisant le parallèle entre le corps humain individuel et le corps social dont chacun n’est qu’un organe. L’idée est partout de « rectifier la nature ». Ces beaux esprits se voient en demiurges, en savants manipulant le matériau humain, du matériau organique, sans différence avec celui d’un cheval. Ils sont bien dans une négation de ce qui distingue l’animal de l’être humain : l’âme. La romancière Mary Shelley, auteur de Frankenstein, est née en 1797, elle est contemporaine de cet « air du temps » qui a cours depuis le XVIIème siècle. Les idéologues des Lumières se prennent pour le Créateur, ce dernier n’a été capable que d’imperfection, le Français d’avant 1789 qui a pourtant bâti ce pays depuis presque deux mille ans (et pas seulement lui en définitive mais toute l’humanité) n’étant donc qu’une ébauche défectueuse physiquement et moralement. Quelle insupportable arrogance dans ces têtes. Les dirigeants de la révolution de 1789, invoquant la philosophie des « Lumières », se sont fixé un double but : détruire l’homme ancien, qu’ils considéraient défiguré par la tyrannie royale et la superstition religieuse, puis créer un Homme nouveau : l’Homme social. « Il faut en quelque sorte recréer le peuple qu’on veut rendre à la liberté » (Billaud-Varennes). « Nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière » (Carrier). La mystique de l’Homme nouveau. Faire naître un citoyen républicain acquis au régime pour ainsi dire de façon fanatique, idolâtre. Ils y sont d’ailleurs parvenus, sans quoi par la suite Bonaparte n’aurait pu disposer d’un tel contingent pour tenter d’exporter la Révolution française dans toute l’Europe. Et au service de cette entreprise des philosophes et des révolutionnaires du XVIIIème siècle, il est fort amusant de lire que ce qui a été ensuite reproché au IIIème Reich comme étant des monstruosités en matière d’eugénisme, d’anéantissement néonatal des handicapés, d’idée de construction d’un homme supérieur, de pureté de la race et du sang, de reproduction des meilleurs, de génocide des races inférieures, reproches faits par les vainqueurs de 1945 adorateurs et héritiers des Lumières, que tout cela a été précisément théorisé, proposé, et écrit par diverses icônes de leur panthéon, et non des moindres : les déifiés Diderot, Voltaire, Cabanis, d’Holbach, Condillac, ou Maupertuis et Faiguet de Villeneuve par exemple.
Les corporations, de toutes sortes professionnelles, cercles de solidarité et de contre-pouvoir, avaient charpenté la France et son fonctionnement économique depuis le XIème siècle. 1789 les interdira, pour ne laisser que des individus isolés, dans l’impossibilité de se défendre face à la machine étatique, vulnérables. Et l’idée de simple individu à propos duquel il ne faut tenir aucun compte en matière d’identité, de racines, comme c’est le cas dans la France de 2015 soumise à l’idée mondialiste est déjà là, normal, les Lumières ne sont-elles pas un universalisme. Un pays, une nation, n’est plus qu’une « collection d’hommes », comme les pièces interchangeables à volonté d’un meccano. Comme un entomologiste parle de ses insectes. Une vision déshumanisée en définitive oui, matrice du temps actuel où le grand patronat ne voit plus les salariés que comme une ressource, un stock à gérer, confié à des « directeurs des ressources humaines », et où le politicien apatride ne voit plus qu’un votant et un contribuable. Peu importe dès lors qu’il s’agisse d’hommes originaires de ce sol, ou d’hommes que l’on importe au besoin de l’étranger. Collection, assemblage, agrégations, agglomérats, etc. ces mots sont dans l’air du temps chez les idéologues des Lumières. Chez Cabanis (« collections d’hommes prises en masse »). La société ? Pour Malouet, une « collection d’individus ». Pour Duhem un « assemblage d’hommes ». La patrie selon l’abbé Auger ? « la collection des citoyens » La société selon l’abbé Grégoire ? Elle « n’est que la collection des individus qui la composent ». L’État, pour Grenier « n’est que la collection des individus ». D’Allarde, initiateur de la suppression des corporations, parle lui aussi de « collections d’individus ». Isnard à la Convention dit des Français qu’ils sont « une agrégation d’hommes ». Sieyès, quant à lui, rêve d’un système où « le corps gouvernant » seul doit être « organisé » ; « la patrie gouvernée », en regard, « n’est qu’une collection d’individus », et doit le rester. Il y a du « troupeau » indubitablement dans la collection d’hommes envisagée en masse – ce « troupeau d’imbéciles », « cet imbécile troupeau qu’on appelle une nation », comme l’écrira Raynal, philosophe en vogue aux années tardives de l’Ancien Régime. Et Mme de Charrière déplore : « On s’est accoutumé à voir le peuple en masse, et à regarder une nation comme un troupeau d’hommes ». Selon cette logique, les groupes humains sont tout au plus des agglomérats – le mot apparaîtra en 1824. Toute ressemblance avec la France actuelle… Il faut continuer avec ces exemples afin de ne pas être accusé d’affabulation :
– « Perfectionner l’ouvrage informe de la nature » (D’un professeur d’École centrale, 1796).
– Œuvrer à « l’amélioration de l’espèce humaine », « modifier, pour ainsi dire, la substance de l’homme, de manière à l’identifier avec la forme du gouvernement » (La Réveillère-Lépeaux 1798).
– Mener de front « le perfectionnement de l’organisation sociale et de l’organisation individuelle » (D’un anonyme dans la Décade Philosophique, 1799).
– « Perfectionner l’espèce humaine au physique et au moral » (Sieyès à la Constituante lors du grand débat sur la Déclaration des Droits, 21 juillet 1789, Archives parlementaires). Rabaud Saint-Etienne annonce « une race d’hommes forts et vigoureux » (à la Constituante, 18 août 1789).
– « Une race de républicains doit être robuste » (Marie-Joseph Chénier à la Convention, 5 novembre 1793, Archives parlementaires).
Bœufs, pêches, tulipes, êtres humains, citoyens, quelle différence ? :
– « Après nous être occupés si curieusement des moyens de rendre plus belles et meilleures les races des animaux ou des plantes utiles et agréables ; après avoir remanié cent fois celles des chevaux et des chiens ; après avoir transplanté, greffé, travaillé de toutes les manières les fruits et les fleurs, combien n’est-il pas honteux de négliger totalement la race des hommes ! Comme si elle nous touchait de moins près ! Comme s’il était plus essentiel d’avoir des bœufs grands et forts que des hommes vigoureux et sains ; des pêches bien odorantes ou des tulipes bien tachetées, que des citoyens sages et bons ! Il est temps à cet égard comme à beaucoup d’autres, de suivre un système de vue plus digne d’une époque de régénération : il est temps d’oser faire sur nous-mêmes ce que nous avons fait si heureusement sur plusieurs de nos compagnons d’existence ; d’oser revoir et corriger l’œuvre de la nature… (Cabanis, Rapports du physique et du moral de l’homme, pages 298-299).
– Maupertuis rêve d’un haras humain qui produirait au roi des grenadiers d’élite. L’effleure également l’idée séduisante de quelque sultan qui profiterait des facultés reproductives de son harem pour des croisements exploratoires (cité par Léon Poliakov dans Le Mythe Aryen, pages 160-161).
– « Dans toutes les espèces d’animaux que les hommes ont domestiqué, on choisit, pour la propagation, les individus les plus beaux et les plus parfaits ; qui le croirait, c’est le contraire dans l’espèce humaine ». Les agronomes « observent tous avec raison qu’il faudrait introduire dans nos campagnes les plus belles espèces d’animaux », et simultanément « éteindre peu à peu les espèces actuelles, presque toutes abâtardies. Pourquoi les mêmes attentions et les mêmes vues ne seraient-elles pas proposables pour l’amélioration de notre espèce dont la vigueur et la bonne santé nous intéressent bien davantage ». (Faiguet de Villeneuve, économiste physiocrate et encyclopédiste. L’économie politique. Projet pour enrichir et perfectionner l’espèce humaine. 1763. Pages 115, 116, 122). Et les défectueux ? Dans son projet philanthropique, il en prône la résorption par la mise sur pied de « régiments de bossus, de boiteux et de borgnes », pour « diminuer d’autant l’extinction des forts hommes que l’on tire de la campagne », alors que dans l’état actuel des choses « les sujets les plus faibles, les plus laids, les plus ineptes se marient tous les jours » (pages 113, 114, 118).
– « Il y a un art de changer la race des animaux, n’y en aurait-il pas pour perfectionner celle des hommes ? » (La Chalotais, Essai d’Education Nationale, ou Plan d’Etudes pour la Jeunesse. 1763).
– « Les princes ont des haras de chevaux ; il devraient en avoir de sujets. Quand on empêchera les mélanges de races, on sera sûr d’avoir de l’excellent et en chevaux et en hommes »… « Toute sorte d’humeur, toute qualité de sang, tout assortiment de caractère ne serait pas propre à faire un citoyen de cette ville »… « Tous les membres de la société qui seraient infirmes, malades, malsains, laids, sots, méchants seraient retranchés de la société » … « En cent ans, il s’y formerait un sang si pur et si beau, qu’il serait le réparateur de la nation » … « Si j’avais un royaume à moi, j’ordonnerais dès demain l’essai de cette police » et « je ne doute pas que je n’eusse en vingt-cinq ou trente ans une race d’hommes dans les veines desquels circuleraient le bon sens et la vertu » (La Baumelle, Mes Pensées, ou le Qu’en dira-t-on. 1751-1752).
– « La vie » de l’homme est devenue « un don conditionnel de l’État » (Rousseau, Contrat Social, 1762, page 72).
– Restif de la Bretonne formant le vœu que les citoyens les plus méritants se voient affectés pour épouser des filles tirées « de tous les cantons où l’espèce est la plus belle », explique prévoir pour eux, « les moyens d’avoir une belle race », au sens ici de descendance. L’Irlande, le Comtat, le pays de Caux, le Labourd sont à l’en croire ces hauts « cantons » qualitatifs du genre humain. (Restif de la Bretonne, Monsieur Nicolas ou le cœur sur la main dévoilé, 1794-1797). Et Faiguet de Villeneuve, dans un mélange de cosmopolitisme métissolâtre et de raciste maquignon à humains examinant et sélectionnant la marchandise, voyait plus large, suggérant que « de toutes parts » on importât « de belles filles bien choisies pour la vigueur et pour la taille », par arrivage annuel de douze à quinze cents sur bétaillères flottantes – il le dit « dans un sens politique sérieux » et nous prend à témoins : « Qui de nous ne verrait plus volontiers ces nouvelles cargaisons, que de vaines curiosités qu’on nous apporte à grands frais, des oiseaux rembourrés, des peaux de lézards et de serpents, des minéraux, des coquillages, etc. » (Faiguet de Villeneuve, L’Economie politique, 1763).
Il faut oser « revoir et corriger l’œuvre de la nature », rectifier l’homme, modifier sa substance, le remodeler, régénérer la race humaine, etc. C’est donc le propos de Cabanis et de ses semblables penseurs des « Lumières ». Pour en faire un homme amélioré « affiné », supérieur comme l’idée en est répandue ? Non, car si ces idéologues entendaient parfaitement leurs propres propos, la formulation pour autrui en est volontairement incomplète, imprécise. Il faut bien tromper son monde. En réalité, pour faire de l’homme un produit correspondant au nouveau mode de gouvernement alors théorisé, le type d’homme « parfait » pour cela, un parfait type moyen, et non pas un type parfait en tant que summum abouti. Cet idéal du « type parfait » n’est donc pas ce qu’on croirait. Le type parfait ainsi rêvé, c’est le modèle d’un « type moyen » répétons-le, ce qui change tout. Un parfait type moyen, c’est-à-dire arborant l’intelligibilité et la gouvernabilité les plus adaptées. D’abord, la plus commode intelligibilité : les interprétations mécaniciste de type « newtonien » qui prévalent diffusément à l’époque, réduisent les phénomènes humains à des « moyennes », les individus à des types moyens uniformes – ceux-ci étant supposés aptes à se comporter sans cesse « de manière optimale » (Voir P.M. Allen, « Economique : la vie par-delà le paradigme newtonien » dans Stephen Hawking, préface, La Mort de Newton, Paris 1996). C’est dans l’air du temps. Ensuite, la meilleure gouvernabilité : la perfection que l’on escompte alors du type (moyen) « parfait » n’est guère en fait que celle de la « docilité ». D’Holbach parle à propos des hommes, des « impulsions utiles » que leur donneront les gouvernants. La chose est assez claire : les organisations humaines, dûment conditionnées, enregistreront correctement les impulsions données à elles par les gouvernants, et se conduiront dans la vie sociale comme l’on attend d’elles. En un mot, si les prétendus « hommes supérieurs » qu’Helvétius veut former doivent essuyer à cet effet ce que Gusdorf s’estime forcé d’identifier comme une « pédagogie totalitaire » (dans Pourquoi des Professeurs ? – 1963), il faudra bien qu’ils soient le contraire de surhommes, ils ne seront guère autre chose en vérité que des « sous-hommes » : des robots « supérieurement » téléguidables, à la manière et à l’instar de l’élève tel qu’envisagé par Rousseau dans Emile ou De l’éducation : « Sans doute ne doit-il faire que ce qu’il veut ; mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu’il fasse ; il ne doit pas faire un pas que vous ne l’ayez prévu ; il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu’il va dire ». Quelle puissance totalitaire ainsi souhaitée par ces idéologues qui osaient parler de despotisme royal et de tyrannie à abattre, et que l’on présente comme des bienfaiteurs ! Le tout en effet n’annonce de « supérieur » dans les produits du remodelage que le fait d’être, après retouche ou réfections, « supérieurement » gouvernables. Des citoyens supérieurement téléguidables : c’est bien la logique dans laquelle Cabanis inscrit son propos. Des citoyens dont l’équipement sensoriel traite comme il se doit les sensations précalculées qu’on lui imprime. Rappelons-le également : il est établi à l’époque que la perfectibilité de l’homme est supérieure à celle des autres êtres animés ; c’est cela qui le rend le plus manipulable des animaux, et qui laisse espérer l’heureuse approche d’un « type parfait », c’est-à-dire « optimal moyennement » selon le point de vue du gouvernant. Les hommes souhaités par Dom Deschamps, moine utopiste des « Lumières », dans sa société idéalisée, sont quasiment des hommes sans visage, à tout le moins inexpressifs : « On ne rirait ni ne pleurerait dans l’état des mœurs », et « les visages qui auraient tous à peu près les mêmes formes », arboreraient tous le même « air serein » (dans Le Vrai système, p.162). Les citoyens dont Cabanis « se sent en état » de prendre en charge le perfectionnement sont eux aussi des hommes sans visage : au départ, des « collections d’hommes prises en masse », et mentalement réduites à « un individu » ; à l’arrivée, des clones dociles, interchangeables. La société parfaite à laquelle renvoie ce genre d’approche est forcément impersonnelle. Elle est du type de la ruche, de la fourmilière. L’idée d’adopter la ruche comme symbole de la République émerge à la veille du Directoire. L’abeille neuf ans plus tard sera celui de l’Empire. Ils conceptualisent un enfer de zombis à encéphalogramme plat. L’idéal pour ces penseurs étant par ailleurs que la « machine tourne toute seule » afin que le gouvernant n’ait qu’à jouir de son statut dans l’oisiveté. Une société d’hyménoptères, la machine sociale parfaite en auto-fonctionnement, reproduisant sans fin l’inexorable jeu tranquillement mécanique de l’horlogerie cosmique. Le Dieu horloger, son office achevé, est inoccupé. C’est un « Dieu fainéant ». L’idéal souriant du gouvernant oisif, qui regarderait tourner la machine, n’est pas absente du paysage politique théorique des « Lumières ». L’ingénieuse « société d’automates – quatre-vingt-six, grandeur nature – que se fait fabriquer en 1742 le roi de Pologne et Duc de Lorraine Stanislas, où chaque fonction économique est assumée par une aimable figurine articulée symbolise assez bien ce modèle de souverain spectateur attendri d’une mécanique allant d’elle-même et sans à-coups. Robespierre imprégné de Rousseau parle de « chef-d’œuvre » social : le gouvernement, de fait, ne serait plus surmené. Il n’est pas étonnant que l’idée s’en répande sous la Révolution, qui tue à la tâche les gouvernants qu’elle ne tronçonne pas – encore que l’un n’empêche pas l’autre. Quoi qu’il en soit, les citoyens perfectionnés dont Cabanis rumine le remodelage seront moins éloignés de l’homme idéal vu par Robespierre, ou des automates du roi Stanislas, que du surhomme, qu’au demeurant nous pouvons bien imaginer ingouvernable. C’est pour la « soumission », non pour la liberté, que Cabanis veut corriger en l’homme l’œuvre de la nature. Fiévée, conseiller secret de Bonaparte, ironise avec lucidité en 1803 sur le sujet : « En se chargeant de refaire l’homme, ils n’oublieront pas sans doute de lui donner une intelligence convenable et une « volonté soumise » … « une volonté soumise à la société européenne qui va définitivement garantir la « prospérité » et la « sûreté » de tous les États ». Cabanis évoquant l’aboutissement du remodelage parle de « raison perfectionnée ». Mais cette raison n’est pas celle des hommes qu’il aurait régénérés ; à lire trop vite on s’y tromperait. Elle est la raison « régénératrice », la sienne, et celle de ses semblables réformateurs. La masse d’hommes bonifiée n’est pas dotée de la « raison perfectionnée » : sa bonification en est le fruit, la création. Ce n’est pas la même chose. Plus précisément c’est même sous le rapport de l’aplatissement égalitariste que l’homme rénové, selon Cabanis, « serait […] une création des lumières et de la raison perfectionnée ». Lorsqu’il discourt à l’Institut, la raison est donc là, déjà perfectionnée, mais c’est la sienne – et c’est celle tout au plus des autres philosophes – une infime pincée d’hommes, « la fleur de la nation », « la fleur du genre humain », comme écrivait Voltaire. Le surhomme est trouvé, c’est Cabanis lui-même, car son regard et l’intention de sa démarche sont « sur-humains » – à tout le moins sont au-dessus des autres hommes, des « collections d’hommes prises en masse » selon son expression. Cabanis et ses proches ou analogues se voient tellement au-dessus du lot qu’il applaudit à l’idée de Drap-Arnaud de classifier les races selon l’intelligence. Vous avez dit « Lumières » berceau de la tolérance et de l’antiracisme ? Les races n’existent pas ? Drap-Arnaud a le dessein de dresser une « échelle idéologique » des races – c’est-à-dire une évaluation comparée de leur aptitude à produire des idées. Cabanis y voit un « beau plan d’expériences pour déterminer le degré respectif d’intelligence ou de sensibilité propre aux différentes races » (Cabanis, Rapports, p.535). Cabanis appartient à un milieu mental, celui des « Lumières », où le souci d’emprise totale sur l’intériorité des autres, dans le dessein de les guider ou de les changer, est une composante de tout premier rang – quoi qu’on nous chante. Si l’on en croit Regaldo, un connaisseur du sujet (Un Milieu intellectuel : la Décadence philosophique, 1794-1807, thèse Paris IV 1976), « De toutes les doctrines philosophiques, il n’y en avait point de plus totalitaire que celle des idéologues », dont Cabanis est le chef de file.

Le funeste Maximilien Robespierre
Depuis la théorisation faite par les penseurs des « Lumières » (que l’on nous présente répétons-le comme un panthéon de héros) sur l’espèce humaine, nous sommes donc des pions à la cervelle définie dans un standard moyen au service d’une petite « élite » politique, industrielle, médiatique, qui nous utilise à son profit, avec autant que faire se peut le moindre effort pour elle. De par ce modèle perpétué sans interruption depuis, nous ne sommes pour la ploutocratie apatride actuelle que du matériau, du rat de laboratoire, des enfants que l’on manœuvre, du stock interchangeable et standardisé, dont on ajuste la quantité en fonction de ce que l’on estime être les besoins, et dont la pensée, les choix, les origines, les attachements nationaux, n’ont aucune importance, du moment que nous sommes votant, consommateur, et une force de travail docile. L’Homme n’est que cela pour cette pensée. C’est l’affreuse réalité du genre humain à laquelle ils sont parvenus depuis le XVIIIème siècle. Aldous Huxley dans le Meilleur des mondes l’a parfaitement formulé avec les cinq catégories d’humains, des Alpha aux Epsilon. Ne croyez pas qu’il s’agisse en l’occurrence d’un délire au prétexte que ça figure dans un roman. On sent mieux désormais le rapport établi entre, d’une part le monde politique et les structures de pouvoir, et d’autre part leur cher « citoyen ». Nous sommes « libres », nous sommes « souverains », et intelligents puisqu’on nous a donné le droit de voter. Mais comme on nous dit de le faire, pas pour quoi que ce soit qui les priverait de leur pouvoir. Tocqueville disait que la démocratie ne l’inquiétait pas, parce que le peuple votera comme on lui dira de voter.
La franc-maçonnerie.
Alors que les idées des Lumières ont commencé à faire leur apparition dans la seconde moitié du XVIIème, arrive au début du siècle suivant la franc-maçonnerie, d’abord en Écosse avant de se répandre sur le reste du Royaume-Uni. La date officiellement retenue pour ses débuts anglais est 1717 à Londres, dans la taverne L’Oie et le Grill. Au sortir des massacres engendrés par les guerres de religions entre catholiques et protestants, des hommes disent en somme « plus jamais ça ». L’un des objectifs avoués de ce mouvement est de dépasser les dogmes religieux, et de rassembler les hommes au-delà de leurs croyances, en se fondant sur des symboles universels. Une démarche à priori sympathique d’éradication des conflits donc, de philanthropie, qu’en soi on ne saurait blâmer, même si elle relève de l’utopie : réaliser la grande fraternité des hommes sur cette Terre. Bien plus que cela en réalité. Elle s’annonce comme un mouvement philosophique, de recherche mystique de la « vérité » sur le sens de la vie et la condition humaine, avec pour but que ceux qui la rejoignent fassent un travail intérieur d’amélioration, lequel aboutira à la Paix universelle quand les maçons seront suffisamment nombreux et influents à travers le monde. Mais son usage va dériver dans l’hétérotélie. L’histoire du mouvement n’est pas inintéressante. Mais faisons simple, l’essentiel pour la compréhension du sujet « Révolution française et société actuelle ».
Jean Théophile Desaguliers, pasteur anglican d’origine française, d’une famille de La Rochelle, est l’un des fondateurs de la franc-maçonnerie. Les textes sur laquelle elle repose, datant de 1723, sont les « Constitutions d’Anderson », de James Anderson, également pasteur. La franc-maçonnerie est donc irréfutablement marquée d’inspiration protestante, une sorte de « contre-Église » si l’on peut dire, en opposition à Rome, toujours avec l’idée d’universalisme commune au christianisme, mais dépassant les dogmes religieux historiques comme nous l’avons dit. C’est un mouvement élitiste, lié à l’aristocratie, il a toujours été le soutien de la monarchie anglaise. Le Grand Maître de la maçonnerie britannique n’est autre que le monarque régnant, et tous les actes protocolaires de la Couronne d’Angleterre sont francs-maçons. En Angleterre, ce n’est donc pas un mouvement révolutionnaire, mais au contraire ultra-conservateur.
La pratique de la franc-maçonnerie est apparemment introduite en France en 1728 (donc onze ans après sa création officielle britannique), par le parti Jacobite exilé suite au renversement de Jacques II de la dynastie des Stuart. Une Grande Loge de France est créée, d’abord tenue par des nobles anglais, dont une ramification davantage « nationale française » deviendra en 1773 le Grand Orient de France. Pourquoi « Orient » dans ce nom ? Le protestantisme, comme le catholicisme, c’est la Bible, donc une histoire d’Hébreux. Par ailleurs, les premiers maçons du XVIIIème siècle, dits « spéculatifs » (par rapport aux maçons des chantiers médiévaux, dits « opératifs » puisque taillant la pierre, opérant véritablement sur la matière), en tant que « bâtisseurs d’un monde nouveau » se revendiquent comme héritiers des bâtisseurs de cathédrales. La symbolique de l’architecture est omniprésente chez eux, c’est bien connu. Équerre, compas, figure géométrique du triangle équilatéral, mais pas seulement. Les maçons bâtisseurs de cathédrales auraient fait remonter leur référence à Hiram, l’architecte du Temple de Salomon. Hiram meurt assassiné par trois de ses ouvriers sans révéler ses « secrets de fabrication », que ces ouvriers tentaient de lui extirper. Hiram conserve ses secrets, au prix de sa vie. La référence au secret sur ce qui se dit dans les loges vient de là. Serment prêté sous la menace du geste d’égorgement. Une mafia. La doctrine maçonnique est pétrie de judaïsme. Israël, c’est l’Orient, et selon les francs-maçons pétris de références bibliques et hébraïques, c’est de l’Orient qu’est supposée venir la lumière, la vérité. Mais certaines obédiences se rattachent à des références pharaoniques. Ce qui de toutes façons nous fait rester dans l’Orient, on n’en sort pas. Étrange reniement et rabaissement de soi, de sa propre identité européenne, penseront d’aucuns, pour adopter une doctrine extérieure et la placer au sommet de tout. Mais le christianisme, hérésie du judaïsme, était importé ici depuis le IVème siècle. Une forme d’habitude si l’on peut dire pour les peuples d’Europe amenés au reniement de soi. D’où l’introduction du mot Orient dans le nom de la Grande Loge de France. Prônant l’universalisme, qui est pour les Juifs une « identité protectrice » selon Robert Badinter, éminemment juive dans ses fondements, la franc-maçonnerie verra logiquement beaucoup de Juifs en devenir membres par la suite.
Cette « mode philosophique » va être investie par l’aristocratie française comme elle le fut de la britannique. Mais aussi dans le reste de la société. En France, celui qui deviendra Grand Maître du Grand Orient en 1773, est Louis-Philippe d’Orléans, cousin de Louis XVI, premier prince du sang (donc à qui doit revenir la couronne selon la loi de primogéniture masculine, en cas d’extinction du monarque en titre et de sa descendance), qui votera la mort du roi. Nous y reviendrons. Orléans, la première fortune du royaume à l’époque, va mettre ses moyens au développement de la maçonnerie et à la création de loges dans toutes les villes du royaume (900 loges et 40.000 membres en 1789). La franc-maçonnerie française va être avec le Club des Jacobins le laboratoire et le marionnettiste de la Révolution, malgré ce que nous chantent ses membres, toujours prompts à en minimiser le rôle, voire à dire qu’ils n’y sont pour rien au prétexte fallacieux que certains d’entre eux en sont morts. Nous y reviendrons aussi. La devise du Grand Orient de France est « Liberté Égalité Fraternité », ça vous dit quelque chose je suppose… Détail sémantique important : ses membres, en langue anglaise sont des « free-masons », des maçons libres, parce que libres penseurs par rapport aux dogmes religieux. Un nom qui est moins ambigu que sa traduction française. On sait qu’en langue française le mot initial qualifiant l’état de liberté est « franc », du nom de la tribu germanique à laquelle appartenait Clovis et qui donna son nom au pays, les Francs, des « hommes libres » qui se disaient les « fils de la guerre et du vent ». Mais le mot franc à également pris en langue française cet autre sens de franchise, parler ouvertement et de vérité. Ce qui rend le terme français franc-maçonnerie trompeur sur la nature de la chose dans l’esprit public peu informé sur le sujet, puisque le propre des francs-maçons est la dissimulation, la discrétion, et surtout l’obligation du secret, toutes choses radicalement opposées au fait de s’annoncer et de parler franchement. Pratique du secret qui ne pouvait tomber mieux pour protéger leurs agissements contre le roi, un tel complot valant évidemment à l’époque la peine capitale.
Les idées libérales économiques anglaises.
Au cours du XVIIIème siècle s’est développée une puissante bourgeoisie d’affaires, banquiers, industriels, grands commerçants, noblesse reconvertie dans le business (celle qui « dérogeait »), car concomitamment à l’essor des idées des Lumières et de la franc-maçonnerie, se fait aussi en France celui des idées libérales économiques anglaises, prémices du capitalisme qui séduisaient déjà certaines « élites » sous le règne précédent. Mais ces idées vont se heurter à des résistances royales. Un exemple à ce propos. Les finances publiques (mises à mal sous Louis XIV par la cause des guerres) avaient finalement été assainies quand Louis XV arriva au pouvoir. Vint alors la Pompadour, charriant des banquiers, des rapaces, des spéculateurs, des faiseurs d’argent par tous les moyens. Les Bernard Tapie ou les Stavisky de l’époque. Et la dette de la royauté commença de nouveau à se creuser. Des petits malins entreprirent alors d’expliquer au roi qu’on pouvait enrichir tout le monde sans appauvrir personne. Les Quesnay, Turgot, toute l’Encyclopédie pour ainsi dire, tentèrent de démontrer à la royauté qu’en cessant d’établir le pouvoir sur ce qui était, pour préférer des « valeurs sûres » comme le « profit », la « raison », etc. on allait arranger tout le monde. Les Lumières, c’est aussi le libéralisme, le « doux commerce » de Montesquieu, la « main invisible » d’Adam Smith et les théories du marché empruntées aux Britanniques. Bien que dénué de naïveté, Louis XV se laissa tout de même tenter par l’expérience de l’économie libérale. Cela mit les Français dans la rue, à partir de 1763. Il revint donc sur sa décision et rétablit par exemple la Police des grains qui avait été suspendue pour la circonstance. Car sous l’Ancien Régime, cette police présente dans toutes les villes faisait le tour des marchés pour veiller à ce que personne n’exagère sur les prix afin que tout le monde puisse avoir du pain. Un marchand exagérant ses marges était considéré en tant que criminel. Mais à peine le jeune Louis XVI davantage influençable assis sur le trône (1774), Turgot en 1775 libéralisa définitivement le prix des subsistances et de la farine. De là, ce ne fut plus la police qui allait régler le prix du grain, mais le sacro-saint marché. Plus de contrôles, de règlements. On objecta à Turgot que le prix du grain allait augmenter. Il n’en tint pas compte, et c’est évidemment ce qui se passera. Dès que ces idées libérales furent mises en œuvre, elles plongèrent la population dans les difficultés. Il y a assurément un problème de gouvernance de Louis XVI, pas assez lucide sur ce que font ses ministres. Il le paiera à la place des architectes du chaos économique et des crises frumentaires de ces temps planqués derrière la responsabilité royale aux yeux de l’opinion, tout dans le fonctionnement de la France d’Ancien Régime étant fait « au nom du roi ». Necker, banquier genevois remplacera Turgot. A l’approche de la fin du XVIIIème siècle, la France subit une récession et le chômage sévit depuis 1787. Cette bourgeoisie d’affaires, désormais forte de son rôle économique, en vient à considérer qu’il « faut compter avec elle » dans la direction du pays, elle conteste le leadership royal qui jusque-là avait été respectueusement accepté. C’est ce que l’avocat grenoblois et révolutionnaire Antoine Barnave, membre du Club des Jacobins, résumera en 1790 par cette formule explicite sur les intentions des puissances financières : « Une nouvelle distribution de la richesse appelle une nouvelle distribution du pouvoir ». Désormais, qui tient le fric ne se contente plus de cela et de financer au besoin les emprunts royaux. Qui tient le fric veut être le maître. Mayer Rothschild, le fondateur de sa dynastie financière, ne dira pas autre chose : « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois ». Deux moteurs meuvent la noblesse dérogeante et la bourgeoisie d’affaires : l’envie, et le business. Noblesse dérogeante et bourgeoisie d’affaires sont envieuses du pouvoir royal. Napoléon Ier, après avoir servi la Révolution et s’être fait grâce à elle, la ramène en 1811 à des ambitions de médiocres bourgeois, et dira : « Qu’est-ce qui a fait la Révolution ? la vanité. La liberté n’a été qu’un prétexte ». Mais noblesse dérogeante et bourgeoisie d’affaires veulent aussi modeler une société dont elles auront le contrôle, pour servir leurs intérêts, développer leur pratique du business empruntée aux Britanniques. La Révolution ne sera qu’un coup d’État mené par cette minorité agissante instrumentalisant le peuple se débattant dans les difficultés économiques. Nobles ou bourgeois, une partie du pays cumule son statut avec l’adhésion à tout ou partie des idées du moment, Lumières, franc-maçonnerie, libéralisme économique anglo-saxon.
La guerre des Farines.
Au chômage, s’ajoutent de terribles intempéries, notamment en 1788, qui amoindrissent les récoltes. Un contexte qui servira amplement les acteurs qui préparent le soulèvement. La fin justifiant les moyens, des spéculateurs dans le circuit de distribution, sans doute pour certains liés au projet révolutionnaire, feront bientôt monter les prix (+62% d’augmentation moyenne des prix des blés), comme levier forçant la population à l’insurrection, en organisant la pénurie, en escamotant des stocks, ce que l’on a appelé les « accapareurs » de cet épisode dit de la « guerre des Farines ».
Les impossibles réformes.
La France était en déficit budgétaire, qui se trouvait amplifié par le financement de la guerre d’indépendance américaine soutenue par la France comme on le sait contre sa principale rivale l’Angleterre. En août 1786, Calonne, contrôleur général de Louis XVI lui propose une réforme en profondeur du royaume, particulièrement dans le domaine fiscal, où les désordres de l’administration et les injustices les plus criantes rendaient impossible une bonne rentabilité de l’impôt. Il s’agissait entre autres mesures de créer un nouvel impôt direct, payable en nature, la subvention territoriale, contribution à laquelle seraient enfin assujettis tous les revenus fonciers, qu’ils fussent ecclésiastiques, nobles ou roturiers. Thérapie de choc visant à éradiquer les abus, un programme de rationalisation de l’État, tendant à une égalité fiscale qui aurait sans nul doute transformé le visage de la monarchie française. Sur les décombres de la chaotique organisation sociale issue de la nuit des temps et faite d’un enchevêtrement de corps, d’ordres et de statuts particuliers, il s’agissait d’édifier une monarchie administrative rénovée, associant les élites à la répartition de l’impôt. Une révolution, mais une révolution royale, qui devait affermir la souveraineté monarchique et fiscaliser la noblesse, en lui conservant une simple prééminence honorifique. Au vu de la façon dont ont tourné les événements, on peut déplorer que ce projet ait été ruiné par des résistances de toutes sortes. Ce plan heurtait de front des intérêts et des puissances redoutables, l’Église de France, l’aristocratie, la haute noblesse d’épée et la noblesse de robe. Il n’était pas nécessaire d’en rajouter aux difficultés rencontrées pour le mettre en œuvre. Or, Louis XVI au début de son règne, sous la pression insistante de son principal conseiller le comte de Maurepas, a rétabli les anciens parlements de province que son grand-père Louis XV avait exilé en 1771. Autant de verrous et de résistances supplémentaires contre la politique de réformes à venir sur proposition de Calonne. Or, on l’a vu, la monarchie française est faite d’une multitude de contre-pouvoirs, le roi ne fait pas ce qu’il veut. Les parlements rétablis, pour donner ensuite effet et force de loi aux mesures du plan Calonne, il fallait présenter celles-ci pour enregistrement auprès de ces corps judiciaires ultraconservateurs, composés de robins, propriétaires de leurs charges, farouchement indépendants. Le roi aurait pu leur imposer ce plan par une procédure appelée « lit de justice ». Il préféra ne pas user de contrainte, ne voulant pas passer pour un dictateur. Soumettre la décision à une réunion des états généraux ? Solution écartée également. Calonne décide alors de procéder avant tout à un sondage, une consultation de notables, une assemblée de 144 membres triés sur le volet, représentant le haut clergé, la noblesse d’épée et de robe, l’administration royale et les municipalités, réunie en février 1787. Calonne est persuadé que cette assemblée comprendra malgré tout le langage de la raison et consentira aux sacrifices financiers indispensables. Le projet de révolution royale et sociale se heurte immédiatement à une vigoureuse opposition arc-boutée sur des droits acquis, déclenchant de la part des milieux aristocratiques et ecclésiastiques une contre-révolution qui prit la forme d’une révolte nobiliaire. Le haut clergé (composé exclusivement de nobles) et la haute noblesse réclament alors la convocation des états généraux, seuls compétents, selon eux, pour décider d’un nouvel impôt. Cette institution regroupant la noblesse, le clergé, et le tiers état votant par ordres et non par têtes, ils étaient évidemment certains que les deux premiers ordres ne voteraient aucune réforme remettant fondamentalement en cause les privilèges fiscaux attachés à la division trifonctionnelle de la société issue du Moyen-Age. Les états généraux étaient aussi un excellent moyen, pour peu qu’on les rendit périodiques, voire permanents, d’anéantir tout le travail de centralisation fait autour de la personne royale. L’aristocratie et la cour n’avaient que cette idée en tête depuis 1715 : prendre leur revanche, notamment sur Louis XIV. Une idéologie réactionnaire, au sens étymologique du terme, les animait. Il s’agissait pour eux de revenir à une monarchie décentralisée, antérieure, à partis, de limiter le pouvoir royal en associant les élites et les corps intermédiaires au gouvernement du royaume, à « l’anglaise ». L’opposition au roi se souda en un vaste front aux intérêts divergents, allant des princes du sang et des ducs et pairs aux petits bourgeois et artisans des villes. Ce qu’il est édifiant de remarquer c’est que face à ce front, Louis XVI et Calonne lancent un appel à l’opinion publique le 1er avril 1787. Ce texte largement diffusé expliquait que la fiscalisation des deux ordres privilégiés permettrait de soulager le peuple d’une charge de près de 30 millions de livres et disait en substance : « Des privilèges seront sacrifiés ; oui, la justice le veut, le besoin l’exige. Vaudrait-il mieux surcharger encore les non-privilégiés, le peuple ? Il y aura de grandes réclamations… On s’y est attendu. Peut-on vouloir le bien général sans froisser quelques intérêts particuliers ? Réforme-t-on sans qu’il y ait des plaintes ? ». En vain. Le pouvoir royal, réformateur et modernisateur, se heurte à une société bloquée, défendant plus ou moins consciemment du haut en bas de l’échelle sociale la société de corps et d’ordres. La suite n’est qu’une succession d’actes juridiques et sociaux s’opposant de part et d’autre. Mais toutes les réformes équitables de modernisation qu’a pu proposer le gouvernement ont été considérées comme « sombre despotisme ». On imposa au roi des états généraux pour le 5 mai 1789. L’idée était apparue que la représentation du tiers-état aux états généraux soit doublée. Sans arriver à une représentation proportionnelle (le tiers-état constituait la majeure partie de la population), cela aurait permis un certain rééquilibrage, tenant compte des profondes mutations sociales intervenues depuis des siècles. Louis XVI se prononça en faveur de cette double représentation du tiers état. Il en accepta même une tenue périodique, première étape d’un système de monarchie constitutionnelle. Pour tenir compte de la volonté populaire, il a bousculé jusqu’à la sacro-sainte constitution coutumière de son royaume, défendue par ses prédécesseurs. Un roi non réformateur Louis XVI ? Tout le contraire. Mais la France au cours de son histoire a toujours été incapable d’accepter des transformations consensuelles, elle ne réforme pas dans l’intelligence, elle ne se transforme que par crises, dans la douleur et le sang. Jacques Marseille en a fait en 2006 le sujet de son très intéressant ouvrage Du bon usage de la guerre civile en France.
L’Ancien Régime, c’était le bon temps.
Que des royalistes puissent le dire, on n’en serait pas surpris. Mais il est intéressant de l’entendre de l’aveu même de divers grands noms des Lumières, de partisans de la tourmente révolutionnaire et de ses lendemains.
– « Nous sommes trop heureux, me disait ma femme, il nous arrivera quelque malheur. Elle avait bien raison ! » (Marmontel, mémoires écrites vers 1798).
– « Dans aucun temps, dans aucun pays, sous quelque forme de gouvernement que ce soit, jamais la liberté de penser n’a été plus grande qu’en France, au temps de la monarchie » (Chateaubriand, Génie du Christianisme, 1802).
– « Nous n’avons jamais été aussi esclaves que depuis que nous sommes républicains, si rampants que depuis que nous avons le chapeau sur la tête » (Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier, 1794, p. 110).
La France royale selon Voltaire « Un gouvernement monarchique tempéré par des mœurs douces » (Essai sur les Mœurs et l’Esprit des Nations et sur les principaux faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIII, p. 833).
– « Je défie qu’on me montre aucune monarchie sur la terre dans laquelle les lois, la justice distributive, les droits de l’humanité, aient été moins foulés aux pieds, et où l’on ait fait de plus grandes choses pour le bien public que pendant les cinquante dernières années que Louis XIV régna lui-même » (Voltaire, Supplément au Siècle de Louis XIV, 1753, p. 329).
– Les despotismes orientaux n’ont pas « le moindre rapport avec notre monarchie gouvernée par les lois, et surtout par les mœurs » (Voltaire, Correspondance, 1771, p. 449).
– « Il y a plus de véritable liberté dans les Monarchies, que dans nos Républiques » (J.J.Rousseau, Œuvres complètes, Coll. Pléiade, tome 3).
– « Jamais le gouvernement n’a montré un esprit d’humanité plus éclairé, plus suivi, ni plus de respect pour les droits des classes inférieures de la société » (Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des nègres, 1781).
– Un gouvernement « doux et humain, aujourd’hui plus doux et plus humain qu’il ne l’a jamais été depuis la mort de Henri IV » (Mercier, Tableau de Paris, 1780, republié en 1994, tome 2 p. 723, 732).
– « Les Français ne sont pas asservis ; les mœurs s’opposent au pouvoir absolu, et le rendent modéré, civil, policé, lui ordonnent des égards et des ménagements. La puissance du souverain est prudente, circonspecte, et ne trouble point la sécurité continuelle où l’on voit la nation » (Mercier, Tableau de Paris, 1780, republié en 1994, tome 2 p. 420).
– En France monarchique « Vingt-deux millions d’hommes paisibles et non asservis, jouissant de leurs privilèges garantis par la main qui les gouverne, offrent, à tout prendre, une administration qui n’est pas malheureuse » (Mercier toujours).
– Que les hommes réfléchissent avertit Montesquieu « il n’est pas impossible qu’ils vivent dans un gouvernement heureux sans le sentir : le bonheur politique étant tel qu’on ne le connaît qu’après l’avoir perdu » (Montesquieu, Cahiers, p. 109).
– « Je voudrais que le roi de France remontât sur le trône, que la Nation reconnût qu’il en est descendu pour le malheur de la France » (l’icône féministe Olympe de Gouges, dans ses Ecrits Politiques, 24 avril 1790). Au fil des saisons révolutionnaires, la vérité se fait évidence dans les esprits : la monarchie, c’était le bon temps.
– L’Américain Morris relate dans les mêmes temps que selon son tailleur, par ailleurs officier de la garde nationale, « l’ancien régime, dont on se plaignait tant, n’a jamais jeté une telle perturbation dans la vie » « le système actuel rend toute vie intolérable, soit en lui causant un mal réel, soit par la crainte constante de maux à venir » (Morris, Journal, p. 305, 20 mai 1792).
On l’aura compris, le système royal de l’Ancien Régime, au fil des saisons, est un despotisme où il fait bon vivre.
En guise de tyrannie, la situation ressemble plutôt au contraire à un déficit d’autorité du roi. De façon générale, l’idée est présente que le pouvoir royal péchait essentiellement par le manque de fermeté, et que l’embarrassaient trop de contre-pouvoirs.
La République « fut commencée par le désir et le besoin d’un gouvernement » selon Baudin des Ardennes, pointant la mollesse du pouvoir, le 18 août 1795 à la Convention.
Le vœu de tous, selon Olympe de Gouges encore, dès le cœur de l’été 1789 ? « L’autorité du roi affermie pour le bien général » (dans L’Ordre National ou le comte d’Artois).
Ménétra, ex-militant révolutionnaire, va geindre après coup « Cette révolution eut dû faire le bonheur de la France en raffermissant le roi sur son trône » (Ménétra, Journal de ma vie, p. 259).
Deux hommes, une seule couronne.
La Révolution française, c’est aussi une dramatique affaire de famille, la jalousie d’un prince envers le dépositaire de la couronne. L’un et l’autre incarnent la continuité capétienne.
Louis XVI
Peu de choses à dire, l’essentiel est connu, un homme réputé bon, non dénué d’intelligence et de culture, doté d’une excellente mémoire, parlant plusieurs langues étrangères, beaucoup plus complexe qu’on ne l’a présenté, difficile à saisir. Son frère (le futur Louis XVIII) le compare à « deux boules de billard huilées que l’on s’efforcerait de tenir ensemble ». Il agira avec intelligence et courage sur le plan intérieur et international, surtout en 1792. Courage dont il n’a pas manqué, son attitude sur l’échafaud le montre définitivement. En tout état de cause Louis XVI n’est pas le « tyran profiteur et indifférent » dépeint par la propagande républicaine. Il a tenté de mettre en place des réformes. Il a par exemple remplacé la corvée par un impôt payable par tous. Il a tenté de pratiquer un libéralisme aristocratique fondé sur des économies budgétaires et la réforme des dépenses de la cour. Il se heurtera à de fortes oppositions corporatistes. Louis XVI est pleinement conscient de la figure de père du peuple que la fonction royale française associe au dépositaire de la couronne. La formation au métier de Roi de France n’ignore pas la doctrine médiévale du juriste Aeneas Silvius : « Le prince lui-même, tête du corps mystique de la respublica, est tenu de sacrifier sa vie chaque fois que le bien commun l’exige ». Benjamin Franklin qui avait rencontré Louis XVI dira de lui : « Sans doute nul souverain qui a jamais régné n’a eu plus de bonté dans son cœur, ni n’a possédé davantage le lait de la tendresse humaine que Louis XVI ». Qualité qui semble avoir été l’apanage de sa lignée, à l’exception peut-être de son cousin d’Orléans. John Adams, deuxième président des Etats-Unis, dans une lettre à Thomas Jefferson en 1814 dira que « le lait de la tendresse humaine des Bourbons donne plus de sûreté à l’humanité que l’ambition démesurée de Napoléon ».
Louis-Philippe d’Orléans
Cousin de Louis XVI, il est comme on l’a vu au paragraphe sur la franc-maçonnerie premier prince du sang dans l’ordre découlant de la loi de primogéniture masculine. Louis-Philippe d’Orléans est donc un « roi inachevé » comme on l’a vu au paragraphe définissant le principe de dynastie, disponible, mais qui ne se satisfait pas de demeurer dans cette situation. La Maison d’Orléans est totalement imprégnée de mode anglaise, jusque dans la décoration et l’ameublement. Initié franc-maçon, le chef des Orléans est placé à la tête du Grand Orient de France à sa création en en 1773. Il incarne le courant libéral qui envahit les esprits à la veille de la Révolution. A Paris, le Palais-Royal, ensemble urbain situé au nord du palais du Louvre, est le palais des Orléans (il abrite aujourd’hui le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel, et le ministère de la Culture).
III – La Révolution
Avant tout, il faut garder à l’esprit que les journées qui ont fait la Révolution se jouent essentiellement à Paris, avec la population urbaine de la capitale. Il y aura des épisodes provinciaux, mais la Révolution n’est pas un phénomène généralisé et uniforme dans le royaume. Malgré le maillage du territoire mis en place par le Club des Jacobins, qui ouvrira 150 filiales propagandistes, la Révolution n’emporte pas l’engouement populaire partout, loin de là. Des villes et des provinces refuseront ce qui est en train de se passer, et lutteront les armes à la main pour le roi, au prix du sang, comme en Vendée, que nous aborderons par la suite. Le totalitarisme révolutionnaire ne s’imposera sur l’ensemble du territoire que par la Terreur commanditée depuis Paris. Car en 1792 encore, les républicains ne sont qu’une minorité infime, comme l’écrit Danton devenu ministre de la Justice. Le reste de la France est attaché à la royauté. Et une minorité infime d’activistes n’a pas d’autre outil que la Terreur pour s’imposer à tous (Lénine, Pol Pot, et les autres totalitaires communistes du XXè siècle, sur ce modèle français, agiront de même).
D’où procède donc le régicide ? La Révolution ne saurait se réduire à des causes purement matérielles, sociologiques ou économiques. S’il y a bien ici et là des crises et des disettes, elles ne peuvent motiver par elles-mêmes que des révoltes, mais non des révolutions – tant le régime, à l’époque, est perçu comme légitime. On en conclut qu’une dimension spirituelle et idéologique est nécessaire pour catalyser les mécontentements et les ambitions inassouvies, et pousser à un changement de régime et de civilisation qui, au départ, n’est voulu de personne. L’esprit de la Révolution et l’esprit du christianisme se combattent en une nouvelle guerre de religion, le premier, malgré les apparences, demeurant aussi religieux que l’esprit du christianisme.
Il y aura en fait deux Révolutions. La première, aristocratique bourgeoise et libérale donc, gagnée aux « Lumières », instrumentalisant le peuple. Cette bourgeoisie « éclairée », forte de sa richesse, de la culture qu’elle a acquise, des magistratures qui lui ont été confiées, ne supporte plus sa position socialement subordonnée. Cependant elle n’ambitionne pas seulement le pouvoir : elle veut modifier une organisation sociale et un univers de représentations mentales qui la plaçaient dans une situation inférieure, le ressentiment, converti en haine constituant un ressort majeur du phénomène. Il s’agit finalement de détruire les ordres, l’organisation territoriale, les parlers locaux, mais surtout la religion, socle de la société traditionnelle que la franc-maçonnerie veut réduire. Rien ne doit être conservé de l’ancien système, dont chacun des éléments était articulé aux autres et les supposait. Puis la seconde Révolution, dans laquelle le Frankenstein (ou le Golem, pour rester dans les références juives liées à la maçonnerie), la créature, échappe à son manipulateur, révolution populaire et violente, celle de la Terreur, où les initiateurs ont momentanément perdu la main. L’union du mouvement scientiste des Lumières, des intérêts de la bourgeoisie d’affaires et de la franc-maçonnerie, forgera le vent de contestation de l’Ordre ancien, qui dérivera momentanément vers la Terreur (avec des divergences, Robespierre par exemple croit à l’existence de l’âme et à son immortalité), et les massacres de la haine de classe, jusqu’ au Directoire six ans plus tard.
1789 – 1791. La Première Révolution
Situation générale.
Suite au refus de la haute noblesse et de l’Église de participer à l’effort fiscal demandé par le roi et Calonne, la situation budgétaire de l’État s’est aggravée. De plus, en raison d’un automne et d’un hiver très rigoureux, la misère avait gagné les campagnes, jetant sur les routes des milliers de désœuvrés et de chômeurs. L’État est désargenté, et la prospérité passée du pays profond qui avait pu exister ça ou là, a du plomb dans l’aile. La disette, voire dans certaines zones la famine, menaçait. La question du ravitaillement des villes devenait épineuse, malgré le retour au contrôle des approvisionnements de la police des grains et les achats de farine à l’étranger. Le prix du pain atteindra le 14 juillet 1789 un record. Le climat social s’alourdit. Un climat pré-insurrectionnel. On ne compte plus les pillages de boulangeries, de greniers à sel ou de granges dîmières.
Les Jacobins.
Malgré la ressemblance, leur nom est apparemment sans rapport avec le parti Jacobite importateur en France de la franc-maçonnerie, mais tiré du fait que le Club qui a donné son nom à ce groupe d’activistes se réunissait dans l’ancien couvent des Jacobins à Paris. Ils sont les « Amis de la Constitution » en gestation, selon leur nom initial. Le vicomte de Mirabeau en est la figure la plus influente durant les premières années du Club. Partisans de la centralisation et d’un État dominateur, ces fanatiques seront indissociables du Comité de salut public et de la Terreur à venir.
Le Palais-Royal.
En 1789, le Palais-Royal, de l’avis de tous les contemporains, est le foyer le plus agité de Paris. Assurée de l’impunité par le privilège judiciaire (notre « immunité » parlementaire ou présidentielle actuelle si l’on peut dire) dont bénéficiaient les palais des princes du sang, une foule de plumitifs, d’agioteurs, de « gens du demi-monde » et moins recommandables encore fréquentent les cafés, les librairies, les maisons de rendez-vous des galeries du palais. Clubs et salons y attirent le plus beau monde de la « philosophie ». A l’approche du 14 juillet 1789, le libraire Hardy parle de « la fermentation extraordinaire, l’effervescence redoutable qui se rallumait au Palais-Royal ». Un nommé Arthur Young, en voyage à travers la France, déclare son étonnement « que le ministère permette de tels nids et de tels foyers de sédition et de révolte ». La France de Louis XVI, quel enfer d’arbitraire et de privation de liberté ! Fort de son immunité, le Palais-Royal des Orléans accueille les déserteurs, les acclame, leur fournit le vivre et le couvert. Avant les événements, l’endroit apparait comme le lieu ou des factions préparent à l’émeute ; et pendant, comme base opérationnelle. Dès le mois de juillet 1789, des listes de proscription y circulent, où curieusement y figurent déjà les noms de futures victimes, notamment Launay (commandant de la Bastille) et Flesselles (prévôt des marchands de Paris). Toute l’agitation du Palais-Royal est donc parfaitement visible. Si le cousin du roi est bien à l’origine ou du moins le cœur du complot, il est aussi un conspirateur d’une « nouvelle espèce » car il ne pouvait conspirer avec plus de bruit. Montjoie, dans son Histoire de la conjuration en 1796, assure que les agents du duc d’Orléans contrôlaient et détournaient les convois de vivres destinés à Paris, tandis que l’on procédait, en son nom même, à des distributions gratuites au Palais-Royal. La manœuvre est limpide, répandre la disette en ville, pour pousser les parisiens à la révolte, tout en assurant sa propre intendance.
1789 – 1791. La Première Révolution
Un complot Orléaniste, en parallèle aux difficultés du roi à réformer.
Les éléments ne laissent aucun doute sur un vaste complot orléaniste, dont l’objectif pour le duc d’Orléans ne semble pas tant la destruction de la royauté elle-même, mais son élévation sur le trône en remplacement de son cousin, dans le cadre d’institutions libérales à l’anglaise. On commence à relater le rôle du duc d’Orléans dans les émeutes d’août 1788, rôle relevé par l’enquête de police du Châtelet dans l’émeute dite Réveillon d’avril 1789. On l’a dit, Orléans est la première fortune de France. Il mettra sa puissance financière au service de l’entreprise révolutionnaire, rémunération des exécutants et de leurs moyens, des propagandistes « permanents » tels que les concevra en son temps Lénine au service de la révolution, entretient de la calomnie et de la déconsidération du couple royal. Le bailli de Virieu, ministre de la cour de Parme à Paris, affirme : « Ce n’est pas sans raisons qu’on a conjecturé que le tumulte est provoqué par des gens payés par un très haut personnage. On rougit de le nommer ». Louis XVI dénoncera d’ailleurs son cousin comme le principal artisan de sa chute. Pour certains observateurs contemporains des événements, la conspiration est tramée de longue date, fomentée à Passy, dans une maison « qu’un prince avait louée », où s’assemblent les principaux initiés organisateurs de la propagande, et des motions à produire à l’Assemblée. Le plan d’action concerté consiste à hisser d’Orléans au pouvoir. La réunion et le triomphe du tiers état entraient bien sûr dans ce plan, mais, plus précisément, il apparaît que le duc d’Orléans ait assumé les risques d’attiser dans la capitale un climat d’insurrection par la diffusion de la peur de la disette, favorable à ses ambitions politiques. La lecture de certains témoignages laisse cependant entendre une manipulation de Philippe d’Orléans, prince ambitieux mais timide, instrumentalisé, tant pour sa fortune que pour les avantages de sa position, par les concepteurs et acteurs fondamentaux du coup d’Etat à venir, leur « idiot utile » en quelque sorte. C’est la thèse d’un complot de la franc-maçonnerie, qui se recoupe évidemment par le fait qu’elle a placé à sa tête ce bien utile prince qui, depuis vingt ans, a investi des sommes considérables dans la réorganisation des loges à laquelle a participé activement son Chancelier Choderlos de Laclos, membre des Jacobins. L’alliance du duc d’Orléans et du réseau maçonnique résulte manifestement de la convergence des ambitions de l’un et des buts de l’autre. Mondain, vaniteux, superficiel, animé d’une haine profonde pour la branche aînée de sa famille, Philippe d’Orléans devait être un bailleur de fonds irremplaçable et un protecteur efficace, si on lui donnait l’illusion qu’il était le chef. Le réseau des loges usa de l’appui orléaniste conformément à une stratégie déjà éprouvée : l’utilisation de la position exceptionnelle d’un médiocre. Tandis que le duc conspirateur se voit cantonné au rôle de pourvoyeur de fonds, le déroulement des émeutes de juillet 1789 rend saisissante la présence continuelle de membres des loges à tous les échelons de l’action, et dans toutes les initiatives importantes, y compris dans le noyautage et la défection des troupes (les loges militaires s’étant multipliées), spécialement des gardes-françaises, au moment des émeutes. On trouve les noms de membres présents dans les listes des loges conservées au Fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale de France. La maçonnerie a dirigé le mouvement. Certains auteurs évoquent aussi la figure de Necker, rappelé aux finances par le roi en 1788, renvoyé un an plus tard, et très lié aux salons, aux clubs et aux loges maçonniques. Les « capitalistes », persuadés que son départ entraînerait la banqueroute et leur ruine, ont pu participer à leur façon au renversement de l’ordre, divers banquiers, sont désignés comme ayant soudoyé l’émeute.
Les cahiers de doléances.
Les sociétés de pensée, les loges maçonniques, contribuèrent grandement à leur mise en forme et à la diffusion de modèles pré-rédigés. Ils ont été présentés par la propagande républicaine comme le catalogue interminable des lamentations et des injustices dont souffrait le peuple. Ils l’étaient probablement en partie. A titre personnel, je me souviens parfaitement de cette présentation faite dans mes cours d’histoire au collège. Mais des quelques 60.000 cahiers ressortait une aspiration générale à la liberté et au respect de la propriété privée. Beaucoup souhaitaient la suppression des lettres de cachet, la réunion périodique des états généraux, le consentement de l’impôt et de l’emprunt par une représentation nationale… Tout cela était d’ailleurs plus ou moins acquis. En revanche, et c’est un point important que ne mentionne jamais bien sûr la propagande républicaine, personne n’y remettait en cause le caractère monarchique du régime. Nombre de cahiers qualifiaient Louis XVI de « roi sauveur », « père du peuple, régénérateur de la France », « monarque libérateur », « meilleur des rois » vers qui convergeait un « transport d’amour et de reconnaissance »… Globalement, le peuple souhaitait ardemment le maintien de la vieille alliance entre la Couronne et le tiers, contre les puissants.
5 mai 1789.
Comme le montrent donc les cahiers de doléances, le roi n’était pas isolé et désavoué au moment de l’ouverture des états généraux. La France à ce moment-là aurait pu évoluer en douceur vers un nouveau régime, conduisant à la disparition de la société d’ordres découlant de la trifonctionnalité indo-européenne. Se serait substituée une monarchie constitutionnelle dotée d’une représentation permanente des peuples. De là sans doute serait née progressivement une monarchie parlementaire, qui aurait maintenu dans son principe – et c’est ce qui était important pour la stabilité de l’ordre public – la souveraineté royale. C’est ce qui était advenu à l’Angleterre, après sa Glorious Revolution de 1688. Aujourd’hui encore, en Grande-Bretagne, la reine est, en son Parlement, la « fontaine des pouvoirs ». Elle est pleinement souveraine. Pourquoi donc et comment cette marge de manœuvre dont Louis XVI disposait à l’ouverture des états généraux a-t-elle été gâchée ? Trois facteurs l’expliquent. A l’occasion de la préparation de ces états généraux en 1788, une profonde cassure se produisit dans le vaste front aux intérêts divergents qui s’était opposé au projet Calonne deux ans plus tôt, séparant d’un côté les aristocrates réactionnaires partisans d’un retour à la situation d’avant Richelieu (une monarchie limitée, décentralisée, où les féodalités retrouvaient leur poids), et de l’autre des libéraux aspirant à une monarchie constitutionnelle à l’anglaise. S’ajoutait à ces deux partis celui des aristocrates ultras animé par le comte d’Artois, opposés au retour à la situation d’avant Richelieu, donc partisans de la centralisation « Louis-quatorzienne ». Ainsi, fin 1788, trois grandes tendances se partageaient l’opinion : les aristocrates réactionnaires féodaux, les libéraux, et les aristocrates ultras « absolutistes ». Une large partie de l’entourage royal rejoignit ce dernier clan, compromettant l’évolution à l’anglaise qu’aurait pu accepter Louis XVI. Le second facteur fut le refus de Necker de proposer aux états généraux un programme détaillé des réformes. Les 1154 membres réunis pour ces états généraux se retrouvèrent ainsi livrés à eux-mêmes, sans programme à débattre, laissant sur leur faim les éléments les plus réformateurs. Des semaines furent perdues ensuite à vérifier les pouvoirs des participants, dans une vive atmosphère de tension entre les trois ordres. L’inaction engendra l’exaspération. Le dernier facteur fut la maladie du petit dauphin Louis Joseph Xavier, qui mourut de la tuberculose à sept ans, le 4 juin. Le couple royal fut évidemment accablé par ce décès. Les députés du tiers état insistèrent pour être reçus par le roi. Sans succès. Le roi, tout à sa douleur, refusa en s’interrogeant : « N’y a-t-il pas un père parmi eux ? ». Les députés bretons, particulièrement hostiles à la noblesse, tentèrent d’approcher le roi pour le soutenir dans sa volonté de réformes. La délégation fut éconduite. Le garde des Sceaux, acquis à la faction du comte d’Artois, faisait barrage devant le roi, de plus en plus isolé et enfermé dans un impénétrable silence. L’autisme apathique du pouvoir, incapable de communiquer, l’irritante aboulie du roi, l’attentisme de Necker créèrent un climat de malaise, d’incertitude et d’incompréhension qui allait vite dégénérer. L’image débonnaire et paternelle du monarque se brouilla sans doute dès ce moment-là. Ce fut en tout cas la vacuité du gouvernement royal qui déclencha le mouvement de dépossession du pouvoir du roi. L’élément déclenchant fut le refus de la noblesse de vérifier leurs pouvoirs en présence de ceux du tiers état. En réaction, ceux-ci se constituèrent en assemblée autonome, qui se proclama le 17 juin « Assemblée nationale », la Constituante. Bientôt, on verra cette assemblée réduire les pouvoirs du roi. Cette appropriation sans partage de la souveraineté par une assemblée élue rendra impraticable toute monarchie constitutionnelle, malgré la bonne volonté de Louis XVI, prêt pourtant à tenter l’expérience. Roi réformateur ayant accepté la fin de la société d’ordres, les droits de l’homme et à peu près toutes les transformations de la société civile, il aurait pu être le meilleur roi possible pour une révolution naissante, mais c’est elle finalement qui, par son intransigeance dogmatique, n’a pas voulu de lui.
14 juillet 1789, la prise de la Bastille.
On l’a vu, la Révolution n’est en rien un mouvement d’inspiration populaire, malgré la représentation qu’en donnera l’histoire officielle de la glorieuse, grandiose et sympathique épopée d’un peuple adulte et responsable qui prend son destin en main, conquérant de la Liberté qu’encense la littérature scolaire tout spécialement.
Une partie de la noblesse et la bourgeoisie d’affaires, minorité agissante, ont un intérêt commun à modifier l’ordre des choses. Mais bien sûr elles ne vont pas se salir les mains personnellement. Il leur faut un bélier à instrumentaliser, la population parisienne. L’entreprise est donc maquillée des prétextes de « libération », de mise à bas des « tyrans ». Le 14 juillet 1789 apparaît comme le point culminant d’une série d’émeutes et de violences ouverte à Paris, à partir du 12 juillet, par l’annonce du renvoi de Necker. L’émeute préparée, la date en aurait été fixée d’avance au lundi 13 juillet. Hasard du calendrier, la veille de ce jour qui verra un prix record du pain à Paris (on a vu l’évocation de la Guerre des farines, des « accapareurs », et des convois de vivres destinés à la population parisienne mais détournés par les agents du duc d’Orléans pour faire grandir le mécontentement). Dans les jours qui précèdent l’insurrection, le rôle subversif des Orléans à partir de leur base parisienne, le Palais-Royal (qui rappelons-le pour ceux qui l’ignorent n’est pas le siège du pouvoir de Louis XVI contrairement à ce que le nom de ce palais, trompeur, pourrait laisser penser, mais appartient à Louis-Philippe d’Orléans, cousin et adversaire du roi) semble se préciser. De ses jardins partent les mensonges les plus invraisemblables pour affoler le peuple : l’Assemblée va être dissoute, le duc d’Orléans et Necker sont menacés d’être égorgés par les ennemis du peuple… Le 12 juillet, des orateurs improvisés y appellent à l’émeute. Des cortèges se constituent. Des armureries sont pillées. En fin de journée, les manifestations dégénèrent. Paris était organisé en 60 districts, le 13 juillet leurs assemblées délibèrent la création de milices bourgeoises, qu’il faut armer, on court pour cela à l’Hôtel de Ville, en vain. On tient là un prétexte à relancer l’émeute. Au matin du 14 juillet, les nombreux émeutiers vont aux Invalides. Ils pillent les trente à quarante mille fusils qui se trouvaient là, des canons et un mortier. La poudre fait défaut. Une rumeur a couru qu’elle a été stockée à l’arsenal de la Bastille.
La prise de la Bastille le 14 fait figure d’acte fondateur de cette France de la Révolution. Qu’en a-t-il réellement été ? Depuis neuf heures, une foule s’était accumulée au pied de la forteresse. Spontanément à cet endroit ? Tous les émeutiers s’y rendent à leur tour. La garnison de la prison est essentiellement composée de 82 soldats invalides. A dix heures une première délégation de la Commune y est reçue par le vieux marquis de Launay, Gouverneur du lieu. On discute. Il y a des canons au sommet des tours, pointés vers le ciel, non vers la foule. Launay les fait reculer des tours. Il convie les émissaires à déjeuner. Dehors, l’émeute grossit en nombre et en violence. Vers le milieu du jour, les émeutiers attaquent le premier pont. A l’approche de la forteresse elle-même, ils doivent être repoussés par une fusillade qui provoque une panique et leur repli. On tire en vain sur la forteresse durant des heures pendant que deux autres délégations seront reçues. En milieu d’après-midi un détachement des gardes-françaises arrive, se rallie aux émeutiers, et pointe deux canons en face du pont-levis intérieur. C’est cette action qui détermine Launay à recevoir une quatrième délégation. Il accepte la reddition en échange de la promesse qu’aucun mal ne sera fait à la garnison. C’est important de le marteler et de démonter la propagande républicaine sur un « combat acharné et glorieux » : il n’y a eu aucune prise par le combat. Launay a ouvert les portes. La foule envahit la Bastille. Quatre délégations, on ne peut pas dire que Launay ait fait preuve de mauvaise volonté et que les émeutiers aient été traités par le mépris. Il est entraîné vers l’Hôtel de Ville, harcelé de coups, finalement massacré au sabre. Sa tête, coupée au couteau par l’aide-cuisinier Desnot, est promenée au bout d’une pique dans tout Paris, bientôt accompagnée de celle du prévôt des marchands, Flesselles, qu’on assassine dans la foulée. On boit le sang de ces deux victimes. Ce sera le premier des actes de cannibalisme, oui, en plein Paris, à la fin du XVIIIè siècle, qui vont émailler les journées révolutionnaires, et que la République se garde bien d’évoquer dans sa présentation des faits. Bilan, 98 victimes du côté des assaillants repoussés par la fusillade lors de l’assaut du premier pont, moins d’une dizaine du côté des défenseurs. Pas de prise par le combat mais une reddition. On est bien loin des images fortes diffusées par les manuels scolaires et universitaires, d’un peuple vigoureux et courageux faisant tomber par la seule force de son ardeur patriotique, l’une des plus puissantes forteresses médiévales qui ne serait jamais tombée sans la reddition de son Gouverneur.
La Bastille symbole du « despotisme » où se morfondaient les victimes de l’arbitraire royal ? Les études réalisées dès le XIXè siècle ont montré qu’elle n’est devenu un symbole qu’après les événements : cela ne pouvait donc constituer le mobile de l’émeute ni l’explication de cette insurrection « spontanée ». La Bastille en juillet 1789 n’abritait que sept détenus, quatre faussaires, deux fous et le comte de Solages, seul à pouvoir être considéré comme « victime de l’arbitraire ». Il n’y a pas eu de libération des prisonniers politiques puisqu’il n’y avait pas de prisonniers politiques à l’intérieur. Le traitement des prisonniers était décent, mais pour légitimer l’émeute, il fallait faire de la Bastille un engin de torture horrifique et injuste.
Les 5 et 6 octobre 1789.
Louis XVI accepte de quitter Versailles le 6 octobre 1789 pour la capitale, avec du ravitaillement, sous la contrainte d’une foule importante d’hommes et de femmes venue de Paris la veille investir le palais de façon alarmante et réclamer du pain. Cette foule ramène le lendemain, tels des quasi otages consentants, « le boulanger, la boulangère et le petit mitron », formule sensée exprimer le fait que la population de Paris, tenant désormais le roi, ne manquera plus de pain. Pour certaines sources, il s’agissait en fait d’assassiner la reine, et de forcer le roi par la terreur à quitter Versailles, après quoi on aurait fait nommer le duc d’Orléans roi par l’Assemblée. La Biographie universelle, d’Orléans, favorable, autant qu’on peut l’être au duc d’Orléans, mentionne que beaucoup de témoins affirmèrent l’avoir reconnu dirigeant les assaillants et leur indiquant les issues.
1790. Le « bon citoyen ».
En 1790, une nouvelle dénomination apparaît, celle de « bon citoyen », remplacée quelquefois par « vrai citoyen ». Le « bon citoyen », ce citoyen plus-plus, est une sorte d’évangéliste, le parfait et zélé propagandiste. Il instruit ses « frères », tâche de faire comprendre au peuple les « lois qui ont brisé ses fers » et de « leur faire aimer la Constitution ». Ces « bons citoyens » se réunissent aux Jacobins, et dans les 150 Sociétés des Amis de la Constitution, qui lui sont affiliées dans toutes les villes en juin et juillet 1790. Ils se qualifient eux-mêmes d’« apôtres du patriotisme et de l’humanité ». Chaque nouveau membre doit attester de son bon civisme. Reçu aux Jacobins le 2 novembre 1790, le jeune duc de Chartres, fils aîné du duc d’Orléans, se conforme à la règle : « Je puis vous assurer que toute ma vie je serai bon patriote et bon citoyen » (cité dans la Lettre du 2 juillet 1790 de la Société des Amis de la Constitution de Bordeaux à celle de Limoges). Le « bon citoyen » fait aussi vœu de soumission à la pensée dominante. « Les bons citoyens, déclare en janvier 1791 le Club des Jacobins, ne peuvent avoir qu’une façon de penser, et on les reconnaît surtout à leur respect pour les décrets de l’Assemblée nationale ». (extrait de la Lettre du 23 février 1791 de la Société des Jacobins de Paris à la Société des Amis de la Constitution de Limoges). Le politiquement correct, et la pensée unique obligatoire, donc totalitaire, sont déjà là. Dès lors, la tyrannie jacobine va se mettre en place, avec une intensité croissante étape par étape.
Corruption, concussion, escrocs et voleurs
Dès l’époque de la Constituante, ceux qui s’étaient donné pour mission mégalomane de « régénérer » la société et de lui imposer le règne de la « vertu » vont manifester une avidité proportionnée aux possibilités nouvelles que leur offrait la maîtrise du pouvoir. De Mirabeau aux thermidoriens, les choses ne feront que s’aggraver au cours de la décennie révolutionnaire, et si Robespierre fut désigné comme « l’Incorruptible », c’est bien parce qu’il constituait, avec quelques autres, une remarquable exception dans l’unanimité des voleurs, des corrompus et des escrocs. Trafics, pots-de-vin, abus de pouvoir, ces beaux sires républicains à l’aura maçonnique, « au service du peuple », drapés dans les plis du « progrès », des « Lumières » et de la « vertu » se sont gavés ! En mai 1793, le Girondin Buzot dénonce les démagogues qui usent de leur popularité pour assurer leur fortune. Il propose même que l’on exige des députés une déclaration (déjà!) présentant l’état de leur fortune et son évolution depuis leur élection. Une proposition demeurée sans lendemain. Qui s’en étonnera ? Proposition reprise un an plus tard par les Montagnards Vadier et Couthon qui réclament même la création d’un tribunal spécialisé… La publication au Journal officiel de l’arrêté relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts des élus et membres du gouvernement, ne date que du 27 juillet 2013. Deux-cent-vingt ans écoulés depuis les dénonciations de Buzot ! Occasionnellement, un élu malchanceux ou moins adroit trébuche, pointe visible façon « Cahuzac » du vertueux iceberg républicain.
Les historiens Albert Mathiez et, après lui, Olivier Blanc se sont penchés sur cette question de la corruption parlementaire à l’époque des assemblées révolutionnaires. Tentant de réhabiliter la majorité des conventionnels, et surtout Robespierre, Mathiez a surtout pointé Danton, véritable fripouille en effet, alors que plus récemment Olivier Blanc a pu montrer que c’est à peu près tout le personnel politique de la Révolution qui a bénéficié d’un enrichissement plus que suspect. Quelques exemples ? :
A l’époque de la Constituante, c’est la Cour qui a la faiblesse d’arroser grassement ses ennemis républicains, imaginant contrecarrer le mouvement révolutionnaire en achetant les députés les plus en vue. Selon Bertrand de Molleville, ancien ministre de la Marine, Louis XVI a ainsi versé en neuf mois deux millions et demi de livres. Et il est établi qu’en décembre 1791, les futurs Girondins Brissot, Isnard, Guadet ou Vergniaud sont à vendre pour six mille livres mensuelles. En janvier 1792, il est question d’acheter les seize membres les plus influents de l’Assemblée, pour trois mois, puis pour toute la législature. Le ministre de Lessart finira par convaincre le roi de ne pas s’engager plus avant dans cette compromission. A partir de 1790, Mirabeau, qui rappelons-le est la figure la plus influente du Club des Jacobins, ces fanatiques indissociables du Comité de salut public et de la Terreur, qui se met au service de la Cour et devient le conseiller secret de Louis XVI, contre un revenu assuré soit en rentes viagères constituées sur le Trésor public, ou un immeuble.
Soudoyés par la Cour, de nombreux acteurs politiques du moment le sont aussi par les puissances étrangères, principalement l’Angleterre qui va dépenser largement pour affaiblir sa rivale historique. Par l’intermédiaire des banques Thornton ou Perregaux[1], l’Angleterre répand l’or anglais tout en s’informant sur les députés français endettés, et donc achetables, le banquier français Benoît d’Angers servant d’intermédiaire auprès des conventionnels « vendus ». Danton, qui parlait anglais, passait par Théodore de Lameth pour entretenir des liens étroits avec l’Angleterre et était très lié avec William Augustus Miles, un agent d’influence du gouvernement anglais. Le général français Antoine-Joseph Santerre[2], qui va organiser l’attaque des Tuileries du 10 août 1792 aboutissant à l’emprisonnement de la famille royale, est lui aussi remarqué par les services anglais et Lord Grenville évoque en 1793 la possibilité de l’acheter. Santerre a multiplié sa fortune par dix entre 1789 et 1794 et il blanchit l’argent sale dans la maison de jeux de son beau-frère Jacques Descarrières.
[2] C’est lui qui fera jouer les tambours pour rendre les dernières paroles de Louis XVI sur l’échafaud, inaudibles à la foule.
[1] Jean-Frédéric Perregaux, banquier suisse établi à Paris. Il sera accusé d’accaparement sous la seconde période robespierriste, avant de devenir avec la complicité de Bonaparte l’un des fondateurs de la banque privée dite Banque de France, mais aussi sénateur et comte d’Empire.
Après la chute de la monarchie française, William Augustus Miles avancera des sommes importantes au ministre des Affaires étrangères Lebrun-Tondu. Pour sa part, Jérôme Pétion, maire de Paris en juin 1791, premier président de la Convention et du Club des Jacobins en septembre 1792, bénéficie également des largesses anglaises. Dès juillet 1793, les liens entretenus par Dumouriez et le banquier Perregaux avec les services britanniques sont mis en lumière.
Si l’Angleterre dépense sans compter pour déstabiliser sa grande rivale, l’Espagne des Bourbons va tenter de sauver Louis XVI en payant les Conventionnels appelés à décider de son sort. C’est la banque Le Couteulx qui va servir d’intermédiaire en fournissant à l’ambassade d’Espagne les sommes nécessaires. Le chevalier d’Ocariz réclama ainsi deux millions de livres à la veille du procès du roi et il remettra 500.000 livres au député Chabot, « l’un des membres les plus audacieux de la Convention, qui avait la réputation d’être accessible à toutes les propositions qui pouvaient lui être faites l’argent à la main ». On mange à tous les rateliers en exploitant tout à la fois la Révolution et le parti du roi. Danton, toujours, tenta par ailleurs de soutirer deux millions supplémentaires au gouvernement anglais pour proposer un décret qui déciderait de la déportation de Louis XVI.
La guerre et les besoins des armées vont aussi créer un terrain favorable aux escrocs et aux spéculateurs. Auréolé du prestige qui lui vaut sa victoire de Valmy, Dumouriez exige de contrôler tous les marchés concernant l’équipement et l’approvisionnement de ses troupes. Il est étroitement lié à un certain abbé d’Espagnac, ecclésiastique devenu par pur opportunisme Jacobin et garde national. Ami de Danton, de Desmoulins et de Hérault de Séchelles, il devient fournisseur aux armées après le 10 août, avant que Danton s’impose comme l’homme fort de la Commission exécutive. Il pratique des prix deux à trois fois supérieurs à ceux du marché, paye en assignats dépréciés ses fournisseurs après avoir lui-même été rémunéré en monnaie métallique. Il verse au ministre de la Guerre, Joseph Servan, des pots-de-vin considérables (au moins 600.000 livres) pour qu’il couvre ses trafics.
Les représentants envoyés par la Convention dans les départements et aux armées, profitent largement des pleins pouvoirs qui leur sont attribués pour dépouiller aristocrates et « suspects ». Danton, toujours lui, ne revient pas les poches vides de son voyage en Belgique de décembre 1792 janvier 1793 et Westermann, le futur massacreur de Vendéens, sera également compromis dans les « levées d’impôt » réalisées outre-Quiévrain. Barras et Fréron à Toulon, Fouché et Collot d’Herbois à Lyon tireront également de substantiels profits des pleins pouvoirs qui leur sont accordés. Les hommes de pouvoir pouvaient également négocier leur « protection » au prix fort. Participer au régime de terreur puis vendre sa protection contre les menaces qu’il fait peser, méthode de mafieux pur jus. Le secrétaire de Camille Desmoulins, Roch Marcandier, dénoncera dans son Histoire des hommes de proie ou les crimes du Comité de Surveillance, le rôle joué par Danton et Fabre d’Eglantine dans certaines libérations survenues, contre argent comptant, à la veille des journées qui allaient ensanglanter les prisons parisiennes.
Le trafic de certificats de résidence et de civisme constituait également une source de revenus non négligeable. Installés au Comité de sûreté générale, Basire et Rovère touchaient ainsi des pots-de-vin substantiels. Pierre Chaumette, le procureur de la Commune et son secrétaire, Sébastien Bruno de Lacroix, ont ainsi mis en place, moyennant finance, tout un réseau de falsification de passeports. L’intransigeant révolutionnaire qu’était Anacharsis Cloots, surnommé « l’orateur du genre humain », le « philanthrope cosmopolite », n’hésitait pas lui-même à protéger, contre argent, les ci-devant en difficulté. Durant la Terreur, ceux qui passent pour les révolutionnaires les plus extrémistes n’hésitent pas à négocier leur protection à un prix d’autant plus élevé que leur influence est grande.
Après le vote de la loi des « suspects », le système des « défenseurs officieux » – ceux que leurs victimes baptisaient « les vautours » – se généralise sous la houlette de Fouquier-Tinville[3], qui avait besoin de beaucoup d’argent pour éponger ses dettes de jeu. Par l’intermédiaire de La Fleutrie, un avocat marron, l’exemplaire accusateur public décidait de la vie ou de la mort de ses victimes, en fonction de leur compréhension et de l’état de leurs ressources. Les personnes en situation de payer étaient décrétées malades et placées dans des « maisons de santé » en attente de leur procès. Il était évidemment préférable de faire tout de même disparaître les victimes de ces procédés car elles pouvaient devenir, si les choses venaient à changer, des témoins gênants. Les « conspirations dans les prisons » qui sont dénoncées au printemps 1794 permettent, une fois votée la loi terroriste de prairial, d’envoyer tous les intéressés à la guillotine. Cela dit, au final, ce ne seront pas les nobles qui auront le plus souffert de la guillotine sous la Révolution, mais comme toujours, les petites gens. Le recensement statistique montre qu’un guillotiné sur vingt fut noble. Un sur dix fut religieux. Les autres…
[3] L’impitoyable et arbitraire accusateur public du tribunal révolutionnaire, stakhanoviste de la guillotine.
Le cas de corruption le plus exemplaire demeure celui de Danton. Soudoyé par la Cour dès le début de la Révolution, il amasse une fortune considérable, résultat de ses multiples escroqueries. Payé par l’Angleterre, acheté par l’Espagne pour intervenir à la fin du procès du roi, enrichi à la faveur de sa mission en Belgique, lié à tous les aigrefins qui spéculaient sur les fournitures aux armées, payé pour faire bénéficier de sa protection les suspects de l’été 1792, il « touche » de partout pour mettre sa position de pouvoir, son talent oratoire et son incontestable popularité [4] au service des uns et des autres. Quand, le 11 vendémiaire an IV, les assemblées décidèrent de réhabiliter les victimes des terroristes, elles rendirent hommage à la mémoire des Girondins et de Camille Desmoulins, mais « oublièrent » la brochette d’aigrefins constituée de Danton, Basire, Delaunay, Chabot et Fabre d’Eglantine, guillotinés en avril 1794. Danton sera statufié place de l’Odéon en 1891 [5]. L’évolution de sa fortune est pourtant révélatrice. Il ne possédait en 1789 que sa charge d’avocat, achetée à crédit deux ans plus tôt pour 68.000 livres. L’abolition de la vénalité des offices fait qu’elle est liquidée en 1791. L’État reconnaît devoir 68.000 livres, ce qui signifie qu’il avait remboursé sa dette… A partir de la fin de 1790, il est, grâce à Mirabeau, administrateur du département de Paris mais cette fonction n’est pas rétribuée. En décembre 1791, il est substitut du procureur de la Commune de Paris mais cela ne lui rapporte que six mille livres par an. Il n’est ministre que du 10 août au 5 septembre 1792 et sera député de la Convention pendant dix-neuf mois. Les ressources liées à ces diverses activités ne peuvent expliquer la fortune qu’il a accumulée. Si l’on néglige les prête-noms qu’il a utilisés pour de nombreux achats, il possède une centaine d’hectares dans l’Aube, quatre maisons et fait verser une rente à sa mère et à sa nourrice. Il achète comptant des biens qui auraient pu être payés en douze annuités. Lors de son passage à la Commission exécutive après le 10 août 1792, il est évident qu’il a largement puisé, avec son secrétaire Fabre d’Eglantine, dans les fonds secrets mis à sa disposition.
[4] Depuis que l’homme a inventé l’organisation politique de la société, il aura été enfantin à ceux qui en ont la capacité, de tromper l’opinion.
[5] On appréciera l’honnêteté du « roman républicain » dont les manuels scolaires sont remplis, et de quoi est fait son panthéon des « grands hommes ».
On pourrait prolonger, après Thermidor, la liste des escroqueries, des scandales et autres « turpitudes pécuniaires » qui marquèrent l’époque. Faute d’avoir su, pour beaucoup d’entre eux, pratiquer les vertus dont ils se prétendaient représentants, les hommes de la Révolution, y compris certaines icônes « républicaines » apparaissent souvent comme des hommes aventuriers cyniques et avides, dont bien peu eurent véritablement le souci de l’État et du service de la nation.
1791.
Environné de Jacobins hostiles depuis qu’il a été ramené à Paris le 6 octobre 1789 et pour ainsi dire assigné à résidence aux Tuileries, le roi essaiera vainement de s’en échapper le 21 juin 1791, vers Montmédy d’où il devait lancer un appel à le rejoindre pour tous les Français qui voulaient se montrer fidèles à son projet constitutionnel modernisateur. Arrêtée à Varennes, la famille royale est ramenée aux Tuileries. De façon inattendue, mais montrant bien que la radicalité jacobine était ultra-minoritaire dans le pays alors que les partisans des réformes proposées par le roi étaient nombreux, le couple royal retrouve momentanément une popularité extraordinaire. Le 14 septembre 1791, le roi, toujours consensuel, accepte la Constitution du 3 septembre et lui prête serment. En octobre, la nouvelle Assemblée nationale élue avec plus de 75 % d’abstention, glisse nettement à gauche par une motion de Robespierre faisant interdire aux anciens députés de la précédente Constituante de se représenter. De nouvelles élections portent, avec 88 % d’abstention, le Jacobin Pétion à l’Hôtel de Ville. De partout on cherche à enrayer les rouages de l’État, annulant l’énergie déployée par le roi à rénover les institutions et leur fonctionnement.
1792 – 1794. La seconde Révolution
Début février 1792, le couple royal échafaude un nouveau projet de départ de Paris. Mais les aristocrates parisiens ultras (ceux préférant que rien ne change dans le fonctionnement hérité de Richelieu et Louis XIV), conscients que la réussite d’une évasion profiterait au projet constitutionnel libéral (à l’anglaise) vers lequel s’oriente le roi (ce qui bien sûr ne fait pas les affaires de son cousin d’Orléans), ces royalistes ultras vont montrer beaucoup de vigilance à déjouer toute tentative d’évasion, et conseilleront même aux Jacobins une étroite surveillance du palais comme de la famille royale. L’aristocratie centralisatrice joue de félonie contre le roi en préférant qu’il reste prisonnier des Jacobins plutôt que de voir peut-être un jour une modification libérale aboutir en France par le truchement de Louis XVI. La bonne volonté du roi est coincée de toutes parts.
La France entre en guerre.
La France est-elle attaquée par un pays frontalier en 1792 ? Non. Mais c’est à une puissance éloignée que le nouveau pouvoir révolutionnaire déclare la guerre le 20 avril. Au roi de Hongrie et de Bohème, autrement dit à l’Empereur de la dynastie Habsbourg, père de Marie-Antoinette. C’est que la monarchie en Europe est une histoire de famille, et le révolutionnaire français est paranoïaque. Mener ses affaires intérieures et protéger sa nouvelle construction d’une éventuelle attaque ne lui suffit pas. Il prend les devants. Anticipant le renversement (désormais tout proche) du trône français, il se place dans une fuite en avant, avec la nécessité de répandre sa doctrine et renverser les autre trônes européens, au risque sinon pense-t-il de voir un jour le retour de l’Ancien régime. Vaincre ou disparaître, le citoyen n’a pas d’autre alternative. Tout le monde doit être républicain, pour rendre impossible l’existence d’un autre système. Le 20 avril, le roi se rend à l’Assemblée pour valider à contre cœur cette décision de guerre qui lui est imposée. Lorsque dans son discours il lui faut prononcer l’expression « déclarer la guerre », ses yeux embués se remplissent de larmes. Dans une inconscience générale, à l’exception de son roi, la France vient de s’engager pour vingt-trois années de campagnes sanglantes qui vont décimer l’Europe toute entière. Les Jacobins se sont qualifiés eux-mêmes d’« apôtres du patriotisme et de l’humanité ». Mais n’est-il pas contraire à l’humanité de faire la guerre aux autres peuples ? Car ces peuples, sauf exception (que l’on comprend française), ne sont selon les propos de Claude Fauchet à l’Assemblée nationale le 28 janvier 1792 que des « peuplades sous la verge des despotes ». Et l’on voit d’emblée la très haute idée que ces messieurs se font d’eux-mêmes, quelle arrogance mégalomane les alimente. Certes, ces peuples sont nos frères et ils seront peut-être un jour nos amis. Mais en attendant ce sont des ploucs, des sous-hommes dégénérés puisqu’ils n’ont pas encore eu la grâce insigne d’être touchés par les «Lumières», et il faut donc les combattre comme des brigands. Et si, impressionnés par notre vigueur, ils se montrent « paisibles, nous commercerons avec eux comme avec de bons sauvages » dit encore Claude Fauchet lors de cette même séance du 28 janvier 1792. Et l’on s’étonnera que les Français aient toujours une si mauvaise image chez leurs voisins, celle du coq arrogant. Dans l’Hymne des Marseillais, nous le savons, ces ennemis sont qualifiés de « horde d’esclaves », de « féroces soldats », et leur sang est « impur ». C’est la France révolutionnaire qui déclare la guerre aux peuples d’Europe, mais ce sont eux qui veulent « égorger nos fils et nos compagnes » et nous rendre « à l’antique esclavage ». Suivront évidemment les levées en masse non seulement de la jeunesse mais de tout citoyen en état de porter les armes, et l’hécatombe qui se poursuivra jusqu’à la chute de Napoléon, fidèle continuateur de l’entreprise jacobine. Parce qu’à cette occasion la guerre change de dimension. Elle n’est plus l’affaire d’effectifs limités, souvent professionnels, pour régler un contentieux territorial entre puissants. Tous les citoyens seront soldats au service de l’exportation de la révolution (les pertes humaines masculines causées par ces conflits seront le premier suicide d’un pays qui avait été le plus puissant et le plus rayonnant ; celles de la Première Guerre mondiale seront son second suicide ; l’assujettissement à la domination atlantiste depuis 1945 est son troisième suicide, toujours en cours en 2016).
L’épisode du bonnet phrygien.
Le 20 juin 1792, dans le cadre d’une manifestation organisée par les députés Girondins, des Parisiens envahissent les Tuileries, le roi ne s’y oppose pas, et accepte d’être coiffé du bonnet phrygien. Même s’il a subi une humiliation, Louis XVI a fait échouer la manifestation par son obstination imprévue et sa fermeté tranquille face à des émeutiers impressionnés à sa vue et qui baissent leurs armes. Sans cette attitude, la manifestation aurait pu tourner au coup d’État précipitant su chute. Viendra ensuite la prise des Tuileries le 10 août 1792, à la suite de laquelle il se verra, sous pression de la Commune, enfermé à la prison du Temple.
Le massacre du 10 août 1792.
Depuis 1616, le régiment des Gardes suisses, aux uniformes rouges, sert les rois de France. Il est aux Tuileries avec la famille royale. Par faiblesse, le roi s’est peu à peu laissé désarmer. Ils sont la dernière unité qu’il lui reste, fidèles au-delà de tout. Mais il a permis que le régiment des Gardes suisses livre ses réserves de munitions et ses huit canons à la Garde nationale, plus disposée à prêter main-forte aux émeutiers qu’à les contenir. Le capitaine Pfyffer d’Altishofen écrira : « Ce malheureux prince cherchait à éviter l’ombre même de ce qui eût pu donner du soupçon ». Le 7 août, Louis XVI consent à ce qu’un détachement de 300 hommes et sept officiers se rende en Normandie pour escorter un convoi de grains. En face, le comité insurrectionnel a fait distribuer 80.000 cartouches. Les Suisses ont chacun entre 20 et 35 cartouches. Le 9 août, les faubourgs entrent en effervescence, le drapeau rouge flotte à l’Hôtel de Ville. La Commune avertit l’Assemblée que si, à minuit, elle n’a pas voté la déchéance du roi, elle proclamera la guerre civile. Avertis par la rumeur, 200 gentilshommes viennent mettre leur épée au service du roi. Le capitaine Pfyffer d’Altishofen écrira : « On doit désapprouver leur démarche et avouer qu’armés comme ils l’étaient, ils ne pouvaient qu’embarrasser la défense, en même temps qu’ils inspiraient de la défiance à la Garde nationale », mais la démarche est louable, et à l’honneur de la noblesse française. En tout, à peu près 1.000 hommes prêts à tout tenter pour sauver le roi, répartis entre le jardin et le château. 2.000 Gardes nationaux appelés en renfort arrivent, ils passeront du côté des insurgés. Le 10 à l’aube, Roederer, procureur général syndic de la Commune persuade le roi que toute résistance est inutile. Marie-Antoinette supplie le roi de faire confiance aux Suisses et de résister, ne serait-ce que pour sauver l’honneur, langage auquel Louis XVI reste sourd, obnubilé par le souci de ne pas faire couler le sang, surtout celui de ses ennemis. En apprenant le départ du roi, des gentilshommes brisent leurs épées. Escortée par 100 hommes, la famille royale parvient à se réfugier à l’Assemblée. Les émeutiers passent à l’attaque du palais, ils sont évalués par certains contemporains à 100.000 personnes. Un premier assaut est repoussé par les Suisses, mais leurs munitions manquent déjà. A l’Assemblée, Louis XVI a perçu l’écho de la fusillade. Toujours soucieux de montrer son humanitarisme, il fait porter aux Suisses l’ordre de déposer leurs armes et de se retirer dans leurs casernes. En apprenant cette décision qui les livre, les désarmant, les soldats s’indignent et certains pleurent de rage. Le jardin est semé d’uniformes rouges. Les défenseurs ne sont plus que 450 au château, à qui l’ordre de reddition n’est pas parvenu. Attaqués au canon, les appartements sont en feu. Après une défense héroïque du grand escalier par 80 Suisses, c’est la curée, les fédérés se livrent à une véritable boucherie. Les Suisses attrapés sont éventrés, empalés. Des femmes les déculottent, leur tranchent le sexe ou se font des cocardes avec leurs intestins, d’autres dépècent Georges-François de Montmollin et lui dévorent le cœur. Des petits tambours sont lancés par les fenêtres sur les piques et les fourches, d’autres jetés dans les chaudières des cuisines, qui ont continué de fonctionner, et bouillis vifs. Les scènes de sadisme et de cannibalisme se multiplient, à l’effroi d’un témoin, l’Anglais Fennel, qui voit des enfants se disputer des têtes, des bras, des jambes, tandis que leurs parents jouent aux marionnettes avec des cadavres, les maintenant debout, puis leur assénant des gifles. Bonaparte, présent, voit « Des femmes bien mises se porter aux dernières indécences sur les cadavres des Suisses. » Il y a une origine sexuelle à ce sadisme : les Suisses, en général très beaux hommes et d’une taille supérieure à celle de la moyenne des Français, passaient pour de vigoureux amants, très recherchés des femmes, et les dédaignées, ce jour-là, prennent leur revanche. Dans la chambre de la reine, on égorge trois Suisses, on coupe les jambes d’un quatrième avant de le jeter par la fenêtre. Dans Paris, on danse aux carrefours en agitant des lambeaux de chair humaine au bout des piques. Divers Suisses qui avaient pu échapper au massacre, sont retrouvés et tués dans les jours suivants. Au total 26 officiers, 850 sous-officiers et soldats. C’est après cette date qu’est mis en place le Comité de sûreté générale, chargé de diriger la police et la justice révolutionnaire.
Lorsqu’en 1992 les familles des Suisses massacrés deux cents ans plus tôt demandèrent au gouvernement français une messe à Notre-Dame, cette satisfaction leur fut refusée. Rancune ahurissante du régime au travers de ses tenants contemporains, jusqu’au bout.
Septembre 1792. La Terreur. Le citoyen massacreur.
C’est un ancien prêtre, Royer, qui le 30 août 1793, aux Jacobins, exige que l’on place la Terreur à l’ordre du jour. On peut considérer son lancement à ces dates du 2 au 7 septembre inclus, où des centaines de détenus des prisons républicaines de Paris (notamment divers couvents et abbayes reconvertis à cet usage) sont massacrés à l’arme blanche (on réserve les fusils et les balles pour affronter les éventuels opposants extérieurs à la Révolution). Les tueurs, sauf exceptions rares, ne sont pas des professionnels du crime, mais des citoyens normaux, sans passé judiciaire pour autant qu’on puisse le savoir. Les autorités parisiennes organisent la tuerie ou bien elles laissent faire. La population assiste à ces crimes sans broncher, quand elle n’y applaudit pas. On sait que par la crainte qu’elle inspire, une minorité agissante et violente s’impose toujours à une majorité molle qui se contente dès lors de subir en silence ou de suivre pour montrer une adhésion préservatrice. La crainte de l’invasion étrangère contre-révolutionnaire est à l’origine des massacres. Il va falloir se porter aux frontières. Le 2 septembre, le conseil général de la Commune invite tous les citoyens de la capitale « à se réunir au Champ de Mars pour marcher à l’ennemi ». Les massacres des prisons commencent ce même jour. Car on considère dangereux pour la pérennité du nouveau régime de se porter hors de Paris en laissant derrière soi d’une part un nombre insuffisant de « gardiens de la révolution », et d’autre part de potentiels acteurs de la contre-révolution s’il advenait qu’ils s’évadent. Leur élimination préalable est donc par prudence nécessaire dans la logique jacobine. Les rafles de ces « mauvais citoyens », des « suspects », sur la base de listes de proscrits préalablement établies, ont commencé dans tout Paris le 29 août à 13h00. L’appel au meurtre vient de Marat, dès le 10 août, par voie d’affiche. Les anciens 60 districts de Paris ont été transformés en 48 sections, aux mains de militants révolutionnaires. Et depuis le 10 août, le conseil général de la Commune est formé des délégués de ces sections. Chauffé par la propagande des sections, le peuple de Paris, une partie de celui-ci du moins, a voulu le massacre ou approuvé. La décision de passer à l’acte est prise dans la matinée du 2 septembre par les sections Poissonnière et Luxembourg. Au moins deux autres sections, celle du Louvre et de Fontaine-Montmorency suivront. Ces ultras, quelques centaines, suffiront pour l’égorgement. Ce sont des ouvriers, des artisans, des commerçants, des petits bourgeois, des pères de famille, nullement des voyous ni des repris de justice. Les archives de la Préfecture de police renferment une liste de 53 marchands, tous établis rue Sainte-Marguerite. On voit ici combien l’émulation réciproque « de proximité », l’effet d’entraînement de voisinage, ont joué sur les esprits. Ces exécuteurs volontaires sont rémunérés par la Commune ou par les trésoriers des sections, de 5 à 24 livres, pour un budget total de 12.000 francs voté par le conseil général de Paris. Ils vont œuvrer à l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à celle des Carmes, aux prisons de la Conciergerie, du Grand Châtelet et de la Force, à la Tour Saint-Bernard aux Bernardins, Saint Firmin, Bicêtre, la Salpêtrière. Le nombre exact des victimes n’est pas connu avec précision, de 900 à plus de 1.300 selon les historiens qui ont étudié la période. Les victimes sont des prêtres réfractaires, qui n’ont pas juré allégeance à la Constitution civile du clergé, des soldats Suisses qui ont défendu les Tuileries le 10 août 1792, des journalistes royalistes, des magistrats, des personnes de l’entourage du couple royal, et des délinquants de droit commun. Surtout des hommes, y compris des enfants. 43 garçons de 12 à 17 ans sont égorgés à Bicêtre. Peu de femmes. Pourquoi massacre-t-on aussi les droit commun ? Ce n’est pas élucidé. Mais certains pensent que l’idée de « régénérer l’espèce humaine » selon le vœu de certains penseurs des « Lumières », en supprimant dans le lot les criminels, n’est pas à exclure. Des dispositions avaient été prises en amont pour le transport et l’inhumation des cadavres, dans une fosse commune à Montrouge, et à la carrière de Charenton. Mais dès le 2 septembre au soir, ces préparatifs s’avèrent insuffisants. Le 3, à l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés et à la Force, des centaines de corps encombrent les cours et les rues voisines. On marche dans le sang. Il ne semble pas aller de soi de transformer de paisibles marchands et artisans en exécuteurs volontaires à grande échelle. Il ne va pas de soi d’amener quelqu’un de paisible à passer à l’acte de l’égorgement. Et l’on se dit, mais par quelle fièvre ont-ils été emportés, quelle a donc pu être la force de la propagande révolutionnaire sur les parisiens (la province n’a pas été concernée dans les mêmes proportions par la commission des massacres), pour retourner les cerveaux au point d’en transformer certains en tueurs et en bouchers à la chaîne.
Septembre 1792. Élections à la Convention.
Méthodes vertueuses. Cette minorité active va alors tout mettre en œuvre pour arriver au pouvoir. Elle commence par Paris, désormais sous la coupe de patrouilles jacobines. Tout est fait pour fausser le jeu des élections : adoption du suffrage universel, excepté pour les domestiques suspects de suivre les opinions des maîtres de maison ; opposants exclus du scrutin ; presses des journaux royalistes confisquées et transférées aux républicains ; appel nominal et vote à haute voix, dans la grande salle des Jacobins, sous le regard menaçant des plus extrémistes (il en va souvent de même en province). Les Jacobins et leurs partisans furent à peu près seuls à se rendre aux urnes. C’est ainsi que 5 ou 6.000 Jacobins imposeront leurs volontés à 700.000 parisiens. Au plan national, 630.000 électeurs seulement, sur 7.580.000 inscrits, en raison de ces circonstances, et une future Assemblée de 749 républicains chimiquement purs, élus selon des procédures illégales. Mieux, la République sera proclamée à la hâte, forçant la marche, par un petit nombre de députés parisiens, sans attendre l’arrivée à Paris de 500 environ députés provinciaux. C’est à l’occasion de cette élection que Louis-Philippe d’Orléans prend nom Philippe-Égalité.
La mort de Louis XVI.
Méthodes vertueuses, acte deux. On passera sur les irrégularités flagrantes du procès, que des générations de juristes relèveront. Le vote de la mort du roi par la Convention a lieu les 16, 17 et 18 janvier 1793, sous la pression d’un public à la solde des Jacobins, qui abreuve d’injures et de menaces les nombreux députés hésitants, hostiles au régicide (tous ne souhaitaient pas en arriver à une telle extrémité), qui feront brusquement volte-face à la tribune. Fouché, futur ministre de la police de Napoléon avouera plus tard avoir eu peur de représailles sur sa femme ou ses enfants. Bollet, le député du Pas-de-Calais, est amené à la tribune à coups de canne ; il vote la mort du roi, épouvanté. Il a compris la nature de ce qui s’installe sur le pays. Debry, futur préfet du Doubs, avouera par la suite : « J’étais parti de chez moi avec l’intention formelle de voter le bannissement du roi et non pas sa mort ; je l’avais promis à ma femme. Arrivé à l’Assemblée, on me rappela d’un signe le serment des loges. Les menaces des tribunes achevèrent de me troubler : je votai la mort ». Au terme des deux premiers jours, 712 votants, 366 voix pour la mort sans condition. Les Jacobins s’indignent d’une majorité aussi faible, et exigent un nouveau pointage. Le 18, le scrutin final donne 360 voix contre la mort du roi et 361 pour. Une voix de majorité. Et Philippe-Égalité a voté la mort de son cousin. Dans l’absolu, c’est son vote qui envoie le roi à l’échafaud. Un vote sur un éventuel sursis a tout de même lieu. Mais Robespierre menace : « J’éprouverais une trop vive douleur, si une partie de la Convention était obligée de faire violence à l’autre ». Menace de mafieux. Le sursis est refusé par 380 voix contre 310. Pour les avocats du roi : de Sèze sera emprisonné, Tronchet traqué par le Comité de sûreté générale, et Malesherbes guillotiné. Que deviendront les régicides ? Sur les 380, 31 seront guillotinés, deux deviendront fous, dix-huit mourront de mort violente, six se suicideront. Et 40 % des survivants rejoindront la haute fonction publique sous Napoléon. Je ne m’étends pas sur les trois jours qui ont suivi ce vote et sur le déroulement de l’exécution le 21 janvier 1793, sur la destruction fanatique de la nécropole et des tombeaux des rois à Saint-Denis, effaçant douze siècles d’histoire en trois jours de masses et de pioches, bien qu’il y ait à dire. On peut en revanche évoquer le sens sacrificiel de cette exécution dans l’instauration de la nouvelle religion maçonnique qui s’est emparée du pays, servie par une petite oligarchie dominant dans l’ombre tout le reste du corps social.
Il y a loin de la coupe aux lèvres.
La Révolution a été présentée en 1789 par ses initiateurs comme une entreprise de « libération », de mise à bas des « tyrans » et de la « concentration des pouvoirs » ? Maintenant que la bourgeoisie d’affaires et le parti Orléaniste ont perdu la main, lisons simplement Saint-Just, nommé en mai 1793 au Comité de salut public (qui vient d’être créé) alors que Louis XVI n’est plus : « Il faut une puissance dictatoriale autre que celle des deux comités. Il faut un homme qui ait assez de génie, de force, de patriotisme et de générosité pour accepter cet emploi de la puissance publique ». Celui qu’il estime être le plus grand homme de l’Antiquité (dont la Révolution est pétrie de références), et qu’il faut prendre pour modèle, c’est Auguste, archétype précisément de la concentration dictatoriale des pouvoirs. En regard de cette conception de la société nouvelle, la France d’Ancien Régime, au roi cerné de contre-pouvoirs, fait figure de terre de Liberté à la mécanique institutionnelle modérée.
Marie-Antoinette.
Dans le cimetière de la Madeleine, le fossoyeur chargé par la Convention de la besogne découvre près de l’endroit où le roi a été enterré neuf mois plus tôt, abandonné, à demi dénudé et gisant dans l’herbe, la tête placée entre les jambes, le corps d’une femme. De mémoire d’homme, seul le tyran Créon avait osé infliger pareille déchéance posthume à Polynice, le frère d’Antigone. Après l’acharnement des mois passés et l’exécution, pareille vexation était-elle encore nécessaire pour abattre la reine ? Quel esprit mauvais, dans cette République ! « Pire que le régicide » jugera plus tard Napoléon. Parmi les chefs d’accusation lors de son procès, est celui d’avoir « dilapidé » les finances de la France. Marie-Antoinette dépense sans compter, du moins sur le budget qui lui est attribué. Elle ne possède aucune notion de la valeur de l’argent ni même des principes élémentaires indispensables à l’équilibre de ses comptes. Le roi est parfois obligé d’y aller de son propre budget pour couvrir certains frais. Mais ces dépenses de la reine ne sont pas perdues pour tout le monde. Elles font travailler de nombreux corps de métier, qu’il s’agisse de son personnel de maison, des jardiniers à l’entretien du Trianon ou de Saint-Cloud, des ateliers dans la mode, l’ameublement, la décoration. Une foule de salariés vit de ses achats. En 1681, le budget attribué à la reine de France avoisinait les 1.450.000 livres. Il passera à 4.700.000 livres en 1788. Pris isolément, ces chiffres montrent en effet une augmentation de ce budget en un siècle. Mais l’historien anglais J.F.Bosher établit que le budget global de la cour ne dépassait pas 6 % des dépenses totales de l’État. Celles de la reine représentaient donc en effet peu de chose en face des 530 millions sottement payés entre 1776 et 1781 pour financer la guerre d’Amérique au profit des maçons construisant là-bas leur État indépendant de l’Angleterre. Si les finances de la France ont été dilapidées, c’est là qu’elles le furent, préparant ainsi en plus la future perte de la Louisiane, que Bonaparte vendra en 1803 vu l’état du budget. Dépenses considérables que cette guerre d’Amérique, qui pour le coup ne semblaient pas gêner les francs-maçons français ! Marie-Antoinette a cependant été par trop généreuse par don d’argent à l’égard de quelques personnes de son entourage. Alors que dans les campagnes, beaucoup de nobles sont au bord du gouffre financier ou vivent même dans la gêne, les accaparements de quelques-uns apparaissent insupportables. Il y a bien une petite société scandaleusement nantie, mais elle n’est pas représentative de la totalité de l’ordre nobiliaire français, c’est établi. Elle n’avait pas été formée à l’action politique, et prendra des décisions regrettables sans concertation avec le roi dont elle comprend peu les choix : l’adoption de la Constitution et le jeu vers une évolution libérale des institutions françaises. Elle devait trouver le soutien qui lui faisait défaut sur ce terrain. Sa famille, les liens du sang lui apparaissent dès lors comme les derniers remparts efficaces. Le roi était hostile à la guerre. Il lui apparaissait que les combats frapperaient inconsidérément tous ses sujets, les fidèles constituant une majorité, comme les factieux. Il tentera une action diplomatique avec l’Empereur d’Autriche. Mais la reine est terrorisée et toujours sous le choc après l’invasion des Tuileries le 20 juin 1792. Sans comprendre que l’attitude et les initiatives pacifistes du roi ont provoqué en profondeur un vaste mouvement en sa faveur dans l’opinion, pensant agir pour sauver sa famille, elle pousse ses soutiens étrangers à l’envoi de ce manifeste de Brunswick qui met en garde les autorités républicaines. Cette initiative ruine les efforts diplomatiques du roi, qui tente de nier toute collusion avec les puissances extérieures. En vain. La suite, c’est l’attaque des Tuileries le 10 août. Cette erreur de la reine lui sera non seulement fatale, mais elle entraînera tous les siens vers la mort.
Ce chapitre sur Marie-Antoinette donne l’occasion de tordre le cou à un de ces bobards propagés sur Versailles, dont j’ai personnellement le souvenir collégien de cours d’histoire, dépeignant de façon invraisemblable un lieu conçu sans latrines et ses occupants comme une ménagerie faisant ses besoins derrières les rideaux ! Marie-Antoinette possédait le sens de l’hygiène et de la propreté. Elle fit installer, chez elle, des WC à l’anglaise, un nouvel appartement des bains au rez-de-chaussée du corps central du palais de Versailles. Les « commodités » déjà si nombreuses furent multipliées, dans le château et bien sûr ailleurs, dans les autres résidences. L’hygiène était une de ses préoccupations, dont on retrouve le témoignage partout où elle a exercé son contrôle.
Le calvaire du dauphin.
Au moment d’aborder le sort du petit dauphin, plus qu’à l’évocation de la mort de sa mère, il faut rappeler la réponse faite par la Convention au roi qui, à la veille de son exécution, priait la nation de prendre soin de sa famille : « La nation française, aussi grande dans sa bienfaisance que rigoureuse dans sa justice, prendra soin de sa famille et lui assurera un sort convenable ». Pourtant, « Ne pas le tuer. Ne pas l’empoisonner. Mais s’en débarrasser », c’est la consigne que reçoit Simon, l’homme à qui la garde de l’enfant est confiée dans la prison du Temple, un étage au-dessous de celui où est enfermée la reine. L’enfant de huit ans a été arraché à sa mère le 3 juillet 1793, par décret de l’Assemblée ordonnant que l’enfant soit interné seul. Car pour en finir avec la monarchie, l’exécution de Louis XVI ne suffit pas. Son fils reconnu comme Louis XVII par les gouvernements étrangers perpétue la royauté. Ne pas le tuer, ne pas l’empoisonner, mais s’en débarrasser. En venir à bout à l’usure donc. Débute une période de six mois de maltraitance et d’humiliations infligées par le couple Simon qui vit avec lui. Il s’agit de le briser non seulement physiquement mais mentalement. Ensuite, ses deux parents ayant été exécutés (il l’ignore pour sa mère), débute le 21 janvier 1794 la période dite de « l’emmurement ». Pendant six mois, le petit prisonnier est mis à l’isolement complet, sans lumière du jour à cause d’un haut-vent, sans éclairage la nuit, sans chauffage, un simple guichet servant à lui transmettre irrégulièrement quelque nourriture, et par lequel on lui crie à intervalles réguliers de se lever et de venir montrer son visage. Les seules personnes qu’il voit sont les chiens de garde du Comité de sûreté générale entrant constater qu’il est toujours là à chaque relève. C’est à chaque fois l’occasion de l’insulter copieusement. On le détruit, mais on veut aussi symboliquement détruire en lui la France dont il est l’incarnation. Psychologiquement brisé, il cesse de balayer sa chambre, de se dévêtir et de se laver, d’user de son lit. Il gît sur une paillasse à même le sol d’où il ne se lève plus que pour montrer son visage au guichet ou prendre son assiette. Toute une suite de commissaires le voit dans cet état, mais nul ne s’en inquiète. Pour éviter la mauvaise odeur, on referme le volet du guichet de plus en plus rapidement, et plus aucun commissaire ne rentre dans la pièce. Pour qu’elle se rouvrît et laisse entrer les pas d’un être humain, il faudra attendre la chute de Robespierre (été 1794) et le passage du pouvoir des Jacobins au Directoire. Ceux qui rouvrent la porte se heurtent à une atmosphère empestée, puis, à leurs pieds, un sol jonché d’ordures, de restes de nourriture, d’excréments, au milieu desquels grouillent des vers et des fourmis, des araignées et des souris, des puces et des poux. L’enfant est recroquevillé, dans un habit répugnant et déchiré, sa chevelure est devenue une étoupe pénétrée de vermine. Sous les cheveux, la tête de l’enfant est, comme tout son corps, semée d’abcès et de furoncles. Ses membres anormalement allongés dans une croissance contrariée par la malnutrition, le font hurler de douleur quand on s’efforce de le mettre debout, il retombe aussitôt tête la première sur le sol. Pour parvenir à le dévêtir et le laver, il faut couper son vêtement devenu trop petit sur son corps. Ses libérateurs l’assaillent de questions. Réponse pathétique et faiblement prononcée par cet enfant de neuf ans : « Laissez-moi mourir ». On le sort de là à un moment où les dégâts sont trop avancés sur sa personne pour qu’une amélioration de son traitement puisse le sauver. Quoique l’état dans lequel il a été trouvé à la chute de Robespierre avait été connu jusqu’en ses moindres détails au Comité de sûreté générale, à l’Assemblée et au Directoire, nul n’eut le souci de le faire examiner par un médecin, ni de changer quoi que ce soit de sa détention. Il ne sera qu’un lent agonisant jusqu’au 8 juin 1795. Il est jeté dans une fosse aussitôt comblée de façon à ce que jamais personne ne puisse reconnaître l’emplacement. L’anonymat est évidemment fondé sur deux motifs : comme tout totalitarisme, le totalitarisme républicain ne tolère l’existence de rien d’autre qui lui-même, la « table rase » procède de l’effacement de toutes les traces possibles de ce qui a précédé, ce dont il n’y a trace n’a jamais existé ; et Il faut éviter que le lieu ne devienne dans le futur l’objet d’hommages, de dévotion de la part des Français. Subsiste le cœur de l’enfant, prélevé à l’autopsie et caché par le médecin, transmis à divers possesseurs au fil de deux siècles, et qui a été installé à la basilique de Saint-Denis en 2004. Glorieuse République.
1793
Le régime de terreur est installé depuis un an. Dans la Gazette d’un Parisien sous la révolution. Lettres à son frère, 1783-1796, Nicolas Ruault relate : « Ils sont des centaines de cette force dans la Convention. Il faut marcher en silence avec eux, si l’on veut se lever et se coucher tranquille ». Et il faut donner l’allure de la satisfaction. Dans Le Nouveau Paris, en 1798, un témoignage signé Mercier relate les« soupers fraternels » donc joyeux qui furent un temps obligatoires entre voisins : « Chacun, sous peine d’être suspect, sous peine de se déclarer l’ennemi de l’égalité, vint manger en famille à côté de l’homme qu’il détestait ou méprisait ». L’ambiance, évidemment, était particulière. Guittard de Floriban s’efforce de donner un écho favorable de cette innovation. « Chacun descend sa table sans nappe, la dresse ou contre sa maison ou au-dessus du ruisseau [autrement dit du caniveau, en plein juillet] ; […] Chacun apporte ce qu’il a, et on soupe en grande famille […], chacun apporte sa chandelle, cela fait un effet singulier. Il y en a qui ornent leur table de guirlandes, de pots de fleurs […] Pour laisser latitude au trafic, il y a un roulement : toutes les rues ne soupent pas de façon fraternelle au même jour, et ceux qui font relâche « vont voir manger les autres ». Entre-temps, il allait oublier d’en donner précision : « On chante, on rit, on danse ». En réalité la jovialité est un peu contrainte. Mathieu Molé s’en souviendra, trouvant à ces soupers civiques un effet singulier, il dit « bizarre ». Il revoit les guirlandes de feuilles, des rubans tricolores, des lampions. […],frappé surtout par un « silence » qui suffisait à attester, rapporte-t-il, « la terreur qui présidait à la solennité ». Il a noté que « quelques groupes, de loin en loin, étaient chargés d’animer la fête en vociférant des chansons révolutionnaires. La multitude restait muette ». La Révolution doit aux exigences de sa fibre utopique d’être le temps de l’amitié obligatoire (si je peux ajouter, du « vivre-ensemble » selon la novlangue et la Fête des voisins toujours en vigueur, comme quoi…), de la gaité obligatoire, de la liberté, du bonheur imposés, du bonheur « infligé », selon les mots de Michel Porret, historien de l’utopie, qui se risque à parler d’une « prison du bonheur ». La Révolution est le temps, aussi, des danses décrétées par la loi comme « témoignage de l’allégresse publique », des « banquets fraternels » nécessairement joyeux (on vient de le voir), du serment forcé, de la spontanéité obligatoire, de la satisfaction, de l’enthousiasme ou du bonheur et du sourire obligatoires. […] Barère veut imposer « un effort d’enthousiasme ». La rhétorique relative aux fêtes républicaines a tout à fait l’allure de rendre l’enthousiasme obligatoire. D’où certaines réticences de principe. Dont celle de Coupé, à la Convention : « Dans tous les pays les fêtes sont l’expression de l’allégresse et de l’enthousiasme. La prospérité les fait naître : sans elle il est absurde d’en ordonner ». D’où les haussements d’épaule de Mme de Staël : « C’était n’avoir aucune idée de la nature de l’enthousiasme, que d’imaginer qu’en le contrefaisant on le ferait naître ». Quand bien même « il serait à désirer que tous les hommes fussent enthousiastes de la liberté, dévoués à leur patrie, le pays le plus tyrannisé de la terre serait celui où de telles vertus seraient exigées ».
7 avril 1793
C’est à cette date qu’est arrêté Philippe-Égalité à qui a échappé le mouvement révolutionnaire initial auquel a été associée sa faction. Il sera guillotiné. La jalousie et le crime ne paient pas toujours.
La Vendée
Au cours du printemps-été 1793, le gouvernement central révolutionnaire ne se fait plus obéir que dans seulement une trentaine de départements au plus. La révolution déçoit, pire, elle fait peur. Si la révolte n’a pas été générale contre ces « libérateurs », c’est probablement du fait d’un manque de plan d’ensemble chez les révoltés, et par l’activité débordante et énergique de l’extrême minorité au pouvoir. La décision d’anéantir le territoire de la Vendée et d’exterminer sa population pour l’exemple, a été prise par la Convention, les « représentants du peuple souverain », par les décrets du 1er août et 1er octobre 1793. C’est dans toute l’histoire de l’humanité le seul cas de génocide voté « démocratiquement » par des dirigeants contre une partie de leur population. L’Histoire est pavée de massacres d’innocents, mais la Vendée semble être le premier cas de planification de génocide et de destruction méthodique, minutieuse et généralisée avec le déplacement et les méthodes des « colonnes infernales ». En Vendée, l’impensable a été fait par les républicains, l’inimaginable a été essayé, gazage, camps, fours crématoires. La Vendée a été un laboratoire grandeur nature, d’ailleurs conçu comme tel, de la volonté d’extermination « finale ». Elle fut le premier pays à servir de terrain d’expérimentation à la théorie de la purification ethnique, du remplacement d’une population récalcitrante par une autre importée par le régime et conforme à son modèle citoyen. Des départements extérieurs à la Vendée, comme l’Eure, prendront des mesures similaires. Avec les ayatollahs de la République, la guerre change de dimension. Ils n’en ont pas comme par le passé une conception de résolution de conflits d’intérêt économique et de territorialité. Ce sont les premiers à y imaginer la notion de « guerre morale », de diabolisation de l’ennemi, lequel n’est pas fondé à devoir exister. Le « camp du Bien » révolutionnaire dira de ses opposants « les laisser échapper serait partager le crime de leur existence », « c’est par principe d’humanité que je purge la terre de ces monstres » (Carrier). Les opposants à la Révolution ne peuvent pas être des humains.
Il faut distinguer trois grandes phases :
- La guerre civile proprement dite, qui va de mars 1793 à décembre 1793.
- L’énonciation, la conception, la planification et la réalisation d’un système d’anéantissement et de « dépopulation », d’un « populicide » de la Vendée et des Vendéens, selon le néologisme que Gracchus Babeuf, (que l’on peut considérer comme le père du communisme moderne et contemporain des événements), forgera pour qualifier les faits. Extermination qui commence en avril 1793 et se termine avec la chute de Robespierre, assimilable au génocide selon la définition du procès de Nuremberg.
- La manipulation de la mémoire dans l’établissement de « l’histoire officielle ».
Ne nous attardons pas sur la guerre civile, qui est faite de victoires et de revers successifs pour chacun des camps, et qui finira par la défaite des Vendéens. Les deux phases suivantes sont autrement plus instructives. Vous allez découvrir par quelques exemples (car ils sont trop nombreux pour être cités tous) la spirale républicaine de tolérance d’’humanisme.
Le génocide.
Mars 1793, la Vendée militaire (770 communes réparties sur 10.000 km² et quatre départements, les vendéens proprement dits et ceux limitrophes, notamment les bretons avec la Chouannerie) s’insurge comme un seul homme et prend les armes contre la Convention, pour défendre ce qu’ils estiment avoir de plus précieux : la liberté au sens large, et notamment leur liberté religieuse. Leur révolte s’inscrit pleinement dans ce que sera la lettre de l’article 35 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Mais ces belles paroles, très malhonnêtement, ne semblent valoir que pour les partisans de la Révolution. L’élément détonateur de l’insurrection est la conscription de mars 1793. Les révolutionnaires, après avoir déclaré la guerre à l’étranger le 20 avril 1792 afin d’exporter la révolution, subissent une succession de défaites les obligeant à vouloir lever 300.000 hommes. Pour former cette chair à canon au service de la République, sont retenus de préférence les opposants locaux. Dès lors, les Vendéens n’ont plus le choix : soit ils défendent un régime dont ils ne veulent pas, soit ils entrent en résistance, c’est-à-dire en rébellion. L’idée d’exterminer la population vendéenne est pour la première fois énoncée le 4 avril 1793 par certains politiques et officiers supérieurs. Barère, en juillet 1793, propose personnellement un « plan de destruction totale » afin de faire un exemple à destination des autres départements réfractaires à la Révolution. Le 1er août 1793, la Convention vote par décret la destruction de la Vendée, et ordonne entre autres par l’article VIII « l’envoi de matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis et les genêts ». Forêts et futaies doivent donc être abattus, le bétail saisi ou abattu, l’habitat confisqué, les récoltes détruites. Suit le 1er octobre la loi d’extermination, qualifiant les Vendéens de brigands et ordonnant qu’ils soient exterminés avant la fin de ce mois. Tous les habitants de la Vendée sont concernés, sans discernement, y compris les républicains sacrifiés par le régime, dont le seul tort est de vivre dans cette région qui doit être intégralement vidée, rendue déserte à l’image de ce que produirait une bombe nucléaire. Turreau, général de l’armée de l’Ouest dira « La Vendée doit être un cimetière national ». Blancs royalistes et Bleus républicains confondus dans la destruction. Les rapports politiques et militaires sont d’une précision éloquente : il faut prioritairement éliminer les femmes « sillons reproducteurs » et les enfants « car en passe de devenir de futurs brigands ». On crée des camps d’extermination qui leur sont réservés comme à Noirmoutiers. A Bourgneuf et à Nantes, on organise des noyades spéciales pour les enfants. Le premier camp de la mort sera inventé sous la Révolution française, à Brouage ; puis ensuite imité par les socialistes russes de Lénine (dont on sait que grands admirateurs de la Révolution, ils se qualifiaient eux-mêmes de « jacobins prolétariens). Les Vendéens ne doivent plus se reproduire, d’où le recours à une symbolique macabre qui consiste à couper les sexes mâles pour s’en faire, entre autres, des boucles d’oreilles ou pour les arborer à la ceinture comme autant de trophées, ou encore à remplir les vagins de poudre noire à laquelle on met le feu. Les « patriotes » locaux, certificat de civisme à la main, n’en sont donc pas moins égorgés. Le 23 décembre 1793 déjà, Westermann (l’un des principaux commandants républicains avec Turreau, Amey et Carrier) écrira à Paris, alors que le pire reste pourtant à venir : « Il n’y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l’enterrer dans les marais et dans les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m’avez donnés, j’ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré des femmes, qui, au moins pour celles-là, n’enfanteront plus de brigands. Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher. J’ai tout exterminé ». Les résultats de la première période de guerre civile proprement dite (allant jusqu’à la défaite royaliste de Savenay) étant insuffisants, on met le paquet à tous niveaux, scientifique, militaires, méthodes, recherche de moyens d’élimination à grande échelle et efficaces. Il s’agit d’anéantir 815.000 habitants. Les ordres donnés aux « colonnes infernales » ou « queues de Robespierre » envoyées par Paris le 21 janvier 1794, seront de massacrer et d’incendier tout sur leur passage. Le meurtre de masse a un coût financier. On part du principe que la République se paiera sur l’exécuté, notamment par la vente à l’encan des vêtements saisis, dents, cheveux, etc. des victimes. On rationalisera et on globalisera le système par la Commission des subsistances chargée du pillage de la Vendée. Extraits pêle-mêle des Archives départementales et nationales, archives militaires du fort de Vincennes :
Les passions sont tellement surexcitées pendant cette année 1793 qu’au rayon des moyens d’élimination à grande échelle, on songe à recourir aux armes chimiques. Pour ce faire, on sollicite l’un des plus grands chimistes de l’époque, Antoine Foucroy, qui ne trouvera pas de solution. Un pharmacien d’Angers, Proust, invente une boule de cuir contenant d’après lui « un levain propre à rendre mortel l’air de toute une contrée ». On pourrait l’employer pour détruire la Vendée par infection, mais des essais tentés sur des moutons, devant une délégation de députés, ne donnent pas satisfaction. Carrier propose alors le poison sous forme d’arsenic dans les puits. Les idées fusent, certaines semblent même avoir trouvé un commencement d’exécution, témoin cette lettre de Savin à Charette du 25 mai 1793 : « Nous fûmes vraiment étonnés de la quantité d’arsenic que l’on trouva à Palluau, au commencement de la guerre. On nous a même constamment assuré qu’un étranger, qu’ils avaient avec eux et qui fut tué à cette affaire, était chargé d’assurer le projet d’empoisonnement ».
La guillotine, surnommée le « moulin à silence » ou le « rasoir national », fonctionne sans trêve. Comme elle est trop lente, que les baïonnettes et les sabres cassent trop facilement sous les chocs répétés, de même que les crosses de fusils dont on se sert pour éclater les crânes, on a recours à des moyens plus radicaux et plus efficaces comme l’explique un citoyen au représentant du peuple Minier : « Mon ami, je t’annonce avec plaisir que les brigands sont bien détruits. Le nombre qu’on en amène ici depuis huit jours est incalculable. Il en arrive à tout moment. Comme en les fusillant c’est trop long et qu’on use de la poudre et des balles, on a pris le parti d’en mettre un certain nombre dans de grands bateaux, et de les conduire au milieu de la rivière, à une demi-lieue de la ville et là on coule le bateau à fond. Cette opération se fait journellement ». La procédure est simple : on entasse la cargaison humaine dans une vieille galiote aménagée de sortes de sabords ; une fois au large, on les fait voler en éclats à coups de hache : l’eau gicle de toutes parts et en quelque instants tous les prisonniers sont noyés. Ceux qui en réchappent sont immédiatement sabrés (d’où le mot de « sabrades ») par les bourreaux qui de leurs barques légères assistent au spectacle. Ces noyades donnent lieu à des festivités et des banquets sur les lieux mêmes.
« D’abord les noyades se faisaient de nuit, mais le comité révolutionnaire ne tarda pas à se familiariser avec le crime : il n’en devint que plus cruel et dès ce moment, les noyades se firent en plein jour…D’abord les individus étaient noyés avec leurs vêtements ; mais ensuite le comité, conduit par la cupidité autant que par le raffinement de la cruauté, dépouillait de leurs vêtements ceux qu’il voulait immoler aux différentes passions qui l’animaient. Il faut aussi vous parler du « mariage républicain » qui consistait à attacher, tout nus, sous les aisselles, un homme à une jeune femme, et à les précipiter ainsi dans les eaux. » De préférence le père et la mère, le frère et la sœur, un curé et une religieuse, etc.La femme Pichot, vingt-cinquième témoin, demeurant à la Sècherie de Nantes, c’est-à-dire juste en face de l’endroit où l’on noie, déclare qu’elle a vu des charpentiers faire des trous à une gabare : le lendemain elle apprend qu’on avait noyé « grand nombre de femmes dont plusieurs portaient des enfants sur leurs bras ». Carrier se vante devant l’inspecteur de l’armée, Martin Naudelle, « d’y avoir fait passe deux mille huit cents brigands » dans ce qu’il appelle « la déportation verticale dans la baignoire nationale », « le grand verre des calotins » ou « le baptême patriotique ». Ce sont 4.800 personnes recensées, que la Loire, ce « torrent révolutionnaire », engloutit au cours du seul automne 1793.
Les conventionnels, dans un souci d’économie (un bateau coulé coûte 200 livres) ont essayé l’asphyxie à partir de bateaux rendus hermétiquement clos. Ce moyen n’est cependant pas retenu suite à une plainte à la municipalité : « Le râle des mourants dérange les riverains… » comme le mentionne un registre des délibérations du conseil municipal de Nantes. Les villes, grandes et moyennes, sont transformées en cités d’extermination.
Les représentants Choudieu et Bellegarde avouent, le 15 octobre 1793, dans une lettre à la Convention, que l’armée de la république était partout précédée de la terreur : « le fer, le feu sont les seules armes dont nous fassions usage ». Dès son arrivée, Turreau écrit au Comité de salut public à deux reprises pour arrêter le plan qu’il compte suivre. Ce n’est que le 8 février 1794 que le Comité de salut public envoie son accord par l’intermédiaire de Carnot : « Tu te plains, citoyen général, de n’avoir pas reçu du Comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures mais, éloigné du théâtre d’opération, il attend les résultats pour se prononcer : extermine les brigands jusqu’au dernier, voilà ton devoir… ».
Le 31 janvier 1794, l’Officier de police Gannet écrit dans un rapport : « Amey fait allumer les fours et lorsqu’ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations ; il nous a répondu que c’est ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D’abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes, et nous n’avons trop rien dit ; mais aujourd’hui les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et Turreau qu’ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femmes des royalistes manquant, ils s’adressent aux épouses des vrais patriotes. Déjà, à notre connaissance, vingt-trois ont subi cet horrible supplice et elles n’étaient coupables que d’adorer la nation. Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont menacé du même sort ».
Dans son courrier adressé les 17 et 26 janvier 1794, Dupuy, capitaine du bataillon de la Liberté, décrit entre autres : « …des militaires républicains porter des enfants à la mamelle au bout de la baïonnette ou de la pique qui avait percé du même coup la mère et l’enfant ». Le chirurgien Thomas écrit : « J’ai vu brûler vifs des femmes et des hommes. J’ai vu cent cinquante soldats maltraiter et violer des femmes, des filles de quatorze et quinze ans, les massacrer ensuite et jeter de baïonnette en baïonnette de tendres enfants restés à côté de leurs mères étendues sur le carreau… ».
Le 27 janvier 1794, Grinon commandant de la seconde colonne infernale, pénètre dans le village de La Flocellière et ordonne un égorgement général de la population. Il n’hésite pas à tuer même les républicains : « Je sais qu’il y des patriotes dans ce pays, note-t-il, c’est égal, nous devons tout sacrifier. » Un patriote et sa servante sont ainsi coupés en morceaux.
Le 17 mars 1794 à La Chapelle Bassemer, le nommé Peigné et l’Abbé Robin décrivent : « … Ici, par un raffinement de barbarie, peut-être sans exemple, des femmes enceintes étaient étendues et écrasées sous des pressoirs. » (…) « Une jeune fille de La Chapelle fut prise par des bourreaux, qui après l’avoir violée la suspendirent à un chêne, les pieds en haut. Chaque jambe était attachée séparément à une branche de l’arbre et écartée le plus loin possible l’une de l’autre. C’est dans cette position qu’ils lui fendirent le corps avec leur sabre jusqu’à la tête et la séparèrent en deux. » Il y eut encore beaucoup d’autres atrocités ce 17 mars que Peigné appelle la journée du « grand massacre ». Dans d’autres cas, des femmes sont jetées par les fenêtres sur des baïonnettes pointées dans leur direction. Il raconte encore : « A la Pironnière, et en plusieurs autres lieux, des enfants, au berceau, furent transpercés et portés palpitants au bout des baïonnettes » (…).
Aux Ponts-de-Cé, on tanne la peau des victimes, afin de faire des culottes de cheval pour les officiers supérieurs. Un témoin, le berger Robin raconte que les cadavres « étaient écorchés à mi-corps parce qu’on coupait la peau au-dessous de la ceinture, puis le long de chacune des cuisses jusqu’à la cheville des pieds de manière qu’après son enlèvement le pantalon se trouvait en partie formé ; il ne restait plus qu’à tanner et à coudre. » Ces hommes ne faisaient que suivre Saint-Just qui, dans un rapport en date du 14 août 1793, à la Commission des Moyens extraordinaires déclare : « On tanne à Meudon la peau humaine. La peau qui provient d’hommes est d’une consistance et d’une bonté supérieure à celle des chamois. Celle des sujets féminins est plus souple, mais elle présente moins de solidité… ».
À Clisson encore, des soldats du général Crouzat brûlent 150 femmes pour en extraire de la graisse. Un soldat raconte : « Nous faisions des trous de terre pour placer des chaudières afin de recevoir ce qui tombait ; nous avions mis des barres de fer dessus et placé les femmes dessus, (…) puis au-dessus encore était le feu (…). Deux de mes camarades étaient avec moi pour cette affaire. J’en envoyai 10 barils à Nantes. C’était comme de la graisse de momie : elle servait pour les hôpitaux et les essieux des charrettes ».
Enfin, dans les prisons de Nantes, en raison de la déplorable tenue des lieux et du mauvais régime alimentaire, une épidémie de typhus s’y déclare : c’est une véritable hécatombe. Un rapport des commissaires Allard, Louis, Chapetel et Robin la mentionne, il est intitulé : « travaux pour les inhumations et enfouissements des animaux crevés ».
Malgré tout cela, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances de la Convention et du Comité de salut public. La Vendée militaire, sur une population de 815.000 personnes, en a perdu au moins 117.000, dont une grande partie du fait du système d’anéantissement et d’extermination décrit. Ailleurs dans d’autres régions, notamment à Lyon, auront également lieu des massacres d’opposants à la révolution jacobine, mais dans des proportions moindres.
Le mémoricide.
Après le populicide, vient l’occultation de la mémoire, cacher, nier et déformer le crime. Et bien sûr la manipulation de l’opinion.
Il va falloir attendre la chute de Robespierre pour que l’opinion prenne conscience de « l’énormité de l’acte » commis en Vendée. A la stupeur générale suit très vite la colère. On exige des coupables et des peines. S’ouvre en décembre 1794 le procès de Carrier, bouc-émissaire du régime, dont la condamnation et l’exécution sont censées laver la Convention (pourtant largement complice de la terreur de masse) de toute responsabilité. Carrier disparu, on espère que l’oubli fera table rase de ce crime qui tache de manière indélébile la Révolution. Suivra le procès de Turreau en décembre 1795. L’horreur est si grande que les conséquences politiques s’imposent à tous : au-delà des hommes, c’est le régime politique qui est discrédité et condamné… ça chauffe pour les révolutionnaires qui demeurent une minorité terroriste sans assentiment général de l’opinion. S’engage alors une course contre la montre dont l’enjeu est la survie même de la Révolution et des révolutionnaires. Les Vendéens et les Chouans de Bretagne par plusieurs traités de paix se prêtent au jeu de la réconciliation, d’autant plus facilement qu’on leur promet secrètement la restitution du dauphin roi Louis XVII à ce moment-là encore vivant, et la restauration de la monarchie. D’ailleurs celle-ci paraît inévitable et les élections législatives sont proches. Les conventionnels, désespérés et apeurés, décident de forcer le destin : une lettre écrite par sept d’entre eux et adressée au représentant du peuple Guezno explique la stratégie à retenir : « Il est impossible, cher collègue, que la République puisse se maintenir si la Vendée n’est pas entièrement réduite sous le joug. Nous ne pourrons nous-mêmes croire à notre sûreté que lorsque les brigands qui infestent l’Ouest depuis deux années auront été mis dans l’impuissance de nous nuire et contrarier nos projets, c’est-à-dire lorsqu’ils auront été exterminés. C’est déjà un sacrifice trop honteux d’avoir été réduits à traiter de la paix avec des rebelles ou plutôt avec des scélérats dont la très grande majorité a mérité l’échafaud. Sois convaincu qu’ils nous détruiront si nous ne les détruisons pas. Ils n’ont pas mis plus de bonne foi que nous dans le traité signé et il ne doit leur inspirer aucune confiance dans les promesses du gouvernement. Les deux partis ont transigé sachant bien qu’ils se trompaient. C’est d’après l’impossibilité où nous sommes d’espérer que nous pourrons abuser plus longtemps les Vendéens, impossibilité également démontrée à tous les membres des trois comités, qu’il faut chercher les moyens de prévenir des hommes qui auront autant d’audace et d’activité que nous. Il ne faut pas s’endormir parce que le vent n’agite pas encore les grosses branches, car il est bien près de souffler avec violence. Le moment approche, où, d’après l’article II du traité secret, il faut leur présenter une espèce de monarchie, et leur montrer ce bambin pour lequel ils se battent. Il serait trop dangereux de faire un tel pas ; ils nous perdraient sans retour. Les comités n’ont trouvé qu’un moyen d’éviter cette difficulté vraiment extrême ; le voici. La principale force des brigands est dans le fanatisme que leurs chefs leur inspirent, il faut les arrêter, et dissoudre ainsi, d’un seul coup, cette association monarchique qui nous perdra si nous ne nous hâtons pas de le prévenir. Mais il ne faut pas perdre de vue, cher collègue, que l’opinion nous devient chaque jour encore plus nécessaire que la force ; il faut tout sacrifier pour mettre l’opinion de notre côté. Il faut supposer que les chefs insurgés ont voulu rompre le traité, se créer princes des départements qu’ils occupent ; que ces chefs ont des intelligences avec les Anglais ; qu’ils veulent leur offrir la côte, piller la ville de Nantes et s’embarquer avec le fruit de leurs rapines. Fais intercepter des courriers porteurs de semblables lettres, crie à la perfidie et mets surtout dans ce premier moment une grande apparence de modération afin que le peuple voie clairement que la bonne foi et la justice sont de notre côté. Nous te le répétons, cher collègue, la Vendée détruira la Convention, si la Convention ne détruit pas la Vendée. Si tu peux avoir les onze chefs, le troupeau se dispersera. Concerte-toi, sur-le-champ, avec les administrateurs d’Ille-et-Vilaine. Communique la présente dès sa réception aux quatre représentants de l’arrondissement. Il faudra profiter de l’étonnement et du découragement que doit produire l’absence de chefs pour opérer le désarmement des Vendéens et des Chouans. Il faut qu’ils se soumettent au régime général de la République ou qu’ils périssent ; point de milieu ; point de demi-mesures, elles gâtent tout en révolution. Il faut, s’il est nécessaire, employer le fer et le feu, mais en rendant les Vendéens coupables aux yeux de la nation du mal que nous leur ferons. Saisis, nous te le répétons, cher collègue, les premières apparences qui se présenteront pour frapper le grand coup car les événements pressent de toutes parts […]. » Ces méthodes parviendront à leur but, et l’opinion publique nationale ne verra dans les Vendéens comme dans les Chouans que des hommes parjures. Chapelain, le député républicain de la Vendée, sera hué par le public pour avoir dénoncé les horreurs commises. La nation a fait un choix définitif : les arguments suivront, logiques, cruels, injustes et malhonnêtes. L’unité nationale, consciente et inconsciente, s’est cristallisée contre les Vendéens : plus rien ne pourra la remettre en question et malheur à celui qui osera rappeler la réalité des événements. Les « procès-diversion » de Carrier et Turreau permettront à d’autres grands terroristes, tels Fouché, de se maintenir dans le système et y faire une tranquille et juteuse carrière sous Bonaparte, lequel mettra tout de même en œuvre des réparations à la population sinistrée de la Vendée militaire.
Avec le règne de Louis-Philippe commence en 1830 la révision de l’histoire et le travail de manipulation de la mémoire et de l’histoire officielle au nom de l’intérêt supérieur de la nation et des principes « fondateurs » de la Révolution. Après la retraite ou la mort des témoins oculaires, l’opération consiste à laver la Révolution de toute souillure, à ôter la tache de sang vendéenne. Comme on est incapable d’expliquer le crime commis, on préfère le nier, le relativiser, le justifier, le banaliser, méthode toujours utilisée de nos jours. Les livres scolaires résument savamment la Vendée à une petite guerre civile, née en mars 1793 et morte en décembre de la même année. Les faits de 1794 ne sont définis que par rapport à une guérilla ou cyniquement concentrés sur un massacre commis par des royalistes, à Machecoul, massacre unique d’ailleurs, qui fait suite à un massacre commis par les Bleus, à Pornic, trous jours auparavant, et un pseudo-meurtre d’un enfant soldat nommé Bara, mort dont on ne connaît pas l’origine, et dont le mythe a été créé de toutes pièces par Robespierre lui-même malgré les protestations du supérieur de l’enfant qui sera d’ailleurs condamné à mort pour cette raison et exécuté. Ce négationnisme va si loin que l’on nie et dénonce l’existence des lois d’anéantissement et d’extermination, malgré leur publication par le journal officiel de l’époque, du plan dit de Turreau, plan dont les archives du fort de Vincennes conservent l’original, des noyades, des tueries de masse notamment d’enfants et de femmes, des fours crématoires, des tanneries de peaux humaines, des fontes de graisse, etc. Certains historiens républicains n’hésitent pas, d’ailleurs, à justifier l’injustifiable au nom de la Révolution, partant du principe que la Révolution étant un bloc (selon la formule de Clémenceau), rien ne devant l’entacher. Argument utilisé pour la première fois dès le procès Carrier. Ne surtout pas faire le procès de la Révolution française. Tout comme l’oligarchie actuelle se refuse toujours à faire le procès du communisme et de ses cent millions de morts. Le bicentenaire de la Révolution sous la présidence de François Mitterrand aurait dû être l’occasion d’aborder, hors idéologie, cette période. Non seulement il n’en a rien été mais tout a été fait par rapport au dogme officiel. Les colloques scientifiques organisés sur la question vendéenne, n’avaient que ce but. On a d’ailleurs pris la précaution d’éviter d’inviter tout contradicteur, taxé de « révisionnisme », tout en faisant le nécessaire pour les empêcher d’être recrutés comme enseignants ou chercheurs. On voit comment la « pluralité des discours » est admise en France républicaine, laquelle a l’audace de se camper en donneuse de leçons à d’autres pays. En conséquence, l’histoire officielle habille encore les victimes en traîtres, et les bourreaux en « saints laïcs ».
1792 – 1794. La seconde Révolution (suite)
Le concept « nation » et la démocratie « représentative ».
On s’est bien gardé de faire comprendre aux Français le sens véritable de ces concepts, en les entretenant dans la fiction du « peuple souverain » au travers de ses « représentants ». Condorcet déclare en 1793 devant la Convention : « le peuple m’a élu pour exposer mes idées, non les siennes. L’indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui ». Magnifique illustration du cynisme politique et de la forfaiture sur laquelle repose tout l’édifice démocratique contemporain. Un modèle rare de tromperie que la démocratie représentative pratiquée en France. Ce principe fondamental est toujours en vigueur, nous le savons, exprimé en jargon juridique abscons par le premier alinéa de l’article 27 de la Constitution de 1958 « Tout mandat impératif est nul ». Autrement dit, on ne reconnait aucune valeur légale (d’où le terme « nul ») à un mandat qui serait donné avec ordre (d’où le terme « impératif ») de porter les choix et opinions des électeurs. Concrètement, la loi fondamentale du pays proclame que le député une fois élu n’est pas lié par les engagements pris devant ses électeurs. Aussi scandaleux que cela puisse paraître, il n’est pas élu pour exprimer et mettre en œuvre la volonté de ceux qui lui ont donné mandat. Cela lui est interdit par cet article 27 qui le dégage officiellement de toute responsabilité dans ce qu’il fait par rapport à son électorat. Lorsqu’il vote un texte de loi, il s’exprime en réalité en tant que représentant non pas de ceux-ci mais du concept abstrait de « Nation » dans son ensemble, et son vote peut tout autant dépendre de choix personnels, de consignes de son parti, ou d’intérêts que n’auraient pas approuvé ses électeurs. Quel esprit honnête peut se satisfaire de vivre sous cette escroquerie.
17 septembre 1793.
Après les massacres de septembre 1792, et la mise en place du tribunal révolutionnaire en 1793, la loi des suspects du 17 septembre 1793 qui aboutira à un climat de dénonciations et d’arrestations arbitraires, sera l’un des instruments majeurs de la Terreur jacobine. Des comités de surveillance créés dans chaque arrondissement dresseront les listes de suspects ainsi rapportés à leurs registres. Des dizaines de milliers d’exécutés, si l’on compte ceux qui l’ont été sans jugement. Ceux qui ont eu les faveurs du tribunal révolutionnaire ont été à 85 % des gens du peuple qui, selon la formule du temps à Paris, « n’ayant rien fait contre la Liberté, n’ont aussi rien fait pour elle ». Ne pas participer était en soi un crime.
Le citoyen vertueux est un terroriste.
« L’âme de la République, dit Robespierre, est la vertu ». Le bon citoyen sera donc vertueux. Ce n’est pas là du moralisme politique. Pour ce dernier, la politique est une branche de la morale. Dans la pensée de Robespierre, la politique est la morale elle-même, et cette morale est mythique, tout entière contenue dans l’amour de la patrie. Et cet amour de la patrie, comme dit encore Robespierre, « embrasse nécessairement l’amour de l’égalité ». Le gouvernement de la République n’a de ce fait qu’une règle de conduite, fortifier l’amour de l’égalité. Sinon il perd sa raison d’être. Toute la démocratie française est là et sera toujours là. Le citoyen vertueux est terroriste, parce que, dit Robespierre, « la terreur est une émanation de la vertu », et parce que, dit-il encore, « sans la terreur la vertu est impuissante ». Cette politique, il le pense, est la morale même, et cette morale, il faut bien le constater, engendre un principe d’extermination. Il ne suffit pas que la patrie et l’égalité soient aimées, il faut encore que ceux qui ne les aiment pas disparaissent. Car il n’y a pas de demi-mesure. N’être pas vertueux, selon ces vues, c’est être un criminel. Ou c’est le crime qui disparait, ou bien c’est la vertu. « Il faut que l’un ou l’autre succombe. » « Il n’y a de citoyens dans la République que les républicains » dit Volney. D’où la nécessité de la purge. Aucun élément impur ne doit subsister. La mort est indispensable à la prospérité de la vertu. On commence par la dénonciation. Les pionniers donnent l’exemple. « J’ai toujours été le premier à dénoncer mes amis, du moment où j’ai vu qu’ils se conduisaient mal », déclare Camille Desmoulinsaux Jacobins le 14 décembre 1793.A peine arrivés dans les départements, les représentants en mission exhortent à dénoncer. « Sans-culottes, dénoncez hardiment » dit Joseph Lebon aux patriotes du Pas-de-Calais. Si vous dénoncez les riches, leurs biens seront à vous. « Ne connaissez-vous pas quelque riche, quelque marchand, dénoncez-le et vous aurez son bien. » (Lettres édifiantes des missionnaires de 1793, Paris, 1828, pages 113-114). Est-il moralement très sain et vertueux de construire une société sur l’extermination par dénonciation pour faire main basse sur le bien d’autrui. Je vous laisse juge de la réponse. La porte ouverte est là, à toutes les malhonnêtetés possibles, parce qu’on lorgne jalousement sur le champ du voisin, sur son commerce, sur sa maison, comme on le verra ailleurs plus tard (avec les bolcheviques, avec les républicains espagnols, à la « Libération » en 1945 avec l’épuration menée par les communistes). Dans chaque chef-lieu de district des registres de dénonciation sont donc ouverts. Fin avril 1793, le registre d’Auray a déjà recueilli cent-soixante-dix-sept dénonciations. Dénoncer est un acte civique. « Dénoncer est une vertu, écrit aux citoyens de Nancy le Comité de Salut Public ». Le dénoncé est innocent, mais le dénonciateur est un bon citoyen. La machine terroriste est mise en place sur tout le territoire. Ce sont les comités de surveillance. La loi du 21 mars 1793 ordonne leur formation, dans chaque commune et dans chaque section de ville (pour celles de plus de 25.000 habitants), d’un comité de surveillance composé de douze citoyens. On arrive facilement à un total de 500.000 membres de comités de surveillance, 500.000 petits tyrans de voisinage. Il faut ajouter au nombre de ces citoyens terroristes les soldats citoyens employés à la répression et à la traque des suspects. Si on pouvait dresser une statistique complète, on aboutirait sans doute à un total d’un million de citoyens terroristes, soit un septième environ de la population masculine active. La Terreur a été décidée par le Comité de Salut Public, mais le Comité a voulu que l’application de la loi révolutionnaire soit confiée aux citoyens eux-mêmes, exerçant leur fonction terroriste dans le cadre des municipalités. « L’action qui part du sein de la Convention, leur dit-il, vient aboutir à vous ; vous êtes comme les mains du corps politique dont elle est la tête, et dont nous sommes les yeux » « Vous êtes comme des instruments redoutables et guerriers, qui n’attendent, pour lancer la terreur et la mort, que la communication électrique de la flamme ». La Révolution est assimilée à l’électricité. Tous les corps, avait démontré le physicien Du Fay, peuvent être électrisés. Tous les citoyens aussi par le courant révolutionnaire. Le plus souvent, le citoyen terroriste n’est ni un traîne-savates, ni un crève-la-faim, mais une personne exerçant une profession honorable (notaire, médecin, instituteur public, artisan, cultivateur, joaillier, coiffeur, luthier, entrepreneur, orfèvre entre autres montrent les archives). Le citoyen peut devenir terroriste par esprit de lucre. Dans plusieurs départements, des indemnités éveillent des vocations. En exigeant de « l’homme nouveau » la « vertu », Robespierre a voulu sans doute lui donner un caractère moral. Mais cette vertu n’a aucun rapport avec la morale.
Rôle de l’Éducation nationale.
« Tous les enfants devraient être procréés par insémination artificielle et élevés dans des institutions publiques » fait dire Orwell dans 1984, son roman futuriste écrit en 1948. A-t-il inventé ce genre d’idée ? Non évidemment. La chose est connue. Elle n’est qu’une expression de l’obsession égalitariste. Orwell ne fait qu’exprimer l’idée d’utérus artificiel, et les doctrines de formatage des enfants élaborées à partir de 1789. Car ce n’est pas tout d’avoir créé le citoyen. Il faut encore le reproduire. Les hommes de la Révolution veulent des citoyens. L’« éducation nationale » les produira. Elle forme ainsi un « peuple nouveau », dit Rabaud Saint-Etienne. On parle désormais de « race ». « Ainsi se formera une race nouvelle, une race renouvelée, forte, laborieuse, réglée, disciplinée » (Le Peletier dans son plan d’éducation). Le mot est entendu au sens d’espèce différente et supérieure : la race des citoyens de la République. Le Français qui a bâti ce pays depuis dix-huit siècles, c’était de la merde. Le nouveau régime terrorise la population avec ses comités de surveillance. De l’État surveillant à l’État éducateur le pas est vite franchi.
Dans la pure conception socialiste, en effet, les enfants sont la chose de l’État.
« La Patrie a le droit d’élever ses enfants, elle ne peut confier ce dépôt à l’orgueil des familles, ni aux préjugés des particuliers » (Robespierre).
« Les enfants appartiennent à leur mère jusqu’à cinq ans, si elle les a nourris, et à la République ensuite, jusqu’à leur mort » (Saint-Just).
« Les enfants appartiennent à la République avant d’appartenir à leurs parents. Qui me répondra que ces enfants, travaillés par l’égoïsme des pères, ne deviendront pas dangereux pour la République ? » (Danton).
« J’ai toujours pensé que les enfants étaient propriété de l’État, et que les parents n’en étaient que les dépositaires » (Thibaudeau).
« J’entends revendiquer pour la nation une éducation qui dépende seulement de l’État […] les enfants de l’État doivent être éduqués par les membres de l’État » (La Chalotais).
L’État est donc tenu de mettre la main sur l’enfant dès sa naissance. Malgré son discours de « libération », de ce que les idéologues de 1789 considéraient, non sans exactitude, un monopole de l’Église sur l’esprit des gens et de leurs enfants, il ne s’est donc pas agi de proposer un enseignement neutre, faisant du récipiendaire quelqu’un de véritablement libre, mais au contraire d’y substituer une autre emprise, celle de la propagande du nouveau régime. La morale de l’Église s’occupe de la fin de l’homme, du devenir de l’âme, c’est son fonds de commerce ; pas la morale de la philosophie révolutionnaire ni celle des Lumières, qui s’occupent de son « organisation » (organisation physique en tant qu’il est constitué d’organes, et organisation sociale répondant aux intérêts du régime).
« L’éducation nationale consiste à s’emparer de l’homme dès le berceau » (Rabaud Saint-Etienne), et même avant sa naissance, parce que « l’enfant qui n’est pas né appartient déjà à la patrie ».
L’ « éducation nationale s’empare de tout l’homme sans le quitter jamais », n’étant pas « une institution pour l’enfance mais pour la vie entière » (Rabaud Saint-Etienne à la Convention, 21 décembre 1792, Archives parlementaires). D’autres expriment le même discours.
« C’est à l’État à recevoir pour ainsi dire l’enfant du sein de sa mère » (Thibaudeau à la Convention le 1er août 1793).
« Il faut que l’éducation nationale s’empare de la génération qui naît, qu’elle aille trouver l’enfant sur le sein de sa mère » (Grégoire toujours à la Convention le 1er janvier 1794).
Discours sans équivoque, d’arrachage de l’enfant, et de formatage idéologique aux nécessités du nouveau régime. Par l’éducation, séparant l’enfant de l’influence familiale pour le faire évoluer dès le plus jeune âge dans un bain de camaraderie, il s’agit aussi de créer une société où l’amitié (gage de la disparition des conflits) constitue le lien par excellence, plus dense que le mariage ou la parenté : puisqu’un homme, dans la conception sociétale de Saint-Just, doit déclarer chaque année quels sont ses amis, s’expliquer en public lorsqu’il rompt avec l’un d’eux, et qu’il sera banni de la cité si son ami a commis un crime, s’il l’a trahi, s’il n’a pas d’amis ou s’il reconnaît ne pas croire en l’amitié. C’est la grande fraternité universelle obligatoire, au forceps. Avec en germe cette société de la transparence, du tout le monde sait tout sur tout le monde, au travers de ces séances de justifications publiques effaçant la vie privé et l’intimité. L’école se confond avec la République, elle en est le « moule républicain ». Tous les enfants y sont jetés. « Tout ce qui doit composer la République sera jeté dans le moule républicain » (Robespierre lisant Le Peletier à la Convention le 13 juillet 1793). L’enfant sera fabrique ; il sera conformé, « L’habitude est tout pour la race humaine, et ses premières inclinations décident de son sort pour l’avenir » (Lequinio, Les Préjugés détruits, 1792). Le système n’est pas allé jusqu’à la société de Saint-Just (bien qu’elle y tende de plus en plus), mais à cette exception près, chacun peut voir que l’essentiel de la doctrine éducative révolutionnaire et toujours en application dans la France de 2016.
Vandalisme révolutionnaire.
Nul monument, nulle ville qui ne porte les traces de saccages opérés sous la Révolution. L’opinion mondiale s’est scandalisée du dynamitage de statues de Bouddha par les talibans afghans et des destructions perpétrées par l’État islamique à Palmyre ou dans des musées irakiens. La démarche fanatique des révolutionnaires jacobins contre les trésors architecturaux militaires et religieux du passé français n’est en rien différente, tout comme le fut celle des premiers chrétiens imposant par la violence leur doctrine aux peuples païens : effacer les traces et la mémoire de ce que l’on refuse. Ce dont il n’y a pas trace n’a jamais existé. S’agissant du vandalisme révolutionnaire français, il a reposé sur deux motifs principaux : la spéculation financière, et l’idéologie politique.
On peut identifier trois types de vandalisme. Il y a vandalisme de pulsion, porté par ces discours exaltés sur les symboles de « la tyrannie », les « repaires de brigands », les « marques infâmes » de « l’esclavage ancien », la « purification » de la France (« qu’un sang impur… »), et exécuté d’initiative comme défouloir par les fanatiques.
Il y a aussi vandalisme par procuration, un vandalisme où l’on ne se salit pas les mains, en quelque sorte. Il s’exprime de deux manières. En ordonnant la suppression des armoiries et blasons sur tout le territoire français (décret du 19 juin 1790), la Constituante a ouvert la voie à l’anéantissement d’un immense patrimoine héraldique (resté visible dans d’autres pays, Angleterre, Italie…), qui touchait aussi bien à l’histoire qu’à l’art, de nombreux monuments ayant été réalisés par de grands sculpteurs depuis le Moyen Âge. Mais beaucoup plus grave car ayant eu le plus de conséquences, par la mise en vente des « bien nationaux » (constitués par la nationalisation des biens du clergé, puis ceux de la Couronne et des aristocrates ayant fui la France), la Constituante et la Législative, voulant renflouer le trésor de l’État, ont aussi mené à l’anéantissement d’édifices, par spéculation, destruction procurant des matériaux et un terrain à réutiliser, par transformation en un usage contraire à la bonne conservation (salles de spectacle, usines à salpêtre, écuries…) : le vandalisme à vocation commerciale. L’Abbaye de Cluny détruite au canon et ses gravats vendus au poids n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. Par peur de la guillotine aussi, parce que la terreur engendre la lâcheté, le vandalisme antireligieux était devenu une preuve de « civisme ». Pour l’anecdote, il faut noter que cette entreprise donna lieu à des inventions remarquables, comme ce système mis au point par un architecte raté, Petit-Radel, et destiné à opérer, jouant sur les points essentiels du maintien de l’édifice, la destruction d’une église médiévale en « dix minutes ».
Enfin, troisième vandalisme, « l’idéologique », recouvrant les destructions ordonnées par le gouvernement révolutionnaire et ses différentes émanations administratives. Il est proprement de la responsabilité de la Ière République, entendue comme période historique et comme régime politique. La Révolution française égalitariste étant la matrice du totalitarisme communiste, ce vandalisme idéologique annonce nombre de destructions qui frapperont les œuvres de l’art et de l’intelligence au XXè siècle, sur tous les points du globe et sous les dictatures de tous ordres.
Le vandalisme antimonarchique se déchaîna après le coup d’État du 10 août 1792 (concrétisé comme on l’a vu par l’attaque des Tuileries, le massacre des Gardes Suisses, et l’asile contrait de la famille royale dans les murs de la Convention, entraînant la chute du gouvernement et de la monarchie). La jeune République s’est retrouvée face à d’innombrables monuments, tableaux, sculptures, livres, tapisseries, meubles… qui chantaient la gloire séculaire de la monarchie française. Non seulement le sol national en était saturé, mais encore les esprits pouvaient partout trouver matière à remémoration royale. Afin de ne pas « blesser » les yeux des bons citoyens, selon la phraséologie primaire du moment, il fallait donc entreprendre une opération d’amputation de cette mémoire visible. Cette élision royale fonctionna de deux manières, par destruction et par mutilation. L’aspect le plus spectaculaire fut la destruction des effigies royales, pourchassées partout. Des centaines de tableaux, surtout des portraits, furent anéantis. Pire (car il subsiste malgré tout des effigies royales peintes), fut le sort réservé aux statues, équestres ou pédestres, et aux bas-reliefs monumentaux, œuvres admirables dues aux meilleurs sculpteurs italiens et français qui ornaient les places royales et les édifices publics, tant à Paris qu’en province. Il n’en reste pas une seule sur tout le territoire français, à l’exception d’une statue en pied de Louis XIV, précieuse figure de bronze de Coysevox (musée Carnavalet), qui fut inexplicablement épargnée. Cinq grandes statues disparues à Paris, une à Lyon place Bellecour, dont les édifices furent rasés au canon eux aussi, une à Dijon, Nancy, Reims, Valenciennes, Caen, Montpellier, Bordeaux, deux à Rennes… On ne conserva ça et là que des figures secondaires sur les piédestaux (Paris, Reims, Lyon…). La statue de pierre de Louis XII à la façade du château de Blois, le Charles VII de Bourges, le Philippe le Bel à cheval de Notre-Dame de Paris, l’Henri IV de l’Hôtel de Ville de Paris, ou le Louis XIV caracolant à la façade de l’Hôtel de Ville de Lyon et aux Invalides, etc. subirent le même sort. Toutes ces statues de pierre et de bronze furent renversées, brisées, éparpillées voire fondues, anéantissant une somme de trésors sculptés inestimables. Connerie crasse de l’idéologie. Seule exception : à Saint-Denis, où les tombes royales furent profanées et les morts chassés de leur sépulture, les républicains ne détruisirent « que » deux pièces capitales : le tombeau de marbre de Charles VII, dû à l’Italien Guido Mazzoni, et la dalle funéraire de Charles le Chauve.
Pour ce qui est des bâtiments, la République opéra non par destruction totale mais par mutilation. Ont tout de même survécu les châteaux aujourd’hui célèbres, ainsi que la cathédrale des sacres (Remis) et la Basilique de Saint-Denis. Mais dans tous ces édifices le vandalisme idéologique s’acharna sur les symboles et mutila façades et décors sculptés, tout ce qui blessait le « sentiment d’égalité ». Des milliers de fleurs de lys, de couronnes, de chiffres royaux, de statues et de bas-reliefs furent soigneusement, patiemment… et coûteusement martelés. Dans la chapelle de Versailles, qui en était remplie, quelques fleurs de lys subsistent tout de même aujourd’hui. On alla jusqu’à gratter des reliures, arracher des bordures de tapisseries, changer des parties de meubles. Aux Gobelins, le feu fut mis à de nombreuses tapisseries dont on récupéra par la même occasion les riches matériaux. Le vandalisme antireligieux suivra.
Cannibalisme révolutionnaire
Gustave Le Bon (psychologie des foules, psychologie des révolutions, et René Girard (mécanique du bouc-émissaire, désir mimétique), ont traité du comportement bestial des foules en état de conscience altérée, de la mécanique collective de transe criminelle. Observations qu’avaient précédé les multiples cas de cannibalisme festif avérés par des textes à l’occasion de la Révolution française.
Dans le tumulte engagé en 1789, les « grands » (nobles et magistrats) ont cessé leur service, le Roi n’est plus obéi. La loi n’existe plus. L’homme n’a plus à cacher ses délits et crimes. Il n’y a plus d’État. Et, dès l’été 1789, on assassine. On exacerbe l’amour de l’égalité et développe l’envie, la jalousie et la haine contre les « aristocrates » (sic). On insiste sur le fait que la loi n’existe plus comme le démontrent les possibilités de pillage, de délinquance et de crime. Enfin, on encourage le « peuple » à se servir soi-même, à ses payer par la force ce que la société « vous doit depuis toujours ». Cette propagande, qui sert à exciter et soulever la « populace » selon Gustave Le Bon, est débitée en 1789 par les « cellules » des Jacobins, filiales des sociétés de pensée maçonniques.
Qui a tué ? Qui a fait ces journées de la Révolution ? Les historiens de gauche, et les communistes en particulier, ont épluché les lettres et les mémoires publiés et non publiés pour conclure que le peuple parisien, composé de « petits bourgeois », à savoir les boutiquiers, les apprentis, les ouvriers au chômage etc., a participé largement aux manœuvres de rue de la Révolution. Pour Gustave Le Bon, c’est la populace (nous dirions la canaille ou la racaille), encadrée par les agitateurs bien formés des sections du Club des Jacobins. Comme Le Bon l’a observé, une foule non encadrée, non dirigée, est inoffensive ; à peine peut-elle commettre quelques larcins, quelques petits actes de vandalisme. Car spontanément il existe aussi des redresseurs de tort. William Bush, pour son livre Apaiser la Terreur, a fait une longue enquête sur le mauvais traitement subi par les Carmélites de Compiègne et leur extermination en 1794. Gustave Le Bon a aussi fait des recherches (dans les procès-verbaux des sociétés populaires en particulier) sur les massacres souvent avec torture dits « du peuple » pendant la Révolution. Selon leurs travaux, c’étaient des chômeurs, des vagabonds, des asociaux connus de la police, de mauvais ouvriers et apprentis, qui, encadrés par les meneurs des sociétés populaires, des clubs politiques, des loges maçonniques, descendaient dans la rue, envahissaient l’Assemblée nationale (c’était encore possible à l’époque), apostrophaient les députés, tuaient les gens et promenaient ensuite leur tête au bout d’une pique. Et, lorsque des tueries étaient prévues comme lors des massacres de 1792, à chaque groupe d’émeutiers de quelques dizaines d’individus, on adjoignait un ou deux garçons de boucherie, car on savait bien qu’un citoyen ordinaire ne pouvait désarticuler ou décapiter un cadavre en un tournemain comme un apprenti-boucher dans sa boutique ou un chirurgien sur le champ de bataille napoléonien. Une fois réunie, la foule criait des slogans simples, excitant le cerveau émotionnel ; les hommes s’exaltaient mutuellement. L’excitation allait en croissant. L’enthousiasme suffisait à plonger les individus dans un état altéré de la conscience. Dans cet état de « transe collective », il suffit qu’un des meneurs commette un délit (frapper quelqu’un par exemple) et l’émotion, arrivée à son comble, explose ; alors se produit le lynchage, la mise en pièces de la victime. La régression mentale simplifie les processus en fonctionnement. En quelque sorte, la foule nivelle ; et les hommes finissent par devenir identiques et identiquement nuls (puisque l’intellect baisse pendant que l’émotion s’amplifie et s’exacerbe). Les hommes deviennent des « clones ». Gustave Le Bon a remarqué que, dans la transe, l’homme peut être saisi par un enthousiasme héroïque ou par une peur panique (alors on piétine femmes et enfants). Les agitateurs qui connaissent bien les techniques de la manipulation des foules déclenchent à bon escient la transe. Alors la foule est capable d’actes de violence et de cruauté extrême (crever les yeux, couper la langue d’un ennemi ligoté malgré les cris et supplications).
L’existence de cas de cannibalisme en France dans les années 1789-1792 ne semble guère contestable ; car des historiens et des observateurs d’inclination idéologique différente tels que Michelet, Taine, Mme Roland, Mallet du Pan etc. ont abondamment publié leurs témoignages et les résultats de leurs recherches (interrogatoires de témoins). Et la France était au sommet de la civilisation ! De tout temps, en cas d’interruption des services de ravitaillement (par la guerre par exemple), en cas de disette, de mauvaises récoltes non compensées par le commerce, en cas de naufrage etc., il y a cannibalisme de nécessité, de survie, que l’on cache pudiquement, mais sans condamner personne ! Il existe encore une variété de cannibales solitaires, secrets, agissant pour leur propre compte, et trouvant ces plats macabres, extraits d’une tombe récente, et plus rarement d’un cadavre encore tout chaud, provenant d’un meurtre, des qualités gastronomiques indescriptibles, sublimes ! Enfin il faudrait mettre à part les cas de cannibalisme observés pendant la Révolution française qui ne relèvent ni de la famine, ni de la misère ou de la nécrophilie. Il s’agit d’abord de tuerie massive, souvent effectuée dans la bonne humeur, avec danse et chant. Puis on se met à table, à moins que les morceaux de cadavre ne soient posés en amas par terre. On mange ces pièces crues ou grillées et jamais cuisinées de manière compliquée. Ce qui semble étonnant chez un peuple réputé pour ses goûts culinaires. On convient d’appeler ces pratiques « le cannibalisme révolutionnaire », car il n’a jamais été observé que dans la Révolution française. Et c’est bien la première fois dans l’histoire de France qu’on a égorgé tant de monde et qu’on s’en repaît si goulûment.
On arrive à la transe par une excitation extrême avec, au bout, la haine collective envers une caste. Le rejet de la méritocratie repose sur la jalousie, donc sur la haine, et surtout sur la conscience de sa profonde et incurable médiocrité ! Ainsi, le conventionnel Louis Legendre, boucher de son état (les bouchers étaient riches et puissants, comme l’a évoqué Martin Scorsese dans son film Gangs Of New York) a-t-il crié à la cantonade qu’il éventrerait, avec plaisir, un noble, un riche, un homme d’État ou un homme de lettre (sic), et qu’il en mangerait le cœur. Marat passa au stade suivant en excitant la haine pour se lancer dans la lutte des classes de la manière la plus bestiale, donc convenant à toutes les bourses. Il déclara : « Quand un homme manque de tout, il a le droit d’arracher le superflu dont il [Autrui] regorge. Que dis-je ? Il a le droit de lui arracher le nécessaire et, plutôt que de périr de faim, il a le droit de l’égorger et de dévorer sa chair palpitante ». En un mot, le droit de vie et de mort se prend par la force sauvage. Et le cannibalisme né de la haine rétablira la justice sanglante. Il faut se souvenir qu’au XVIIIè siècle on cherchait à exacerber la lutte des classes, à renforcer la haine entre les classes ; et en plus des jalousies d’ordre économique, on essayait d’inventer des haines racistes en affirmant que les nobles descendaient des pillards germains de Clovis, et le Tiers-État des malheureux Gallo-Romains vaincus et conquis ! Déjà bien avant Staline, on savait que plus un mensonge était gros, plus il avait des chances d’être cru ! Enfin, on augmentait l’excitation des populations par la peur : perspective de banditisme dans les campagnes, perspective de guerre civile, d’invasion étrangère (par les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais), perspective de trahison, de famine (les accapareurs !). Le stress (tension intérieure) augmente, changeant le comportement des hommes et leur affectivité, favorisant ainsi la transe et l’agressivité.
Le passage à l’acte, à la violence, sert à démontrer au « peuple » que la loi n’existe plus, que tout est permis et possible pour restaurer le bon droit du « peuple ». Il est à noter que, dès le mois de mars 1789, bien avant la réunion des États-Généraux (5 mai 1789), les troubles avec violence et incendie se sont déjà produits (Taine en compta 120 cas de mars à septembre 1789). Mais il n’y avait pas de développement progressif de la violence. Et, en effet, le cannibalisme fut observé dès le 12 août 1789 alors que déjà s’étaient constituées les municipalités et les gardes bourgeoises pour le maintien de l’ordre public. On racontait donc qu’un groupe d’hommes pénétra dans la citadelle de Caen, s’empara du major vicomte de Belzunce, connu pour son opinion anti-révolutionnaire (alors que les grands nobles commandant des armées étaient plutôt favorables aux idées nouvelles), le traîna dans la rue où il fut tué d’un coup de fusil. La victime fut aussitôt décapitée, démembrée, ouverte et vidée. Un certain Hébert coupa un morceau de viande sur le cadavre et en fit une distribution à plusieurs personnes qui en demandaient. Puis il mangea sa part de viande après l’avoir grillée. Certes des poursuites judiciaires contre le cannibale Hébert furent entreprises ; mais elles furent interrompues au bout de deux semaines à la grande fureur de la municipalité bafouée. Le cannibalisme, à cette date, était déjà à la mode, donc protégé ; il avait le bras long !
En août 1791, le retraité Guillin-Dumontet fut haché menu en son château. La gendarmerie arrêta les assassins à table, en train de souper avec les morceaux du cadavre. Et la justice de Lyon put constater un « festin d’anthropophages » (sic).
Le 10 août 1792, on festoya dans la Cour des Tuileries, en mangeant des côtelettes et du foie de Gardes Suisses grillés et en buvant du sang humain bien frais et mis en bouteille.
En septembre 1792, on massacra à Paris environ un, deux, milliers d’hommes et de femmes (le nombre exact des victimes n’est pas connu avec précision), après les avoir titillés avec le sabre et la pique afin de prolonger le supplice et les cris de douleur. Les Blancs torturés, à la différence des Iroquois, ne se croyaient pas obligés de narguer leurs bourreaux ! Les morts furent dénudés, décapités, démembrés, ouverts et vidés comme dans une boucherie. Les morceaux et les viscères furent classés en amas, par catégories. Et les « patriotes » (sic), débraillés, se gavèrent de chair et d’abats humains rôtis ou crus et saignants, et trempèrent leur pain « trop fade » (sic) dans le sang frais des victimes de la « justice spontanée du peuple » (sic).
La princesse de Lamballe, amie de la Reine, fut reconnue par la foule et tuée, décapitée, ouverte et vidée comme une bête ; et son cœur fut dévoré cru.
Voilà grosso modo les cas typiques d’anthropophagie dont on a conservé le témoignage écrit et indiscutable.
La transe ou état altéré de la conscience prédispose à la violence et à la cruauté collective. Elle est produite par des excitations extrêmes. Mais elle n’explique pas le cannibalisme. Les cannibales interrogés par les explorateurs en Afrique et en Océanie, et par la police en Europe, justifient leur penchant de multiples manières. Mais pour l’étude du « patriote » cannibale, il semble raisonnable de ne retenir que les causes suivantes. On accède au cannibalisme par le désir extrême de tuer, de détruire complètement l’ennemi, de l’anéantir totalement sans en laisser la moindre trace, de l’abaisser, de l’humilier, de le transformer en excrément, de l’évacuer par les latrines, de le dominer, de l’assimiler, de le posséder. Or, la Révolution propose, comme but ultime, l’égalité (bien sûr, à l’exception d’une nomenklatura privilégiée). Et l’égalité est une utopie qui mène à l’envie, donc à la tendance à comparer avec irritation, convoitise, et finalement à la jalousie et à la haine de classe. En pratique, la chose est bien identifiée, c’est le rêve de couper tout ce qui dépasse (je renvoie au mythe de Procuste).
Résumé des moments clé dans l’histoire du pouvoir en France :
Apparition de la féodalité.
Concurrence entre les grands féodaux et le pouvoir royal jusque sous Louis XIII.
Victoire du pouvoir royal et domestication des 250 grande familles de la noblesse par le système de cour, tels des caniches poudrés sous contrôle, sous Louis XIV.
Émergence des idées des Lumières et de la franc-maçonnerie.
Lassitude, rancune, des caniches et volonté de sortir du système de cour, investissement dans les idées maçonniques anglo-saxonnes, et dans les idées libérales économiques avec la bourgeoisie d’affaires qui s’est constitué entre temps, et elle aussi acquise aux changements dont sont porteuses les idées maçonniques par intérêt économique. Convergence d’intérêt pour les uns et les autres à faire tomber l’Ordre ancien.
Retour des parlements de province, freins aux réformes engagées par Louis XVI.
Blocage de la société.
Échec des états généraux du 5 mai 1789 mis à profit par les conspirateurs.
Instrumentalisation du bas peuple dans le coup d’État révolutionnaire.
Les bourgeois et aristocrates initiateurs de 1789 perdent contrôle des événements en 1792 au profit des « bolcheviques » du temps, Robespierre, Saint-Just, Marat, Hébert, etc. instaurant la Terreur.
Reprise du contrôle des initiateurs de 1789 avec l’éviction de Robespierre, aboutissant aux prémices du Ier Empire, éminemment bourgeois, avec le Directoire, le Consulat.
Depuis son coup d’État de 1789, le binôme Bourgeoisie/Débris de l’Aristocratie révolutionnaire est parvenu à s’auto-reproduire dans la conservation monopolistique du pouvoir, au travers de la franc-maçonnerie, sous tous les régimes successifs.
L’étude du Droit ouvre les yeux sur l’organisation constitutionnelle de la France. Depuis la révolution de 1789, l’histoire du pays se résume en une opposition-succession permanente des théories de souveraineté, entre Égalité portée par Rousseau et Liberté portée par Sieyès et Montesquieu. Il suffit pour le constater d’observer dans la rédaction des diverses Constitutions qui se sont succédé, à quelle place et dans quel ordre sont symboliquement cités les termes propres à chacune de ces théories. Ainsi par exemple les Déclarations des Droits de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 (reprenant celle de 1848) sont en opposition. Celle de 1789 met l’accent sur la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression, une Déclaration bourgeoise, « libérale », attachée aux droits fondamentaux, individuels et naturels. Celle de 1946 met en avant des droits économiques, protecteurs, sociaux et collectivistes, une Déclaration très « à gauche ». Les neuf Constitutions qui vont se succéder entre ces deux dates ne cesseront de déplacer les curseurs de ces théories. 1789 et 1946 bien qu’en opposition font désormais partie de ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité. Mais Égalité et Liberté sont des théories en vérité très difficilement compatibles, trompeusement réunies tout d’abord en une tentative de synthèse sous le liant artificiel de la Fraternité obligatoire, puis plus récemment par la constitution de 1958 qui réalise un compromis bâtard entre ces deux théories, en empruntant partiellement à chacune d’elles. Dès l’origine, la République française a souffert de principes contradictoires dont elle ne s’est jamais libérée. La philosophie individualiste des « droits de l’homme » s’oppose aux finalités collectives de la République et de sa devise. L’individualisme ne peut se concilier avec le principe holiste de la volonté générale. De même, l’utopie de la « nation contrat », libre association d’individus désincarnés, s’oppose à la réalité de la « nation héritage ». Quand ils criaient « Vive la nation ! » et chantaient la Marseillaise, les volontaires de l’An II ne le faisaient pas dans une langue élaborée par contrat, mais dans la langue héritée de leurs pères.
Conclusion
Mon intention initiale n’était pas de conclure par le propos qui va suivre, mais de m’en tenir simplement à la période révolutionnaire. Pourtant, comment échapper à la réalité. En effet, la Révolution française n’est pas terminée, selon les propos même de Vincent Peillon, ministre socialiste de l’Éducation nationale dans le gouvernement Ayrault du 16 mai 2012 au 31 mars 2014, personnage emblématique des partisans républicains, jacobins, qui religieusement depuis 1789 perpétuent par leur politique l’œuvre largement portée par les « Lumières » et la franc-maçonnerie. Dans l’intervalle, cette dernière n’a pas lâché le pouvoir, passant par la période napoléonienne et les épisodes de la IIIème République radicale-socialiste, jusqu’à nos jours. Le fait que des francs-maçons aient été éliminés à leur tour durant la Révolution (par d’autres maçons en désaccord), ne place pas l’institution en victime, comme on peut l’entendre occasionnellement dans le discours maçonnique, et n’enlève en rien sa responsabilité dans les évènements. Les francs-maçons sont installés partout, personnel politique et militants, énarchie, forces armées, magistrature, police, santé, fonction publique diverse, syndicalisme, assurances, mutuelles, secteurs « clé » de l’eau et de l’énergie, culture, finance, industrie, secteur du bâtiment bien sûr, épiscopat (oui !), etc. Aucun domaine n’échappe à leur présence. Ils sont les prétoriens du régime. Parce que le pouvoir ne saurait commettre l’imprudence de tolérer le risque que les lieux stratégiques puissent lui échapper, le Préfet de Police de Paris par exemple est toujours choisi parmi eux. La symbolique traditionnelle du triangle, pour la circonstance paré des trois couleurs, les trois points en étoile des « frères », et le fond bleu clair que l’on peut voir sur certains cordons maçonniques, va jusqu’à figurer dans le logo du Groupe de sécurité de la présidence de la République, unité de la Gendarmerie nationale. Nous vivons toujours sous l’empire de cette secte matrice et pouponnière du personnel politique républicain, Église sans sacrements à la gloire du régime, fatras ésotérique de mystique orientale, réseau dissimulé, donc déloyal, microcosme de connivence faussant à tous les échelons du dispositif le fonctionnement apparent des choses pour l’innocent encore non informé des réalités. Qu’y a-t-il de changé dans la France du XXIe siècle ? C’est bien établi, 1789 n’a été qu’un coup d’État qui ne s’est jamais fait dans l’intérêt populaire, mais au profit de la bourgeoisie qui est parvenue à reprendre la main avec l’ère napoléonienne après la parenthèse de la Terreur. Depuis, les trois anciens ordres se sont transformés en deux. L’Église a été sortie du jeu par le pouvoir maçonnique. Contrôlée par le régime, elle n’est plus qu’un fantôme, son pion pour le sage et gentil entretien des catholiques bisounours. Son rôle liturgique a été récupéré par le régime, qui a ses prêtres médiatiques de la « bien-pensance », ses processions (les manifs), ses saints révolutionnaires, son catéchisme et sa Bible droit-de-l’hommiste. Deux ordres. D’une part la noblesse et l’Église ont été fondus. Mais la noblesse véritable, d’épée, celle du sang versé pour la protection des autres, a disparu. C’est la noblesse factice, de robe, administrative, associée aux marchands, qui a pris le pouvoir en tant que nouvelle classe bourgeoise de politiciens professionnels, de la haute fonction publique et des médias, et qui continue de mener grand train. D’autre part demeure le tiers-état, dont décision a été prise de modifier sa teneur historique par l’introduction d’une submersion migratoire extra-européenne.
Florent de Mestre

Ci-dessus l’ancien logo du Groupe de sécurité de la présidence de la République, redessiné depuis et plus discret sur sa nature maçonnique.
Sources principales :
– Régénérer l’espèce humaine, utopie médicale des Lumières, Xavier Martin, éditions Dominique Martin Morin.
– La France abîmée, Xavier Martin, éditions Dominique Martin Morin.
– Le royalisme en questions, Yves-Marie Adeline, éditions L’Age d’Homme.
– Le Livre noir de la Révolution française, éditions du Cerf.
– Cannibalisme révolutionnaire, Dr Minh Dung Louis Nghiem, éditions de Paris.
– Histoire du citoyen, Jean de Viguerie, éditions Via Romana.
– La Vendée-Vengé, Reynald Sécher, éditions Perrin.
– La Nouvelle Revue d’Histoire n° 81, dossier Scandales financiers et corruption politique.
– Ainsi que ma nombreuse documentation maçonnique écrite, audio, vidéo, relationnelle dans ce milieu.