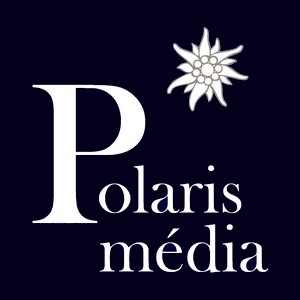…on n’a pas besoin d’ennemis. Le conflit global de civilisation dans lequel la France est entraînée par un pouvoir servile valet de la puissance atlantiste contre le monde de la Tradition au travers de la bataille sur le terrain ukrainien, est l’occasion de se repencher sur ce que fut l’histoire des relations entre les États-Unis et la France, de découvrir à cette occasion à quel point le suivisme des autorités françaises dans le jeu Otanien relève de la plus absolue forfaiture envers le peuple français.
En dépit de la fable que, depuis la disparition de De Gaulle, nos gouvernants vendus aux intérêts américains (notamment à travers le programme Young Leaders) s’évertuent à entretenir dans les éponges qui servent de cervelles à l’opinion, les États-Unis et la France ne sont nullement de grands amis dont les tempéraments et les avis divergeraient accidentellement, provoquant des brouilles passagères suivies de retrouvailles : il y a entre eux et nous un antagonisme irréductible.
Il faut le rappeler à ceux qui ont l’amnésie facile et la connaissance amputée par le silence de tout le discours institutionnel sur le sujet, les Normands eurent l’occasion en 1944 de jouir des méthodes de bombardement yankees. Le Havre, Caen, Avranches, entre autres, furent rasées. De juin à août, 20.000 civils furent tués, selon les estimations les plus basses, soit autant que de soldats américains pendant la bataille de Normandie, du Jour le plus long au départ pour Paris. Le reste de la côte atlantique ne fut pas épargnée. Ne restaient debout à Brest, après le passage des bombardiers US, que les défenses militaires allemandes. Et Royan ville sans intérêt stratégique, comme Dresde en Allemagne, fut rayée de la carte le 5 janvier 1945, quand Adolf Hitler préparait déjà son suicide. En tout, certains chercheurs évaluent, si l’on s’en tient à Wikipédia, à plus de 60.000 le nombre de civils tués par l’aviation américaine lors de la « Libération ». Quant aux viols de Françaises libérées par les GI’s, on n’en parlera pas, ils furent innombrables, mais on n’en meurt pas, dit-on.
On sait que Franklin Roosevelt voulait placer la France après la guerre sous mandat de l’AMGOT (contraction de Gouvernement Militaire Allié des Territoires Occupés), c’est-à-dire un gouvernorat direct de l’occupant américain (même les Allemands n’avaient pas osé cet outrage, laissant Pétain aux affaires), et qu’il y renonça sous la pression de Churchill. Le président américain, pur produit Wasp, était convaincu de la supériorité des protestants anglophones puritains et méprisait l’Europe, sa façon de penser et de faire de la politique, tout autant qu’il jalousait ce qui pouvait lui rester de puissance. Il était donc violemment anticolonialiste (sa femme Eleanor étant fortement engagée dans diverses œuvres du militantisme gauchiste démocrate), et comme il était aussi francophobe, il s’acharna à expulser la France d’Indochine, poussant les Chinois à l’envahir d’un côté, armant et finançant le Viet Minh de l’autre. Truman poursuivit sa politique jusqu’à l’avènement de Mao. Son successeur contra la France à Suez et lui mit systématiquement des bâtons dans les roues pendant la guerre d’Algérie. Les services américains aidèrent le FLN tant par esprit de système que pour ôter à la France, avec le pétrole du Sahara, son indépendance énergétique dans le domaine des combustibles fossiles.
Un Français naïf pourrait être tenté de manifester aux États-Unis de la gratitude pour leur intervention dans les deux guerres mondiales. En remontant plus haut dans l’histoire, on s’aperçoit qu’il serait fondé au contraire à reprocher aux Américains leur ingratitude – même si c’est une sottise, un Etat digne de la définition d’État (pas comme le Français éternel baisé des relations internationales) ne veillant qu’à ses propres intérêts et devant faire de l’égoïsme un principe. Quoi qu’il en soit, les treize colonies britanniques qui allaient devenir les États-Unis n’ont dû qu’à la France d’arracher leur indépendance lors d’une guerre qui dura de 1775 à 1783. D’abord pour les finances : non seulement Versailles prêta douze millions de livres aux Insurgents, mais elle leur en donna autant (de l’argent qui handicapa l’économie de la monarchie dans la tempête révolutionnaire). La réciproque ne fut vraie ni en 1914 ni en 1939. Roosevelt devait même rejeter net en 1940 l’appel à l’aide de Paul Raynaud qui lui demandait des avions à crédit. Mais c’est plus encore sur le plan militaire que la guerre d’indépendance des États-Unis fut gagnée par une aide décisive de la France. A partir de 1778, la flotte française neutralisa la royal Navy, ce qui permit à la fois d’isoler les troupes terrestres anglaises loin de leurs bases, et à la machine économique américaine de fonctionner sans craindre des incursions maritimes anglaises. Sur terre, les volontaires français, qu’ils soient sous l’autorité de Washington ou sous le commandement de Rochambeau furent déterminants. A la bataille décisive de Yorktown, les Français étaient très nettement plus nombreux que les Américains. Rien de comparable n’eut lieu lors de la première guerre mondiale. Sans doute l’arrivée des Américains pesa-t-elle sur le sort du conflit, car elle força Ludendorff et l’armée allemande à jouer leur va-tout, mais, sur le terrain, l’action des troupes américaines fut marginale. Et l’Amérique fit payer son aide, après tout assez chiche, d’interminables revendications, manœuvres et pressions, après chacune des deux guerres mondiales et jusqu’à aujourd’hui.
Mais revenons à la guerre d’indépendance des États-Unis. L’encre du traité de Versailles qui la termina en 1783 était à peine sèche que les Américains, oubliant à la fois ce qu’ils devaient à la France et ce qu’ils reprochaient à la couronne britannique, entreprirent une politique de préférence anglaise d’où les intérêts français se trouvaient exclus. Le commerce maritime en était l’âme. Et cela malgré la présence d’un fort parti français à Washington. Il faut dire que la mort de Louis XVI et la suppression de l’esclavage dans les possessions françaises du nouveau monde effrayèrent les États-Unis, qui comptaient en 1790 700.000 esclaves (George Washington était lui-même un important propriétaire d’esclaves par alliance avec son épouse) pour 3.200.000 citoyens libres. Ils n’honorèrent pas leur traité d’alliance avec la France pendant les guerres de la révolution et de Napoléon. Ils refusèrent net, en outre, d’interpréter les règles de la neutralité en faveur des Français et au détriment des Anglais. Ils renâclèrent à rembourser leur dette envers la France, sous prétexte que la République avait remplacé le roi. Ils allèrent même jusqu’à signer le traité de Londres du 19 novembre 1794 qui permettait à la marine anglaise de confisquer les marchandises françaises sur les bateaux américains, ce qui démontrait un attachement spécial et indestructible au Royaume-Uni et constituait une violation manifeste des traités bilatéraux passés avec la France, et une trahison. Le chien mordait sans pudeur la main qui l’avait nourri.
Par rétorsion, la Convention immobilisait les navires américains au mouillage dans les ports français et autorisait ses corsaires à arraisonner ceux qu’ils trouvaient en mer. Dans cette logique, les États-Unis menèrent, de 1798 à 1800, une « quasi-guerre » contre la France. Prenant prétexte des courses de ces corsaires, notamment de la destruction d’un cargo anglais, l’Orabissa, dans le port de Charleston, la toute jeune US Navy se mobilisa contre eux. Les États-Unis, toute honte bue, signèrent avec l’Angleterre et Toussaint Louverture, l’esclave révolté de Haïti, une convention commerciale tripartite dirigée contre la France. Il y eut quelques combats navals de très peu d’envergure qui tournèrent en général à l’avantage de l’US Navy, la marine royale française ayant été désorganisée par la Révolution et ayant d’autres chats à fouetter que de soutenir des Corsaires aux Caraïbes. La marine américaine se livra aussi à des actes de piraterie caractérisée sur des navires civils français. On estime le bilan à 85 bateaux français capturés par les Américains. Le 30 septembre 1800, chacun des quasi belligérants ayant intérêt à la paix, on signa le traité de Mortefontaine qui termina cette affaire mineure sur le plan des faits mais révélatrice sur le plan des mentalités.
Les États-Unis, comme cela devait toujours être le cas par la suite, invoquèrent un prétexte moral pour se mettre dans l’humeur de faire la guerre. Après l’odieuse ratification par Washington du traité de Londres, des négociations avaient été engagées par Talleyrand pour tenter de recoller les pots cassés. Mais il donna instruction à ses envoyés, Hottinguer, Bellamy et Hauteval, de poser des conditions : des excuses formelles pour certaines déclarations du président Adams, une indemnité de 50.000 livres sterling, un prêt compensatoire de 10 millions de dollars, et enfin… un dessous de table de 250.000 dollars pour lui-même, demande qui était alors monnaie courante et n’était nullement propre au diable boiteux. Le gouvernement américain, qui faisait tout pour faire capoter la négociation, finit par publier un rapport dénonçant vertueusement cette demande de pot-de-vin. Cette affaire fit grand bruit sous le nom d’Affaire XYZ et permit à l’Amérique de lancer le cœur tranquille sa quasi guerre contre sa grande bienfaitrice de la veille. Cette pantalonnade devait avoir des conséquences désastreuses. Le versatile Bonaparte avait eu un temps de développer la France des Amériques. Il y renonça, et vendit en 1803 la Louisiane pour quinze millions de dollars. Cette Louisiane excédait de beaucoup le territoire de l’État qui porte aujourd’hui son nom, elle s’étendait du Canada au Golfe du Mexique le long du Mississippi sur plus de deux millions de kilomètres carrés, soit 22 % du territoire actuel des États-Unis, elle équivalait en superficie aux États-Unis d’alors. Encore une magnifique forfaiture de la gouvernance française contre nos intérêts. La face du monde et l’histoire future auraient été toutes autres si ce territoire était resté français Sur les 15 millions de dollars dus, Washington et les Wasps du Nord-est en retinrent trois millions et demi en compensation des pertes infligées par les Corsaires français durant la quasi guerre. Ils emportèrent donc le morceau, qu’ils allaient ravager sauvagement pendant la Guerre de Sécession, pour onze millions et demi. Bonaparte, génie militaire et d’une certaine manière littéraire, commit là une de ses plus grosses bévues. Dépourvu de sens historique, il allait gaspiller la France en vaines campagnes et transformer une puissance réelle en épopée pour demi-solde. Pourtant, malgré la Révolution, la France conservait en 1801 une supériorité écrasante : elle comptait pour la seule métropole 29.400.000 citoyens libres, soit 6,7 fois plus que les États-Unis, et à peu près trois fois la Grande-Bretagne. Bien plus que les hésitations d’un Louis XV, la stupide chevauchée napoléonienne pour répandre la Révolution (en bon fils qu’il était de celle-ci) au reste de l’Europe laissa une France occupée, humiliée, rapetissée, ruinée de réputation et surtout exsangue. En face, après avoir nourri l’indépendance américaine en croyant ainsi contrarier la puissance britannique, l’alliance indéfectible Amérique-Angleterre allait interdire à tout jamais à la France de poursuivre son destin historique.
Le temps a passé, mais ranger la France dans le ballet des manœuvres anglo-américaines ayant provoqué la Russie en Ukraine, se retournera aujourd’hui encore contre nos intérêts.