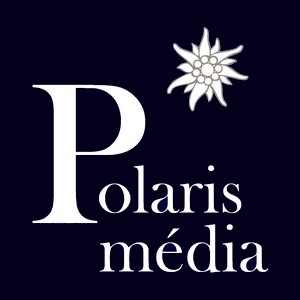Libéral au sens français, pas au sens américain qui désigne la gauche, le Parti démocrate. Nous ne sommes par partisans de la politique économique libérale et du libre-échange débridés et sans pitié tels que les pratiquent les mondialistes, on voit les ravages que cela a provoqué et provoque toujours sur les emplois et certains secteurs, comme l’agriculture actuellement. Cela ne signifie pas qu’il faille aller vers une économie communiste, gage certain de désastre. Mais sans être de ces libéraux, il faut néanmoins reconnaître que la doctrine a eu un penseur qui n’est pas dénué d’intérêt, en la personne de Frédéric Bastiat.
Frédéric Bastiat est un économiste français (1801 – 1850), dont les œuvres complètes tiennent en sept volumes. Ayant été un champion du libre-échange, un partisan d’un interventionnisme minimal de l’État, un pédagogue du droit de l’individu et, de là, un pourfendeur du socialisme, il est totalement occulté par les gens qui tiennent la France. Un économiste optimiste, parfois angéliste. Un temps fort célèbre, il est tombé dans l’oubli. Le libéral inconnu, en quelque sorte ? Presque. On ne l’enseigne plus. Son nom surnage dans la mémoire des rares intellectuels qui ont lu L’histoire des doctrines économiques où Karl Marx s’oppose à lui. Ses textes ne sont connus que d’un petit nombre d’économistes et de politiciens. Chez les champions du libre-échange, Margaret Thatcher en a cité de mémoire des paragraphes entiers pour épater Giscard, Ronald Reagan le lisait déjà avant d’entrer en politique. Bastiat est toujours à l’étalage des librairies aux États-Unis, publié au Brésil, pratiqué au Japon, traduit en lituanien. Il est tabou en France. Avant de citer le personnage et la pertinence de ses propos, commençons par évoquer le tableau français :
La liberté et l’indépendance d’action n’ont pas de prix. Rien au monde ne vaut que l’on abandonne sa liberté. C’est pourtant ce qu’ont fait les Français. Jusqu’en 1848, l’Etat se contentait d’assumer les fonctions régaliennes, d’imposer aux citoyens certaines contributions à la vie collective (impôts, défense du territoire, etc.) et de garantir les droits fondamentaux (liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression) : les droits « de ». Mais 1848 amena une distinction sémantique qui sera largement reprise en 1946 et qui aura d’importantes conséquences : les droits « à ». Avec cette distinction entre droits « de » et droits « à », par ces simples petits mots, on se trouve au cœur du combat philosophique entre les principes de Liberté et d’Égalité. À partir de 1848, et à plus forte raison de 1946, le citoyen n’a plus seulement la « liberté » de circuler, de penser, de s’exprimer, de publier, de prier, etc…, il n’a plus seulement le « devoir » de participer aux dépenses et aux efforts de la collectivité, il a maintenant « droit à » telle ou telle chose, à l’instruction, au travail, à une vie décente, au logement, au repos, aux loisirs, à la santé, à la sécurité matérielle, etc… Autant de garanties fort appréciables, mais comme toujours avec la pensée humaniste et les idées partant de bonnes intentions, leurs dérives et leurs excès finissent par produire une hétérotélie, des effets pervers contraires à l’objectif initialement visé et des conséquences préjudiciables à l’individu. Si les droits « de » ouvrent simplement des possibilités, donnent la liberté aux hommes de jouir des droits naturels fondamentaux et de faire telle ou telle chose selon leurs moyens respectifs, les droits « à » en revanche viennent modifier profondément la conception des rapports entre le citoyen et l’Etat, car en garantissant généreusement au peuple des droits « à », l’Etat s’arroge aussi et du même coup le droit de gérer leur existence en légiférant à outrance. De là, le peuple est tenu et perd son indépendance.
Les gouvernants et le jacobinisme ont réussi à amener les Français à abandonner leur liberté contre un assistanat généralisé découlant de ces sacro-saints droits « à » ; c’est ce que l’on a appelé l’État-Providence, le Welfare state chez les Britanniques. Cela se caractérise aujourd’hui par un hyper-interventionnisme de l’État dans tous les domaines. Le pouvoir technocratique ne peut s’empêcher de faire sentir son poids en toutes occasions, dans les moindres moments de la vie quotidienne. Il n’est pas question de rejeter en bloc la notion d’État, mais l’État ne devrait assurer que les fonctions essentielles (Armée, Police, Justice, premiers secours, battre monnaie, etc…) et ne pas venir se mêler abusivement de détails concernant la vie quotidienne, rabaissant les Français au rang d’enfants irresponsables dont le parcours doit être strictement dirigé. Mais l’ogre jacobin a voulu s’accaparer et contrôler des domaines qui auraient pu rester du ressort des individus. Que dit Bastiat à ce sujet ? S’il existait un dictionnaire des catastrophes prévues de longue date, on pourrait y lire les propos que voici, d’un bon sens exemplaire, contemporains des premières sociétés de secours mutuel jaillies spontanément au milieu du XIXe siècle chez les ouvriers : « Supposez que le gouvernement intervienne. Il est aisé de deviner le rôle qu’il s’attribuera. Son premier soin sera de s’emparer de toutes ces caisses sous prétexte de les centraliser et, pour colorer cette entreprise, il promettra de les grossir avec des ressources prises sur le contribuable. »
C’est ainsi qu’est né notre système de protection sociale, en effet. Et quoi d’autre ?
« Mais, je le demande, que sera devenue la moralité de l’institution quand sa caisse sera alimentée par l’impôt ; quand nul, si ce n’est quelque bureaucrate, n’aura intérêt à défendre le fonds commun ; quand chacun, au lieu de se faire un devoir de prévenir les abus, se fera un plaisir de les favoriser ; quand aura cessé toute surveillance mutuelle et que feindre une maladie ce ne sera autre chose que de jouer un bon tour au gouvernement ? (…) Il nommera des vérificateurs, des contrôleurs, des inspecteurs, on verra des formalités sans nombre s’interposer entre le besoin et le secours. Bref, une admirable institution sera, dès sa naissance, transformée en une branche de police ».
Et jusqu’où se poursuivent les déductions de Bastiat ?
« Les ouvriers ne verront plus dans la caisse commune une propriété qu’ils administrent, qu’ils alimentent, et dont les limites bornent leurs droits. Peu à peu, ils s’accoutumeront à regarder le secours, en cas de maladie ou de chômage, non comme provenant d’un fonds limité préparé par leur propre prévoyance, mais comme une dette de la société. L’Etat se verra contraint de demander sans cesse des subventions au budget. Là, rencontrant l’opposition des commissions de finances, il se trouvera engagé dans des difficultés inextricables. Les abus iront toujours croissant, et on en reculera le redressement d’année en année, comme c’est l’usage, jusqu’à ce que vienne le jour d’une explosion. »
Nous y sommes.Depuis notre naissance, nous avons entendu parler du déficit chronique de la Sécurité sociale, et des abus dedépense de santé des Français. Au-delà, c’est l’ensemble du budget de la France qui estdéficitaire sans interruption depuis quarante ans !
« Mais alors on s’apercevra qu’on est réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d’un ministre ou d’un préfet, même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d’avoir perdu jusqu’à la notion du droit, de la propriété, de la liberté et de la justice. »
Bastiat excelle à faire comprendre les effets pervers des meilleures intentions, à dévoiler la spoliation sous le slogan partageur. Lors de la révolution de 1848, chacun considère sous tous les angles possibles « la question sociale ». La plus forte critique de Bastiat tient en une phrase : « Tous ont vu entre l’humanité et le législateur les mêmes rapports qui existent entre l’argile et le potier ».
La loi doit servir à éviter l’injustice, rien de plus. Si elle sert à prendre aux uns pour donner aux autres, elle sera cause perpétuelle de haine, de discorde et de révolution. C’est ainsi qu’aux États-Unis la guerre civile lui semble inévitable à cause de l’esclavage et du protectionnisme. C’est pour la même raison que Bastiat ne cesse de refuser à grands cris la « Fraternité obligatoire », comme il la nomme, des révolutionnaires de 1848. Il faut dire que l’époque est particulièrement féconde en innovations de « politique sociale ». Le gouvernement provisoire rassemble toutes les tendances, des républicains modérés aux démocrates les plus énergiques, tel Louis Blanc. Lamartine, aux Affaires étrangères, arbitre, s’oppose à la foule armée qui veut imposer le drapeau rouge, qui exige le droit du travail, c’est-à-dire l’interdiction du chômage et un salaire garanti pour tous. Le gouvernement accorde la création des Ateliers nationaux. C’est l’idée de Louis Blanc, secrétaire du gouvernement. L’État embauche aux Ateliers nationaux tous les chômeurs pour des travaux d’utilité publique. La paye est bonne : les ouvriers quittent leurs usines et leurs manufactures pour profiter de l’aubaine. Le pays est paralysé par la révolution, le chômage et la misère s’étendent, la famine apparaît dans Paris. Au bout de trois mois, le dixième de la population, cent mille personnes, émargent aux Ateliers nationaux, employés le plus souvent à ne rien faire ; soixante mille autres essaient d’y entrer. Les finances publiques s’effondrent. Le gouvernement ferme les Ateliers en juin. Le socialisme a échoué en un mois, ruiné le pays en deux, il amène un bain de sang au troisième. Le Paris ouvrier se soulève dans le désespoir absolu, sans revendication et sans cri, avec le drapeau noir et cette seule phrase : « Du pain ou la mort ». En face, la répression la plus sanglante, pas de quartier. On se tue en silence. Les républicains de gauche ont nommé un homme à poigne, le général Cavaignac, afin qu’il massacre les ouvriers qu’ils ont trompés. La France va continuer son chemin jacobin.
Bastiat a anticipé et combattu ces évolutions. Mais dans notre pays, ce sont les thèses de ses adversaires qui l’ont emporté : l’État Providence, omnipotent et « omnicompétent ». Les idées de Bastiat n’ont pas prospéré en France, mais en Amérique et en Angleterre. Et l’Etat républicain jacobin sait être symboliquement cruel pour la mémoire de cet homme qui a tant plaidé contre les impôts spoliateurs : sa maison de Mugron abrite aujourd’hui la perception.
Frédéric Bastiat a donné sa définition de l’Etat, sa conclusion est d’une lucidité magnifique :
« L’homme répugne à la peine, à la souffrance. Et cependant il est condamné par la nature à la souffrance de la privation, s’il ne prend pas la peine du travail. Il n’a donc que le choix entre ces deux maux. Comment faire pour les éviter tous deux ? Il n’a jusqu’ici trouvé et ne trouvera jamais qu’un moyen : c’est de jouir du travail d’autrui ; c’est de faire en sorte que la peine et la satisfaction n’incombent pas à chacun selon la proportion naturelle, mais que toute la peine soit pour les uns et toutes les satisfactions pour les autres. De là l’esclavage, de là encore la spoliation, quelque forme qu’elle prenne : guerres, impostures, violences, restrictions, fraudes, etc., abus monstrueux, mais conséquents avec la pensée qui leur a donné naissance. On doit haïr et combattre les oppresseurs, on ne peut pas dire qu’ils soient absurdes. L’esclavage s’en va, grâce au Ciel, et, d’un autre côté, cette disposition où nous sommes à défendre notre bien, fait que la Spoliation directe et naïve n’est pas facile. Une chose cependant est restée. C’est ce malheureux penchant primitif que portent en eux tous les hommes à faire deux parts du lot complexe de la vie, rejetant la Peine sur autrui et gardant la Satisfaction pour eux-mêmes. Reste à voir sous quelle forme nouvelle se manifeste cette triste tendance. L’oppresseur n’agit plus directement par ses propres forces sur l’opprimé. Non, notre conscience est devenue trop méticuleuse pour cela. Il y a bien encore le tyran et la victime, mais entre eux se place un intermédiaire qui est l’Etat, c’est-à-dire la loi elle-même. Quoi de plus propre à faire taire nos scrupules et, ce qui est peut-être plus apprécié, à vaincre les résistances ? Donc, tous, à un titre quelconque, sous un prétexte ou sous un autre, nous nous adressons à l’Etat. Nous lui disons : « Je ne trouve pas qu’il y ait, entre mes jouissances et mon travail, une proportion qui me satisfasse. Je voudrais bien, pour établir l’équilibre désiré, prendre quelque peu sur le bien d’autrui. Mais c’est dangereux. Ne pourriez-vous me faciliter la chose ? Ne pourriez-vous me donner une bonne place ? Ou bien gêner l’industrie de mes concurrents ? Ou bien encore me prêter gratuitement des capitaux que vous aurez pris à leurs possesseurs ? Ou élever mes enfants aux frais du public ? Ou m’accorder des primes d’encouragement ? Ou m’assurer le bien-être quand j’aurai cinquante ans ? Par ce moyen, j’arriverai à mon but en toute quiétude de conscience, car la loi elle-même aura agi pour moi, et j’aurai tous les avantages de la spoliation sans en avoir ni les risques ni l’odieux ! Comme il est certain, d’un côté, que nous adressons tous à l’Etat quelque requête semblable, et que, d’une autre part, il est avéré que l’Etat ne peut procurer satisfaction aux uns sans ajouter au travail des autres, en attendant une autre définition de l’Etat, je me crois autorisé à donner ici la mienne : L’Etat, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde ».